
 |
|
| | La 2ème Guerre Mondiale |
|
SOUVENIRS DE CAPTIVITÉ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
J’ai été fait prisonnier après l’Armistice, au sommet du DONON dans les Vosges, le 27 juin 1940, avec le 43eme corps d’armée du Général LESCANE (environ 20.000 officiers et soldats, soit toutes les troupes qui occupaient la ligne Maginot entre Bitche et Niederbronn). Les Allemands avaient remis à chaque officier une copie de la convention de reddition stipulant que nous serions libérés à Strasbourg. J’ai, bien entendu, cherché à savoir s’il y avait une possibilité de m’évader, d’autant plus facile, en apparence, que j’étais en pays ami et parlais aussi bien l’allemand que le français. A plusieurs reprises, je suis allé en reconnaissance dans les environs, jusqu’aux avant-postes allemands. Les troupes allemandes qui nous encerclaient étaient d’environ 100.000 hommes. Pendant notre marche à pied du Donon à Strasbourg -voir annexe 1- j’ai pu constater que toute la région fourmillait de soldats allemands. Sur toute la route, des sentinelles armées étaient postées de 50 à 100 m jusqu’à Strasbourg - trajet de quelques 50 kilomètres - il n’y eut aucune évasion possible. Au Donon, nous étions constamment survolés par des avions ennemis. Il m’aurait fallu des vêtements civils et une ferme pour me cacher pendant quelque temps. Cela n’existait pas. Nous vivions dans les forêts et il pleuvait souvent. D’ailleurs, le commandement français qui était en pourparlers avec les Allemands, et qui s’était laissé bêtement abuser, interdisait formellement aux officiers de se séparer de la troupe. Il fallait "rester groupés", la convention de reddition en préparation, stipulant que les officiers garderaient leurs bagages, comme "division libre" (Freie Division), que nous serions libérés "selon les règles", à Strasbourg à condition de nous y rendre en ‘unités constituées’. Dans la nuit au 25 au 26 juin (après l’armistice), le Colonel Bourgeois du 154è R.I.F. a décidé de brûler le drapeau de notre régiment. J’y ai découpé un petit morceau de soie rouge que j’ai pu conserver pendant toute ma captivité. Le Lieutenant Albert BERNARD, qui n’était pas de mon régiment, dont j’ai été séparé à Strasbourg, mais avec qui j’ai partagé la majeure partie de ma captivité, l’a encadré en 1943, à ma demande, sous forme d’un drapeau tricolore représentant la France, la mer en bleu, la France en blanc, son "coeur" en rouge (grâce au morceau de soie sur lequel des traces de brûlures ont été faites avec une cigarette allumée, simplement pour rappeler son incinération au sommet au Donon) .C’est à ma connaissance, le seul morceau authentique qui en reste. Après la guerre, notre Association régimentaire "Caurettes-Vosges" a fait ériger un monument commémoratif à l’endroit précis où l’incinération a eu lieu. Avec la volonté de créer l’Europe, ce monument devient quelque peu anachronique, et combien d’autres. Il a d’ailleurs été plusieurs fois mutilé par des inconnus. Je désire expressément que ce souvenir soit offert, plus tard, au Musée des Armées -aux Invalides- où sont exposés, dans plusieurs vitrines, d’autres reliques de cette pénible période. Cette même nuit, j’ai brûlé, dans notre cuisinière de campagne, tous les billets dont j’étais porteur en qualité d’officier des Détails", une expression napoléonienne assez méprisante (cet officier ne participait pas, en 1ère ligne, aux opérations proprement militaires) pour désigner l’officier trésorier et l’officier d’Etat-civil (constatation des décès, etc.). Dans l’armée allemande, il s’appelle "Zahlmeister’ (maître des paiements) du 3è bataillon, après avoir, conformément au règlement, relevé, à la lueur d’un feu de camp, les numéros de tous les billets, état contresigné de notre Colonel, du chef de Bataillon et de l’officier de Ravitaillement (300.000 frs de l’époque). A ma première immatriculation comme prisonnier de guerre, mon précieux "Etat de destruction de l’encaisse" au Donon, a été, malgré mes vives protestations, déchiré sans façon par les Allemands.
Né en 1903 à Sarreguemines (Moselle) en Lorraine annexée en 1871, je pouvais toutefois me faire libérer tout de suite, à condition, pour les officiers, de signer une déclaration de collaborer à la prospérité du Grand Reich. C’est ainsi que le 13 juillet 1940, tous les intéressés, soldats, sous-officiers et officiers ont été libérés. Parmi les officiers, seulement deux ont publiquement refusé ce "cadeau" le capitaine de MARTIMPREY (de Sarrebourg) et moi-même. (Le Capitaine de Martimprey appartenait au 1er bataillon du 154 R.I.F., il était grand propriétaire terrien, domaine de Romécourt par Maizieres-lès-Vic (Moselle). Après notre refus devant la seconde commission, nous avons été immédiatement séparés. La famille de Martimprey, très fortunée, tout en gardant le domaine de Romécourt, habite maintenant le XVIème arrondissement de Paris). Par la suite, les libérés ont amèrement regretté leur choix. A partir de 1943 eux-mêmes et surtout leurs fils ont été remobilisés de force dans l’armée allemande. C’est le drame des "Malgré-Nous’- Les Editions Pierron ont publié le meilleur livre sur ce sujet dramatique.
Pendant que les graves événements de mai et juin 1940 se bousculaient les uns les autres, j’ignorais jusqu’à l’existence du Général de Gaulle et, a fortiori, son "Appel au 18 juin". J’étais, à cette date, quelque part sur les routes entre la ligne Maginot abandonnée le 14 juin et le Donon où notre colonne misérable, sans moyens de transport, arrivait le 20. C’est l’attitude digne et courageuse du Marécha1 Pétain investi du pouvoir par un vote régulier de la Chambre des Députés du Front Populaire elle-même (sauf 80 voix sur 580) qui m’a dicté ma propre conduite. Dans cette caserne du Polygone, tous les officiers prisonniers d’origine alsacienne ou lorraine passaient individuellement, le 13 juillet, devant une Commission allemande de libération présidée par l’avocat Thomas de Sarreguemines, un "autonomiste" notoire, mais qui n’avait jamais été inquiété avant la guerre. Il me connaissait personnellement ainsi que ma famille. De Martimprey et moi-même sommes repassés une deuxième fois devant cette commission pour nous "expliquer". Notre refus nous a valu le privilège d’être présentés, deux jours plus tard, devant une autre commission, composée d’officiers supérieurs dont l’un d’entre eux nous a vanté l’avenir glorieux qui nous attendait dans le futur Grand Reich. Sans plus de succès. Nous avons été aussitôt séparés du reste de nos camarades de "l’intérieur" qui ont été envoyés dans divers camps en Allemagne. Dans leur déclaration les officiers Alsaciens-Lorrains libérés devaient, bien entendu, s’engager, en outre, à ne pas quitter le territoire des trois départements ré-annexés de fait. Un certain nombre, mais très peu, ayant signé, se sont réfugiés ensuite en zone libre (ceux qui avaient là leur famille notamment). Pour moi, le refus était une question de principe. Pendant mon séjour dans les casernes du Polygone de Strasbourg (celles-ci ont été détruites par la suite, et remplacées par des immeubles H.L.M. de bonne qualité), mon beau-frère Henri Peltre de Francaltroff, ayant appris que j’étais retenu prisonnier dans ces casernes où régnait une promiscuité indescriptible, (prévues pour l’effectif d’un régiment de 3.600 hommes, nous y étions 20.000), avait réussi au prix de mille difficultés de transport et autres, à venir jusque-là pour me remettre un colis de vivres, mais les sentinelles ne l’avaient pas laissé passer. Le colis m’avait néanmoins été remis. Je ne voulais pas laisser ignorer ce beau geste de la part de mon beau-frère et de ma soeur Louise. Je voudrais encore signaler que pour éviter les évasions de nuit, les Allemands utilisaient un système simple et efficace. Pratiquement, pendant toute la nuit, les sentinelles des miradors tiraient des rafales de mitrailleuse dans les zones balayées par les projecteurs de lumière. Après la liquidation de ce camp provisoire, j’ai fait un séjour de trois semaines dans un autre camp de Strasbourg où se trouvait un groupe de médecins qui s’attendaient, en vain, à être libérés. Une épidémie de dysenterie s’y est déclarée dont j’ai été pratiquement épargné. Comme j’étais le seul à parler allemand, j’ai été autorisé, deux fois, à me rendre en ville, pour acheter des médicaments. Il n’y avait aucun service médical allemand et la nourriture était franchement mauvaise. J’étais accompagné d’une sentinelle armée, qui ne me quittait pas d’une semelle. Je l’entraînais jusque vers le centre de la ville (distance entre la caserne qui servait de camp, à mi-chemin du Pont du Rhin et la Place Kléber 4 à 5 km). Je voulais évidemment voir s’il y avait une possibilité d’évasion. Avec mon uniforme d’officier français, ce n’était pas possible sans grand risque. Le trajet était long et plus encore humiliant pour moi, car dans les rues du centre ville, j’ai été obligé de marcher dans le ruisseau, alors que d’innombrables officiers allemands, encore ivres de leur victoire, se prélassaient sur les trottoirs. J’ai pu faire mes achats (on payait à volonté en francs ou en marks) et j’ai pu me procurer un journal local. Juste dans ce journal là, les "Strasburger Neueste Nachrichten" (Dernières Nouvelles de Strasbourg) daté du 13 août 1940 se trouvait une photo de l’immeuble de la Banque de France (où j’avais travaillé de 1926 à 1929 comme secrétaire du Directeur), photo sur laquelle un gros allemand hilare était en train de marteler les caractères en bronze "Banque de France"- Je n’avais pu pousser personnellement jusqu’à la Place Broglie. De ce deuxième camp où le 15 août 1940, un officier français du nom de A.MARTIN a fait bénévolement mon portrait au fusain - portrait que j’ai pu conserver,- je fus envoyé au camp de Ludwigsburg près de Stuttgart. Je me suis vite rendu compte que ce camp avait un caractère très spécial. Il servait à "sélectionner", parmi les prisonniers, ceux qui pouvaient être utiles aux nazis dans la poursuite de leurs oeuvres de guerre. Si incroyable que cela puisse paraître, je fus convoqué, un jour, par un officier allemand qui déclarait appartenir au personnel de la Reichsbank et me saluait du titre de "cher collègue". Il me fit des propositions très alléchantes en cas de ralliement à la cause allemande. La Reichsbank, disait-il, était en train d’organiser son (nouveau) réseau de succursales, en Alsace-Lorraine (réannexée) et me laisser espérer un poste très élevé "supérieur à tout ce que la Banque de France pourrait m’offrir dans la France vaincue". Dans mon esprit, il était clair, dès ce moment là, que les nazis recherchaient, par tous les moyens, des "collaborateurs" pour les exploiter et les compromettre par la suite. De tous les agents prisonniers de la Banque, j’étais le plus élevé en grade (Inspecteur de 2è classe, chef de tournée) et j’avais fait, en 1931, une thèse de doctorat sur les banques alsaciennes, couronnée par l’Université de Strasbourg. Les Allemands en avaient eu connaissance, ma thèse se trouvait dans tous les comptoirs d’Alsace et de Lorraine. Dans le même camp, les Allemands avaient rassemblé environ 80 médecins français sélectionnés parmi les prisonniers. Il s’agissait de spécialistes réputés dans des domaines de pointe. Nous logions tous ensemble sous une grande tente et je m’étais fait pas mal d’amis parmi eux. Un jour, des professeurs d’université allemands sont venus leur faire passer des interrogatoires compliqués pour s’assurer de leur compétence. Etonnés de constater la qualité et la précision de leurs connaissances, ils leur offraient de les engager de suite dans leurs laboratoires où ils jouiraient d’une grande liberté". Comme je l’avais fait de mon côté, tous ont refusé de collaborer. Le camp fut dissous et les prisonniers expédiés dans divers camps ordinaires de détention. En ce qui me concerne, je fus envoyé, avec d’autres officiers prisonniers que je ne connaissais pas auparavant, dans un wagon à bestiaux, en direction de l’Allemagne de l’Est vers une destination que j’ignorais. En cours de route, d’autres prisonniers étaient joints à notre convoi. C’est ainsi qu’après un voyage de deux jours - après de nombreux arrêts pour laisser les trains militaires vers l’ouest, notre colonne arrivait au camp de LAMSDORF en Silésie au nombre d’environ 600. Là, un incident assez cocasse s’est produit à notre arrivée. Le commandant du camp (un très grand "Stalag" pour soldats et sous-officiers) , un brute épaisse nazie avinée monta sur une estrade pour nous "accueillir". En hurlant, comme le Führer, il nous fit savoir que la guerre était loin d’être terminée ni pour eux ni pour nous et que si nous voulions être traités et nourris convenablement, il fallait travailler dur et produire avec une efficacité maximum ; autrement il prendrait des "sanctions sévères contre les récalcitrants". Lorsqu’il fut descendu de l’estrade, quelqu’un de son entourage lui fit observer qu’il s’agissait d’officiers prisonniers, non astreints au travail manuel. Alors il se mit en colère en s’écriant "Mais qu’est-ce qu’ils foutent ici ? qu’on les renvoie où l’on voudra !" C’est ainsi que notre groupe arriva enfin à l’Oflag d’EULENBERG en Haute Silésie, fin août ou début septembre. EULENBERG - Mont des Hiboux Haute Silésie Château-fort pittoresque du Moyen-Age, en haut d’une colline escarpée, transformé, avant la guerre, en auberge de jeunesse. C’était un camp très plaisant dont le seul inconvénient était que prévu pour une centaine de personnes, au grand maximum, et nous étions plus de 600, donc fort à l’étroit. D’où une promenade hebdomadaire dans la campagne sous la surveillance de sentinelles, car la petite cour intérieure du château permettait tout juste de se dégourdir les jambes. M’étant enquis auprès des sentinelles des raisons de l’affectation d’un aussi beau château-fort comme camp de prisonniers, mes informateurs n’ont pas hésité à me confier que dès que le déroulement des opérations sur le front français dépassa toutes ses prévisions, l’armée allemande s’était mise fébrilement à construire des camps pour faire face à l’afflux extraordinaire et imprévu de prisonniers de tous rangs. Au fur et à mesure des arrivées massives, les camps nouvellement construits d’abord, tous les locaux disponibles ensuite furent remplis, confirmant la parole de l’Evangile selon laquelle les derniers arrivants seront les mieux servis. Cette même question s’était déjà posée lors de la guerre de 1870. Entre la "bataille des frontières", Spicheren (près de Forbach) et Froeschwiller-Reichshoffen (entre Niederbronn et Haguenau), le 6 août 1870 et la capitulation de Sedan, le 2 septembre 1870 et celle de la garnison de Metz sous l’instigation du Maréchal Bazaine, l’armée allemande avait fait plus de 800.000 prisonniers et dû improviser, à la hâte, des grands camps pour soldats, sous-officiers, officiers et surtout les généraux français et l’Empereur Napoléon III faits prisonniers. Les conditions de vie y étaient franchement mauvaises, mais pas pour tous. Le typhus y faisait de nombreuses victimes, mais il se transmettait également aux gardiens allemands. C’est pourquoi pendant notre captivité, si les Allemands se moquaient des punaises et des puces, la découverte d’un seul pou déclenchait tout un système d’alerte . Quant à la capture des prisonniers, pendant la guerre 1870-1871, j’ajoute simplement : ceci un jour, chez un bouquiniste, j’ai trouvé les mémoires du secrétaire privé de BISMARCK. Ce livre introuvable relate, au jour le jour, les dires et les gestes de Bismarck. L’auteur du livre considère Bismarck "comme un Dieu". Il est représentatif de la pire espèce des pangermanistes. Son livre est une source inépuisable de renseignements sur les événements de la guerre franco-allemande. En réponse aux questions des généraux : "Quoi faire, où loger les prisonniers", Bismark répondait invariablement "Fusillez-les ! Ne me parlez plus de prisonniers." Les généraux ne l’ont pas fait systématiquement, mais les hommes, nombreux, arrêtés sur le soupçon d’être des francs-tireurs, étaient immédiatement passés par les armes, leur maison brûlée. On oublie trop souvent que cette guerre là, qui n’a duré qu’un mois, comme en 1940, a été une guerre atroce du début à la fin. Elle s’est poursuivie, dans les mêmes conditions, pendant le blocus de Paris par l’armée allemande; puis ce fut pour finir les atrocités commises par les Versaillais pour réprimer la COMMUNE. Pour clore ce chapitre, constatons simplement qu’aujourd’hui, il ne subsiste plus rien, mais plus rien du tout, de l’oeuvre de Bismarck. Le plus pittoresque était le commandant du camp d’EULENBERG, le Major Von Grosbois, descendant de huguenots, très francophile, d’une naïveté désarmante, prêchant l’Europe unie "pensée unique de Hitler" et certain de notre libération avant Noël 1940. J’ai eu plusieurs conversations avec lui. Il parlait un excellent français, mais en tant que commandant du camp, il ne s’exprimait, en présence de tiers, qu’en langue allemande. Lui aussi ignorait l’existence du Général De Gaulle et parlait avec admiration du Maréchal Pétain. Selon lui, le Fürher et le Maréchal, ayant fait tous deux la guerre 1914-1918 ne pouvaient manquer de trouver un terrain d’entente pour créer une "Europe unie", réconciliant les anciens ennemis. Ma parfaite connaissance de l’allemand m’a fait choisir comme "homme de confiance" par les prisonniers et j’assistais, comme traducteur, aux visites médicales, ce qui m’a permis d’en faire libérer un certain nombre (peut-être huit) plus ou moins gravement malades. En réalité ils ne supportaient pas psychologiquement le fait d’être enfermés, jour et nuit, ce qui était une des plus graves difficultés au début de la captivité. Ils avaient les nerfs moins solides que les autres et étaient tentés de se suicider. Le médecin (officier de réserve) n’était pas un mauvais bougre, mais il ne disposait que de 4 médicaments :
A chaque visite il distribuait lui-même ces médicaments au compte-gouttes. Ce n’était pas de sa faute, mais il n’avait rien d’autre. Dans les autres camps, c’était sensiblement la même chose. Il fallait attendre dans les chambrées que le mal passât ! parfois des semaines ! A TOST (voir plus loin ) il n’y avait aucun service médical. Un jour, au cours de la promenade hebdomadaire, la colonne de prisonniers passait devant l’auberge très avenante du village, au pied du château-fort, lorsque le major Von Grosbois, un peu éméché, an compagnie de plusieurs autres officiers dont celui de 1’ABWEHR sortit de l’auberge en s’écriant " Vive Messieurs les Français ". Le lendemain, il avait définitivement disparu de la scène et la discipline devenait plus sévère, mais c’était encore du "pain blanc". Comme il n’y avait pas encore de bibliothèque -française- dans ce camp improvisé, on pouvait acheter, dans la librairie existante de l’auberge de jeunesse, des cartes postales, des livres d’art en allemand, cahiers, crayons, etc. avec nos lagermarks (monnaie du camp). Dans les camps suivants, il existait des bibliothèques envoyées de France de plus en plus fournies, et à MARSCH-TRUBAU et l’oflag IV D, fonctionnaient de véritables universités. En août 1940, libération des prisonniers anciens combattants de la guerre 1914-1918. Cadeau obtenu par le Maréchal Pétain. En effet, on voit difficilement ce qui aurait pu contraindre Hitler à le faire puisque la France payait de lourdes "réparations" et les frais d’entretien des prisonniers ! OBERLANGENDORF- Haute Silésie En août 1941, transfert dans ce camp peu éloigné d’Eulenberg (6km), mais dans la plaine. Ancienne résidence épiscopale du XVIIIème siècle, avec un beau jardin. Nous étions plus confortablement logés et, grâce aux colis de prisonniers, expédiés par les familles (et aussi par la Banque qui n’oubliait pas ses prisonniers) convenablement nourris, mais plus de sorties à l’extérieur. Plusieurs souvenirs, entre autres, s’attachent à ce camp au total sympathique. Après l’évasion du Général GIRAUD les appels de jour et de nuit se mul tiplièrent, les fouilles aussi et l’on nous laissait "poireauter" parfois longtemps à l’extérieur. Mais tout cela n’était pas m6chant. En mars 1942, il y eut une première tentative d’évasion de trois prisonniers entraînés par le fils du Professeur Richet de la Faculté de Médecine de Paris. Richet que je connaissais très bien, mesurait 2,10m et ne pas supportait la captivité. Il avait observé qu’une rivière s’écoulant à 1’extérieur de la clôture du camp, passait ensuite sous le bâtiment des W.C. Il en conclut fort justement qu’il y avait là une possibilité de sortie vers l’extérieur. Avec le concours de deux camarades, il descellait un W.C., agrandissait le trou pour y passer. Effectivement il réussissait son projet (en rebouchant chaque soir les travaux faits dans la journée). Malheureusement, c‘était le mois de mars, avec un froid de moins 10° à moins 20°. Ils sortirent par la rivière souterraine et s’enfuirent dans les forêts environnantes. Au bout de trois jours, les Allemands les retrouvèrent complètement épuisés et les ramenèrent au camp, sans trop les punir. Le projet était insensé en partant en cette saison pour une évasion aussi mal préparée. Dans ce camp, j’ai fait, au début de 1942, la connaissance du lieutenant Léonard RIST, venu d’un autre camp de la région militaire VIII. Il était le fils de mon ancien professeur de Droit International à la Faculté de Droit de Paris. Employé dans une institution internationale aux U.S.A., il était revenu en France, en 1939, pour la mobilisation générale. Il connaissait admirablement les U.S.A. C’est par lui que j’ai appris ce qui était en train de se passer de l’autre côté de l’Atlantique. Après l’entrée des U.S.A. dans la guerre, la victoire des Alliés était certaine, mais cela demanderait plusieurs années de préparation. C’est lui qui m’a fait connaître l’influence prise par le Général de Gaulle à Londres et la réalité de la résistance en France. C’est à partir de 1942 et surtout de 1943 que l’état d’esprit des prisonniers français a changé dans les camps. Au début de 1942, une sentinelle allemande, s’est suicidée dans son mirador juste en face de notre chambre en se tirant une balle dans la bouche. En parlant à des sentinelles, j’ai vite su qu’il devait incessamment partir pour le front russe. L’hiver 1941-1942 fut extrêmement froid en Silésie (comme ailleurs) avec de grandes chutes de neige. MAHRISCH-TRUBAU Moravie Sudètes En juillet 1942, regroupement des oflags VIII A, VIII F, VIII H/Z, VIII H et VIII G à Mährisch-Trübau, pour libérer le personnel de garde et l’envoyer au front. Ancienne école de sous-officiers tchécoslovaques, construite par la France peu de temps avant la guerre, elle était constituée par un grand bâtiment moderne fonctionnel, dans un état impeccable (Bloc I) complété par une série de baraques (Bloc Il) avec grands dégagements pour activités sportives. Il y avait même une piscine en plein air. C’était un camp important avec une intense activité sportive, folklorique, d’enseignement artistique, scientifique, etc. Il s’était formé un C.E.S. d’officiers prisonniers, autorisé à délivrer des diplômes, dont le corps professoral comptait plus de 40 membres, avec des ingénieurs des mines, 4 ou 5 polytechniciens, autant d’Art et Métiers, magistrats, banquiers, docteurs en droit, professeurs de langues, de philosophie etc. . J’en faisais également partie et j’ai fait des conférences sur la Banque de France et sur la nouvelle législation bancaire de 1941. J’avais déjà fait une série de conférences sur la Banque à Oberlangerdorf. On avait même constitué un groupe spécial Banque et Bourse ( voir en fin de récit)- La Banque m’avait nommé, pour ordre et pour après mon retour en France, à la Commission de Contr6le des Banques, créée en 1941 sous la direction de Monsieur SEBILLEAU, Inspecteur Général, qui en 1929 m’avait obligé à me présenter à l’Inspection (je voulais d’abord terminer ma thèse sur les banques alsaciennes en pleine crise) et avec qui j’avais effectué trois grandes enquêtes en 1936. Cette nomination me remplissait de joie et j’entreprenais l’étude dans tous les détails de la nouvelle législation bancaire qui constituait un progrès considérable sur l’état d’anarchie antérieure. Sans me vanter, après mes conférences sur la Banque de France, beaucoup d’auditeurs même fort cultivés sont venus spontanément me dire combien l’histoire de la Banque avait été riche et mouvementée, combien ses activités étaient nombreuses et essentielles (pour beaucoup elle imprimait les billets de Banque). De mon côté, grâce à d’autres conférenciers traitant de leur milieu professionnel, je me suis rendu compte - dans la misère de la captivité ce que signifie un Etat civilisé, de droit et d’ordre, mais aussi de sa fragilité. J’ai aussi appris de façon approfondie l’anglais et commencé l’étude du russe, mais vite abandonnée. A Märhrisch-Trübau et plus tard à l’oflag IV D qui, à bien des égards, se ressemblaient, j’ai lu des centaines de livres anglais (dans le texte), allemands et, bien entendu, français, écouté d’innombrables conférences sur les sujets les plus divers. Dans le Bloc I où je me trouvais, on était réparti par 8 à 10 en chambres séparées. Dès l’origine des camps, une grande solidarité s’était formée dans les divers groupes et le partagé intégral et impartial des vivres reçus des Allemands et des colis reçus de France, était la règle absolue. Il ne faudrait pourtant pas conclure au caractère idyllique de ce genre de vie. La prolongation indéterminée de la captivité, le manque de liberté, la promiscuité jour et nuit, avec les mêmes personnes, l’isolement absolu pendant des années, derrière des barbelés, le sentiment de tourner indéfiniment en rond dans un espace strictement délimité, l’incertitude de l’avenir, enfin et surtout la séparation avec la famille et tous les êtres chers en France, vers qui allaient nos pensées jour et nuit, faisaient que, pour tous, le temps de captivité paraissait infiniment long et éprouvant. C’est d’ailleurs à Märhrisch-Trübau qu’a eu lieu le premier suicide par désespoir d’un officier prisonnier qui s’est jeté par la fenêtre du 2ème étage (il y en aura 5 autres dans les camps ultérieurs). Seul un travail acharné et une discipline corporelle très stricte permettaient de se maintenir en bon équilibre moral et physique. Avec mes camarades, je m’astreignais tous les jours à une marche d’au moins deux heures, le long des barbelés, et je m’imaginais sur une carte imaginaire, me rapprocher d’autant de la France et de ma famille réfugiée à Blois où ma femme se trouvait avec mes deux jeunes garçons nés en 1937 et 1940. La situation au camp de Märhrisch-Trübau s’est brusquement tendue durant l’été 1943, d’abord lors d’un incident qui a eu lieu au moment de la visite de l’ambassadeur SCAPINI, qui a été vivement contesté par les prisonniers partisans du Général De GAULLE, mais beaucoup plus encore, quelque temps après, à la suite de l’affaire ci-après. De l’autre côté des barbelés courait un chemin de ronde emprunté par les sentinelles. Un jour, lors d’une promenade, je fus témoin direct de l’incident suivant : un soldat allemand armé poussait devant lui, sans ménagement, deux femmes pauvrement vêtues, en fichu et un petit balluchon sur l’épaule. Il s’agissait manifestement de paysannes polonaises ou ukrainiennes transférées d’une ferme à l’autre. Un de mes voisins se mit à insulter bruyamment le soldat, en criant "Lumpenvolk" (peuple de chiffonniers, canailles, racaille.). L’allemand alerta immédiatement le mirador le plus proche; celui-ci téléphona à la kommandantur qui, en quelques minutes, dépêchait sur place, un officier avec un peloton de soldats. Mais l’alerte avait été donnée et tout le monde s’engouffrait en vitesse dans le grand bâtiment où le densité de prisonniers rendait vaine toute recherche. Ordre de rassemblement immédiat au dehors, menaces de sanctions collectives si le coupable ne se dénonçait pas etc. Pas de succès... Le lendemain, visite d’un général S.S. Nouvel appel très prolongé et nouvelles menaces. Sans succès . . . . , mais des fouilles incessantes, des appels mouvementés. C’est cet incident qui a déterminé les Allemands à nous transférer au camp de Tost. L’autre raison est d’ordre matériel. A notre arrivée, le grand bâtiment-école se trouvait dans un état impeccable. Au bout d’un an, les murs des couloirs et des chambres étaient noirs de suie. Les Allemands nous distribuaient bien des pommes de terre en robe des champs, mais froides et rien pour les réchauffer et les préparer. Des centaines de popotes se mirent donc a fabriquer des "cubilots" avec des boîtes de conserves, véritables oeuvres d’art, qu’il fallait alimenter avec des boules de papier séché, de carton et des bouts de bois quand on avait la chance d’en ramasser. Aux heures des repas, l’atmosphère des couloirs et chambres devenait opaque et irrespirable, tant la fumée était dense. En voyant la noirceur des murs, le général S.S. s’écria :"Schweinerei Schweinerei" (cochonnerie). Avant notre départ pour Tost, les Allemands nous ont retenu, sur nos lagermarks, l’intégralité des frais de réparation. Il faut ajouter qu’à ce moment-là, on ne pouvait plus rien acheter avec cette monnaie.
Ancienne prison (maison d’arrêt régionale), dont j’ignore l’affectation avant notre arrivée, mais ce n’était certainement pas un camp d’officiers (oflag). Grande bâtisse vétuste du XIXème siècle, au milieu d’un terrain entouré de hauts murs (3 à 4 m) renforcés de place en place de miradors. Barreaux de fer épais aux fenêtres, couloirs étroits sur lesquels donnaient les cellules. Dans chacune d’elles, deux à quatre lits superposés à deux places suivant la place disponible, c’est-à-dire que l’on était serré à l’extrême. Plus de bibliothèque ni de salle de conférence. Des étages supérieurs, on avait une vue directe sur la rue principale de la petite localité où il ne se passait d’ailleurs rien. Triste Noël 1943. Hiver extrêmement froid mais le moral était élevé. Depuis l’échec de l’offensive allemande devant Leningrad, la capitulation du Maréchal PAULUS à Stalingrad et le début des combats en retraite de Russie, on sentait un changement radical de la situation militaire. On attendait le débarquement allié pour le printemps et l’effondrement du Reich dans un délai beaucoup rapproché qu’il n’a eu lieu en fait. Le camp de Tost a laissé, dans l’ensemble, un souvenir détestable, mais par la suite, il y a eu des périodes bien plus pénibles. Le changement de camp a entraîné pour plus d’un mois la suppression des colis venus de France. Comme le camp de Tost n’existait pas avant notre arrivée, je suis persuadé que les centres de tri de ces colis n’en connaissaient pas l’existence et ont dirigé les nôtres sur l’oflag VI (situé à SOEST) avant de les réexpédier sur Tost. Sans cet appoint de nourriture, nos rations descendaient du jour au lendemain de 2.000 calories à moins de 1.800. A partir du camp de Tost jusqu’à la fin de la captivité, des récriminations incessantes eurent lieu sur la quantité et surtout la qualité de la nourriture fournie par les Allemands. La convention de Genève stipulait que le nombre de calories de la ration minimum ne devait pas être inférieure à 1.800 calories par jour. Parmi nos camarades médecins, de nombreux spécialistes mesuraient et évaluaient fréquemment la composition et la valeur des aliments distribués. Elle n’atteignaient même pas 1.500 calories. Il faut ajouter que jusqu’au mois d’octobre, les pommes de terre distribuées dataient de la récolte de l’année précédente. Au fur et à mesure que le temps passait, elles devenaient de plus en plus noires et immangeables, mais étaient comptées pour leur nombre de calories théoriques. La "viande" consistait en un morceau de saucisson fait de viande de chiens engraissés (masthunde), les chiens engraissant plus vite que les porcs. Nous étions soumis à un "régime sévère" avec parfois un seul repas par jour, et quel repas ! des appels interminables dans la neige et le froid. Notre séjour n’y a duré heureusement que 4 mois. Le 15 avril 1944, notre départ de Tost pour le camp IV D, départ entraîné par l’avance des troupes russes, a eu lieu dans des conditions mémorables. Appel dans la cour à 6 heures du matin dont je me souviens d’autant mieux qu’à l’appel de mon nom "Oberleutnant KLEIN" prononcé à l’allemande, je n’ai pas bougé, ni au second. Au 3e appel je m’avance tranquillement en disant que je m’appelais KLEIN prononcé à la française. L’officier allemand faillit attraper une attaque. Ceci simplement pour caractériser la situation tendue entre les gardiens et nous. A la gare, les S.S. nous obligèrent à enlever nos chaussures et nous poussèrent dans des wagons à bestiaux où des soldats allemands nous passaient des menottes aux poignets, ce qui ne s’était jamais fait jusque là. Je dois dire que l’armée allemande régulière nous a toujours traités convenablement (je ne parle pas de la nourriture). A la gare de Tost, beaucoup de trains militaires venant du front ou se dirigeant vers l’est, passaient à côté de notre train qui resta immobilisé durant plusieurs heures. Les troupes allemandes étaient abattues. Ostensiblement, je leur montrais mes menottes. Gênés, tous détournaient le regard. Dans chaque wagon de notre train, il y avait des sentinelles armées. Au bout d’un quart d’heure, j’avais trouvé le moyen d’enlever mes menottes et mes compagnons en faisaient autant. Les sentinelles n’ont aucunement réagi. OFLAG IV D à HOYERSWERDA (100km au nord de DRZSDE)
Immense camp existant depuis 1940, composé d’une douzaine de grandes baraques en bois de chaque côté d’une large allée centrale. Double enceinte de barbelés électrifiés avec miradors, tous les cinquante mètres. Sas d’entrée et de sortie à chaque bout de l’allée centrale avec poste de garde important. L’oflag IV D s’était distingué, en 1941, (bien avant notre arrivée) par une évasion spectaculaire. Dans le plus grand secret, 30 officiers (toute une "section") s’étaient confectionné des uniformes allemands teintés en feldgrau dans des draps de lit et autres tissus et fabriqué des casques allemands an carton-pâte, parfaitement imités. En plein jour J, la colonne s’était mise en marche dans la grande allée centrale du camp sous le commandement de l’un d’eux qui hurlait les ordres, tout à fait à la prussienne. Arrivés devant la grille d’entrée (les "sas" n’existaient pas encore), il ordonna aux sentinelles d’ouvrir la porte, ce qu’elles firent aussitôt, tant les apparences de la régularité étaient respectées. Une fois dehors et hors de vue, la troupe se dispersa, passa toujours en uniforme les montagnes séparant le Brandebourg-sud de la Slovaquie. De là, ils passèrent par la Hongrie jusqu’en Bulgarie, pays qui n’était pas en guerre. Pour arriver jusque là, fait extraordinaire, chaque petit groupe s’adressait exclusivement dans les églises aux prêtres catholiques, en leur demandant sous le sceau de la confession aide et renseignements Aucun de ceux-ci ne les a trahis, mais secourus de leur mieux. En Bulgarie, après s’être déclarés, ils ont été internés, mais dans des conditions infiniment meilleures qu’en Allemagne. Avec les 1.200 prisonniers arrivant de Tost, l’effectif s’est élevé au camp IV D à quelque 6.500 officiers prisonniers. Paysage : plaine de Saxe absolument plate sans abri ni relief. Localité : HOYERSWERDA, invisible, à 2 ou 3 km du camp. Tous les prisonniers de Tost appréciaient, comme il convient, le retour dans un camp organisé de longue date, doté d’une université, d’une bibliothèque, de salles de conférence, de lieux de culte (catholique et protestant) absolument remarquables. Parmi tant de prisonniers, on trouvait d’éminents spécialistes dans tous les domaines imaginables : scientifiques, littéraires, artistiques, etc. Les prisonniers venus de Tost étaient cependant les plus montés contre les Allemands par ce qu’ils avaient enduré dans ce camp. Dans la baraque voisine de la mienne, un certain nombre d’officiers commençaient à préparer une grande évasion. Ayant décloué les planches du sol de la baraque, ils se mirent à creuser avec de simples cuillères, un boyau permettant à un homme de passer. La distance jusqu’au réseau de barbelés entourant le camp était d’environ 25m auxquels il fallait ajouter la largeur du réseau de barbelés d’environ 8m; le tout, jour et nuit, sous la surveillance des miradors. Or, le sol était de sable peu consistant risquent de s’effondrer à chaque instant et d’ensevelir l’équipe en train de creuser à la lueur d’une bougie. De place en place, le boyau était étayé de planches des lits prises sur les couchettes superposées. La difficulté était d ‘évacuer le sable extrait et qui fut répandu au-dessous du plancher de la baraque. Chaque jour, il fallait reconstituer entièrement l’aspect des lieux parce que les fouilles étaient incessantes, mais en captivité, le temps ne compte pas ! Si incroyable que cela puisse paraître, ce travail périlleux avait progressé jusqu’à la ligne des barbelés qui non seulement étaient électrifiés mais comportaient en outre des postes d’écoute acoustique qui se sont déclenchés lorsque le boyau atteignit cet endroit. Ce fut un beau tollé dans le camp : enquêtes, fouilles, appels prolongés à l’extérieur à titre de sanction. Finalement la moitié des occupants de cette baraque furent envoyés au camp de représailles de STETIN sur la Baltique où se trouvait le propre fils de STALINE, un ivrogne et un propre à rien. Bientôt, on sut au camp IV D que la nourriture et le traitement dans ce camp dit de représailles étaient bien meilleurs qu’au IV B parce que la Croix Rouge Internationale réservait des faveurs spéciales à ces camps spéciaux. Voir ci-après mon séjour au camp de COLDITZ - Chaque baraque au IV D logeait 250 prisonniers en lits à 2 places. Le premier soin consistait à cloisonner l’espace intérieur grâce aux lits, en petites cellules de 8 à 12 personnes, effectif des diverses popotes dans lesquelles jouait une solidarité totale, sans oublier les inconvénients de la promiscuité, totale elle aussi. La liaison avec les autorités du camp était assurée par un "Conseil d’Administration" de 10 membres portés à 12 par l’entrée de 2 nouveaux membres représentant Tost. Par la "vox populi" (sans aucun vote), je fus désigné comme l’un des deux. Le Conseil était présidé par un inspecteur des Finances, De MONTREMY. Le rôle du Conseil était, en fait, moins que consultatif, mais la fonction revendicative et protestataire n’était pas négligeable. La nourriture "officielle" était la même qu’à Tost, mais les colis arrivaient régulièrement. Jusqu’à juillet-août 1944 où à la suite des destructions par les bombardements aériens, les envois de colis s’espacèrent de plus en plus jusqu’à leur disparition totale. A ce moment, les difficultés sérieuses ont commencé. Nous étions parfaitement renseignés sur l’évolution de la situation militaire. Les Allemands avaient installé des haut-parleurs pour la diffusion des ordres intéressant tout le camp et les communiqués du Grand quartier Général allemand. En dehors de cela, il existait au moins 5 ou 6 postes clandestins dont les informations étaient diffusées par relais à l’intérieur des baraques. Des fouilles, les plus acharnées, tout le monde dehors pendant des heures, n’ont jamais réussi à supprimer cette source d’informations. Il est vrai que, dans les grandes occasions, on sacrifiait volontiers un ou deux récepteurs, aussitôt remplacés par des spécialistes qui ne manquaient jamais. Des spécialistes, il y en avait de toute sorte. Des décorateurs avaient aménagé (comme déjà à Märhrisch-Trübau) une belle chapelle avec un autel au-dessus de tout éloge et des vitraux que le maître verrier Max INGRAND avait exécutés à l’aide de cellophanes de couleur des colis. Il y avait aussi une petite chapelle pour les protestants. A ma connaissance, depuis le début de la captivité, tous les prisonniers assistaient régulièrement aux offices et cérémonies religieuses avec beaucoup de ferveur. Le camp IV D comptait plusieurs dizaines de prêtres, officiers de réserve comme les autres et les messes se succédaient sans arrêt. A Pâques et à la Toussaint, les messes étaient parfois célébrées à l’extérieur des bâtiments. J’étais très lié avec l’un de ces prêtres, l’Abbé Gilles BARTHE. Avant la guerre, professeur de philo et directeur diocésain des oeuvres catholiques du Tarn. Il nous a fait tout un cours de philosophie très remarquable et un jour, je lui ai dit que ‘si j’étais pape, je le nommerais Evêque'. Il a pris la chose plutôt mal, ce qui ne l’a pas empêché, quelques années après la libération, de devenir Evêque de Monaco (où il a célébré le mariage du Prince avec Grâce Kelly), puis de Toulon-Fréjus (l’atmosphère de Monaco lui déplaisait souverainement). L’hiver 1944/1945 a été extrêmement froid. Pendant tout le mois de janvier 1945, le thermomètre descendait à moins 30° la nuit pour remonter, à midi, à moins 10°. Quand il s’est enfin fixé à zéro degré, on a eu vraiment chaud et l’on s’est débarrassé des manteaux et pulls. Pour le chauffage des baraques, on n'avait que deux seaux de lignite par jour, la chaleur animale faisait le reste. En février 1945, devant l’avance de l’armée russe, le camp fut dispersé en plusieurs détachements. Il ne restait sur place que 600 officiers environ, considérés comme inaptes à la marche. Je faisais partie de la colonne d’environ 3.000 à 3500 officiers dirigés sur le camp de COLDITZ, à 190 km à l’ouest de Hoyerswerda, trajet entièrement fait à pied, dans les pires conditions de fatigue et de dénuement, encadrés par des S.S. hongrois qui traitaient sans ménagement les retardataires complètement épuisés, mal nourris, passant les nuits à même le sol dans des hangars, des fermes etc. J’ai dû abandonner en cours de route tout ce que je portais sur moi linge, couverture, jusqu’au missel et une collection inestimable et unique en son genre de lagermarks (monnaie de camp) que j’avais eu beaucoup de peine à réunir pendant les années de captivité. Mais c’est incroyable ce que le moral permet de taire dans de telles circonstances ! Souvent notre colonne croisait des colonnes de réfugiés civils allemands, chariots chargés de femmes, d’enfants, de literie, un spectacle tout à fait semblable à celui des réfugiés sur les routes de France en juin 1940. Dans les localités traversées, la population qui restait et jusqu’aux écoliers, creusait des tranchées, charriait des munitions etc. La panique était générale et renforcée par des placards omniprésents, avec le slogan "Siegen oder Sibirien’ (vaincre ou la Sibérie) Je ne me rappelle plus au bout de combien de jours nous arrivâmes à Colditz, qui nous apparut comme un havre de paix et de sécurité. COLDITZ. Oflag IV C - fin février au début avril 1945 En Saxe occidentale, à environ 10/15 km à l’ouest de l’Elbe. Grand château fort du Moyen-Age (genre Haut Koenigsbourg en Alsace) , mais sur une colline moins élevée qu’en Alsace, puissamment fortifié. Ce camp servait de lieu de détention à des prisonniers-otages parmi les plus précieux que les Allemands avaient réussi à capturer (le Comte Lascelles, neveu de la Reine d’Angleterre, Randolph, le fils de Churchill, des aristocrates anglais, des aviateurs anglais, américains, canadiens, le Général Bor, héros de la résistance polonaise, etc. ) Tout ce beau monde, au total environ 200 personnes, était royalement installé dans les immenses pièces du château. Au moment où notre colonne affamée, loqueteuse, épuisée, arrivait à Colditz, chacun des occupants antérieurs possédait une armoire pleine de conserves, de chocolat, de café, de cigarettes, etc., car le camp considéré comme "camp de représailles" était particulièrement soigné par la Croix Rouge. La première mesure prise fut de partager le camp en deux, une moitié pour les "200 familles", l’autre pour les 3.500 officiers français, chacun de ceux-ci recevant un emplacement au sol de 2 mètres carrés, bien entendu, sans lit ni couverture ni quoique ce soit d’autre. Je n’oublierai jamais d’avoir assisté, un soir, le ventre creux, à la préparation du dîner par le Comte Lascelles lui—même et ses intimes, avec des pommes de terre (fraîches) sautées au lard et tout ce qu’il fallait pour un repas simple, mais substantiel. Du côté français, la situation était dramatique. Près des poubelles, il y eut des bagarres autour des tas d’épluchures de rutabaga. Pour s’alimenter coûte que coûte, de nombreux prisonniers assaillaient sans cesse les gardiens allemands, en leur proposant tout ce qu’ils possédaient (alliances comprises). Pour les autorités allemandes, comme pour les prisonniers anglais, la conduite des officiers français -c’était d’ailleurs mon avis en partie- manquait de dignité et devenait choquante (chocking) et intolérable. Car avant comme après notre passage au camp, tout se passait à merveille du coté anglais. Un des gardiens allemands m’a expliqué le système, en me demandant d’intervenir pour essayer d’appliquer une méthode analogue pour les prisonniers français. De longue date, les Anglais avaient chargé un seul des leurs de traiter avec un seul allemand, tout le monde feignant d’ignorer ce qui se passait à l’ombre. Le café, nescafé, chocolat, cigarettes américaines s’échangeaient, à un cours fixé d’un commun accord, contre des pommes de terre, des fruits et des légumes et tout ce que les Anglais pouvaient désirer (à l’exception évidemment des récepteurs radio et de matériel d’évasion). Du coté français, on avait rien à offrir. Dans ces conditions, il était inévitable que le pire allait se produire entre les deux groupes de prisonniers. L’incident majeur éclata en mars 1945, alors que fut annoncée l’arrivée d’un wagon chargé de vivres de la Croix Rouge à la gare proche du camp. Un immense espoir s’était aussitôt levé chez les prisonniers français de voir leur cauchemar prendre fin. Avant d’en arriver là,, il faut insister sur l’exploit que représentait le fait d’avoir fait parvenir de Suisse à Colditz un wagon destiné à un oflag quand on songe aux effroyables destructions que l’aviation alliée avait causées dans la quasi totalité de l’Allemagne, à quelques mois de la capitulation. Contrairement aux déclarations de "camaraderie de combat" faites à notre arrivée, les Anglais opposèrent un refus catégorique à partager quoi que ce soit du wagon de vivres "qui avait été expédié, bien avant notre arrivée, à leur camp tel qu’il fonctionnait à ce moment-là". Des négociations orageuses eurent lieu à la suite desquelles le Colonel commandant la partie française, réunissait tous les officiers français pour leur expliquer la situation. De son exposé, je n’en retiendrai qu’une phrase : " J’avais cru avoir à faire à des gentlemen, je n’ai rencontré que des marchands ! " (Après la guerre, les Anglais ont publié un livre dithyrambique, qui a donné lieu une série de films de télévision, sur les exploits (tentatives d’évasion spectaculaires) et le comportement héroïque de leurs chers prisonniers pendant leur captivité à Colditz. Sans nullement mettre en doute ni leur courage, ni leur patriotisme pendant cette période dont j’ignore tout, je crois pouvoir dire qu’ils se sont conduits vis-à-vis de nous comme les derniers des "salauds’. Dans le livre en question, les cinq semaines de "cohabitation" sont passées pratiquement sous silence. La suite n’a pas traîné. Puisque les Français étaient manifestement trop mal logés et qu’ils étaient "invivables’ aux yeux des Allemands comme des Anglais, le mieux était de faire partir la moitié d’entre eux, le plus tôt possible, vers un autre camp. C’est ainsi que le 9 avril 1945, environ 2.000 officiers français, dont je faisais partie, prirent la route, à pied, pour le camp de Zeithain, vers l’est, situé à prés de 10 km de Riesa sur l’Elbe, à l’est de ce fleuve qui, peu de temps après, deviendra la frontière entre deux mondes. Si la distance à parcourir n’était pas bien grande, la marche sur 20 à 30 km n’était pas moins pénible. ZEITHAIN - du 10 au 24 avril 1945 - Grand camp composé de baraques pourries, sales, dans lesquelles il pleuvait. Outre celles qui nous étaient réservées et qui étaient séparées des autres par des barbelés, il y en avait, à une distance de 20 à 30 mètres, de nombreuses autres où étaient hébergés les survivants du ghetto de Varsovie, au nombre d’un millier environ, vieillards, femmes et même quelques enfants. Nourriture très insuffisante et détestable. La situation devenait si critique et dangereuse qu’à partir du 20 avril et jusqu’au 29 mai 1945, j’ai pris des notes au jour le jour que j’ai mises au net pendant mon séjour à Bunzlau, je n’avais jamais pris de notes auparavant. Je les résume de la manière suivante : 20 avril : anniversaire de Hitler. Très gros bombardement américain d’un dépôt de munitions situé à 3km du camp et sur la gare de Zeithain, explosions formidables qui se succèdent jusqu’à 3 heures du matin le lendemain. 21 avril : Dans la journée, pas d’appel. Les officiers allemands quittent clandestinement le camp, ne laissant qu’une garde réduite qui se retire discrètement pendant la nuit suivante. Le camp s’organise en "unités de combat-sans armes-. Je suis désigné, à toutes fins utiles, comme interprète d’allemand, le lieutenant de Lipski (d’origine polonaise) comme interprète pour le russe. Toute la journée, d’interminables colonnes de réfugiés allemands passent à proximité du camp. 22 avril : Au réveil, plus de garde allemande. Drôle d’impression pour des prisonniers pendant cinq ans. Les contacts s’organisent avec les groupes voisins russes (350 travailleurs, nombreux malades), avec les polonais de Varsovie (environ 1.000 hommes, femmes et enfants en état pitoyable), avec le groupe italien (environ 1.700 dont beaucoup malades). Les quelque 1.700 italiens internés dans ce camp étaient d’anciens soldats ou travailleurs qui, après la défection de l’Italie, avaient refusé de combattre ou de travailler pour l’Allemagne et qui étaient aussi maltraités que les Polonais de Varsovie. Le Colonel Gaillard prend le commandement de l’ensemble (2.000 officiers + 3.000 étrangers). Pillage de dépôts allemands : chaussures, linge de mauvaise qualité, dont les prisonniers n’avaient jamais rien perçu. Réserve 4 jours de vivres —pommes de terre uniquement - Le soir, les combats se rapprochent, passage de chars allemands, tirs de mitrailleuses toute la nuit. 23 avril : A l’aube, vers 4 ou 5 heures du matin, apparition de nuées de cosaques appuyés de chars russes (1er corps automécanisé de Sibérie dit "Garde de Staline"). Petits chevaux rapides, toujours au trot vif. De nombreux cosaques viennent au camp. Une sentinelle allemande qui ne s’était pas sauvée et s’était cachée dans une dépendance du camp, fut découverte et séance tenante abattue par une rafale de mitraillette d’un cosaque. Leurs officiers sont des russes blancs, tous très grands en uniformes impeccables. Nous avions la chance d’avoir parmi nous un lieutenant nommé Lipski, agrégé de littérature, un homme de grande culture, d’origine polonaise et qui parlait parfaitement la langue russe. Auparavant il nous avait fait des cours de littérature anglaise de haut niveau suivis par de très nombreux auditeurs au camp IV D . Au moment de l’arrivée des Russes et pendant tout le trajet, il nous a rendu de grands services. En 1988, j’ai appris, par le Figaro, son décès alors qu’il était devenu un personnage important dans les services des Nations Unies à New-York. Toute la matinée, défilé ininterrompu d’unités d’artillerie, de cavalerie cosaque, de colonnes de ravitaillement. Vers 7 heures du matin, passage des premiers prisonniers allemands, suivi du reflux de colonnes de réfugiés allemands qui n’avaient pu passer l’Elbe au pont de bateaux ou au bac de Strehla à 5 km du camp. Des colonnes de déportés polonais commencent a se former et à partir vers l’est, avec les attelages et les chargements des réfugiés allemands qui en sont dépouillés. A 8 heures, passage de femmes ukrainiennes ou juives polonaises (Varsovie) qui avaient bivouaqué depuis janvier, en plein air, dans un petit bois à 300 ou 400 mètres du camp. Figures rendues méconnaissables par la crasse, la maladie et la sous-alimentation. Je m’entretiens avec deux d’entre elles, d’un excellent milieu, parlant un très bon français. Vers 17 heures, un fort groupe de soldats allemands (chars et infanterie) qui n’avait pu passer l’Elbe se retranche dans un petit bois à 1 km du camp. Les Russes n’arrivent pas à les réduire. Une heure plus tard, les Allemands essaient de s’emparer du camp, mais un "orgue de Staline", arrivé entre temps, réussit à les anéantir. Peu à peu, on arrive à mieux connaître la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous avons été libérés par l’extrême pointe de l’avance russe. Après la percée réussie après de durs combats à Spremberg-Forst, la cavalerie russe et quelques régiments de chars ont foncé rapidement à 100 km de là, jusqu’à l’Elbe, mais laissant en derrière eux de nombreuses unités allemandes. A 20 heures, l’ordre arrive pour tous les occupants du camp de se replier d’urgence vers l’est. Départ précipité, mais en bon ordre, à pied. Toute la nuit, tirs saccadés, à droite et à gauche, lueurs d’incendie partout à l’horizon, des Cosaques mettent le feu à tous les villages. Dans une forêt, des femmes allemandes se terrent, une jeune femme pleure son bébé mort dans sa voiture d’enfant, etc. Vers 1 heure du matin, arrivée à Gröditz où nous passons la nuit, mais la colonne s’étend déjà sur des kilomètres. 24 avril : 9 heures, départ de Gröditz, jolie petite ville qui n’a pas souffert. Vers midi, arrivée à Elsterwerda, traces de durs combats dans toute la ville. Pont détruit. Tous les autres villages traversés abîmés et pillés. Vers 17 heures, passage à Plessa, où une femme allemande nous sert pain, lard et café. Le long de la route de Plessa à Muckenberg, nombreux cadavres S.S. allemands, déchaussés, tenant encore leur pantalon sans bretelles. Dans une grande ferme, un sous-officier du ravitaillement russe fait emmener porcs et gros bétail, en menaçant la seule jeune femme présente, la propriétaire, de l’égorger si elle ne lui cède pas la nuit suivante. Le lendemain, on apprend que Plessa a été attaqué pendant la nuit par un groupe de 20 chars et 300 S.S. allemands qui ont massacré tous les ex-prisonniers russes qui sont tombés dans leurs mains et emmènent quelques camarades français, relâchés par la suite. LANCIEUX, fatigué, était resté à Plessa, tandis que j’avais poursuivi ma route jusqu’à la localité suivante. 25 avril : trajet Muckenberg-Senftenberg (25km). Nous longeons les grandes usines de Schwarzheide, avec de belles cités ouvrières, toutes abandonnées et pillées. Avant d’arriver à Schwarzheide, énormes usines de lignite en feu. Grosse briqueterie. Maisons luxueuses des directeurs et chefs de service, pillées en partie. 26 au 28 avril : Séjour à Senftenberg sur l’ordre des autorités russes qui ne savent pas encore où nous diriger. Distribution d’un pain russe par prisonnier jusque-là nous avons vécu exclusivement sur le pays. Dans une maison de Senftenberg, j’ai découvert, dans la cave, 2 bouteilles de cognac français, des stocks de draps, de linge, de chaussures, de nombreux insignes hitlériens. C’était le logement d’un nazi important que je fais visiter aux femmes restées sur place. Le séjour à Senftenberg s’explique aussi par la situation militaire non encore stabilisée de la région. Kamenz, à une trentaine de kilomètres au sud, change plusieurs fois de main, la région est infestée de groupes allemands isolés. Seuls les grands axes sont à peu près assurés. Passage incessant de colonnes russes, énorme matériel d’artillerie, chars, unités de cosaques, etc. Dans les clairières des forêts, nous croisons des voitures typiques de cosaques avec leurs femmes et parfois des enfants qui suivent leurs maris une vingtaine de kilomètres derrière le front. Le 26 avril, 6 italiens indisciplinés qui ne se rangeaient pas assez vite devant un convoi d’artillerie russe, sont tués sur le coup et de nombreux autres blessés. Le 28 avril, trois femmes et plusieurs enfants habitant la maison où nous sommes installés, rentrent d’un exode très pénible, le mari de l’une d’elles a trouvé la mort dans l’affaire de Flessa. Les russes faisaient la chasse aux femmes pour les violer, celles-ci très apeurées se regroupent pour la nuit dans une pièce, condamnée par celle ou nous couchons. Irruption de soldats russes pendant la nuit, nous réussissons à les repousser. De tels incidents se sont produits plus d’une fois le long de la route. Les femmes nous suppliaient de les protéger. Je ne connais aucun cas où les officiers français n’aient assuré cette protection. Après 5 ans de captivité, nous ressentions un grand respect pour les femmes, fortement idéalisées. 29 avril : étape Senftenberg-Jessen : - 20 km. 30 avril : étape Jessen-Spremberg-Wolfshaür 29 km. Spremberg, centre des combats de la percée russe, ville terriblement abîmée. Wolfshaür, petit hameau envahi par une foule énorme de toutes nationalités, sans cesse grossissante par l’afflux de nombreux travailleurs ou prisonniers. 1er mai : étape Wolfshaür-Muskau-Priebus -30 km. Les vivres de route commencent sérieusement à manquer. Les maisons visitées pour se ravitailler ont toutes été déjà fouillées, de nombreuses fois avant notre passage. Muskau, totalement détruite. Après Müskau, route de corniche dominant une immense vallée remplie de fumée ; il s’agit d’une usine de lignite en feu. Les installations ont plusieurs kilomètres de long. A Priebus, arrêt pour la nuit dans une maison abandonnée et pillée, comme tout le village, et occupée par de nombreux polonais et italiens. Dans une pièce infecte, un jeune polonais est en train d’agoniser, sans que personne, dans le tohu-bohu général, ne s’en occupe. D’ailleurs, il n’y a ni service médical, ni service de ravitaillement, ni aucune liaison avec quiconque. Aucun secours à attendre pour les malades. Atmosphère incroyable, correspondant peut-être à certaines époques des grandes invasions du Moyen-Age. Une jeune femme polonaise trouve un italien à son goût et passe la nuit avec lui. 2 mai : il pleut et il neige. Je suis très fatigué et reste à Pribus. 3 mai : Priebus-Saran-Saqan-Petersdorf -35 km. Départ, seul, à 3 heures du matin. Miraculeusement, je rencontre vers 10 heures, sur la route, un groupe de trois soldats français qui descendent de la région de Cottbus. Ils avaient déniché un cheval blessé au pied et une charrette. Ce sont le brigadier Autechaud Louis, de Nanterre, les soldats Dumery Albert, d’Orléans et Gondouin Etienne d’Avignon. Très débrouillards, joyeux lurons, ce sont d’excellents compagnons de route. Ils possèdent des provisions : pain, bocaux de conserve, légumes, etc. Ils ont même un appareil photo. C’est pourquoi, chose incroyable, je possède une photo envoyée, après mon retour, de notre attelage où je figure, très amaigri, ne pesant sans doute à ce moment, pas plus de 35 kg. Arrivée à Sagan, au début de l’après-midi, ville presque entièrement détruite; on nous avait indiqué, plus ou moins clairement, Sagan comme terminus ; mais une rue de la ville désignée comme "concession française" est archi-comble et l’on nous oblige à nous diriger plus à l’est jusqu’à Bunzlau. Arrêt, le soir, à Petersdorf, 5 km de Sagan, dans une maison pillée de fond en comble. Arrivée vers 21 heures, dans cette localité, d’une colonne d’environ 3.000 prisonniers allemands. Gardes russes assez débonnaires. Nombreuses occasions de fuite dont aucun ne cherche à profiter -abattement, fatigue, peur des russes-. Ils n’ont surtout pas la mentalité de vieux prisonniers, tout comme nous en 1940. 4 mai : Petersdorf-Sprottau-Oberleschen 22 km Gros convois militaires vers l’ouest - colonnes interminables de civils polonais, russes, etc. travailleurs dans les usines et les fermes, d’ex-prisonniers vers l’est. Sur les quelque 20 millions d’étrangers envoyés de force dans le Reich, russes et polonais refluent maintenant vers l’est, consommant, pillant et cassant tout sur leur passage. De leur côté les soldats russes que nous rencontrons, délestent à leur tour les prisonniers français de leurs montres, souvent des alliances, même des ceinturons. Des scènes cocasses se produisant : parfois certains soldats ou travailleurs français exhibent leur carte du PCF, qu’ils avaient réussi à conserver dans les usines et les fermes, chose qui aurait été impossible dans un oflag, bien entendu sans le moindre succès. L’expression "nous", employée dans ce récit depuis le début, correspond à un petit groupe formé par le lieutenant Albert BERNARD de Suippes, décédé quelques années après la Libération, le lieutenant MOULIN, mon camarade LANCIEUX de la Banque et moi-même. La colonne des officiers français s’étirait peu à peu, sur des kilomètres, mêlée à des groupements les plus hétéroclites de travailleurs déportés en Allemagne, etc.. 5 mai : Oberleschen-Bunzlau - 25 km Au cours de cette ultime étape s’est produite une mesure très importante le tri, par les Russes, de la horde indescriptible qui refluait vers l’est. Dans une gare dont je ne me rappelle plus le nom, toutes les charrettes surchargées de butin : literie, linge, meubles, provisions, des Polonais et Ukrainiens rentrant dans leur pays qu’ils savaient dévasté, furent arrêtées et leurs occupants, hommes et femmes, dépouillés, entassés, sans ménagement sur des plates-formes ouvertes de wagons de chemin de fer qui n’étaient pas prêts à partir de suite. D’autres tris ont dû être effectués, car seuls les prisonniers français ont pu entrer à Bunzlau qui se trouve à 45 km à l’est de Görlitz. La ville, assez importante, avait été volontairement épargnée de tout bombardement ou incendie. C’était, après la retraite de Russie de Napoléon 1er, le siège du Grand quartier Général du Maréchal KOUTOUSOV. Il y est peut-être mort. Je ne me souviens plus exactement. Sa statue se trouvait devant la Mairie. Cela n’empêchait pas les soldats russes de commettre des vols individuels. Je me souviens d’avoir vu au cimetière de Bunzlau beaucoup de tombes fracturées pour voler les alliances en or. Les Russes ne s’occupant pas de notre ravitaillement en nourriture, la grande affaire quotidienne était de trouver des vivres. Les trois soldats français qui m’avaient recueilli sur la route de Sagan à Petersdorf, me sont restés attachés pendant le séjour à Bunzlau. Le matin, chacun de nous allait explorer les caves des maisons des différents quartiers. On y trouvait des pommes de terre, parfois des pots de confiture, rarement d’autres conserves. On se croisait dans les caves avec d’autres "chercheurs". Un jour, j’ai découvert une jeune femme seule, affamée, avec deux petits garçons, qui se terrait dans une cave et n’osait en sortir. Comme je parlais allemand, j’ai dû lui apparaître comme un sauveur, non seulement je l’ai respectée, mais pendant le reste de mon séjour, je l’ai approvisionnée aussi bien que j’ai pu. Les prisonniers français qui avaient dépassé Bunzlau ne purent plus revenir et furent dirigés sur Odessa et n’arrivèrent en France qu’au mois d’août. Ceux qui s’étaient arrêtés à Bunzlau, devaient rester groupés en cantonnements fixes. Un recensement individuel eut lieu, tant du côté du commandement français que de celui des Russes. Comme ceux-ci n’arrivaient pas à écrire mon nom prononcé, soit à la française, soit à l’allemande, je fus immatriculé sous le nom de "Kalinine" Des incidents semblables, parfois pires, eurent lieu pour des prisonniers s’appelant Martin ou Dupont. Les Russes, à la suite d’une visite éclair d’un aviateur français du groupe Normandie-Niemen s’étaient engagés à nous fournir un ravitaillement régulier. A part une distribution de pain pendant un ou deux jours, ils se désintéressaient complètement de notre sort ; pour les Russes staliniens, nous étions des déserteurs. Initialement, il y avait un cantonnement d’environ 1.100 soldate et sous-officiers dans une usine ; un autre de 380 officiers dans l’immeuble de la mairie dont le commandement me fut confié, avec le Lt. Moulin comme adjoint. Comme il en arrivait toujours d’autres, cette belle organisation ne résista pas longtemps et la débandade à la recherche d’un logement commença. D’ailleurs, la Mairie, intacte à l’extérieur, avait été complètement pillée et dévastée, mobilier cassé, renversé, papiers d’état civil, livres fonciers, recette municipale et autres services, répandus sur plus d’un mètre d’épaisseur sur la so1. À deux ou trois, nous essayons vainement, en travaillant du matin au soir, de sauver les pièces essentielles et de faire le nettoyage. Dans la nuit du 7 au 8 mai, violent incendie dans un grand immeuble de commerce de droguerie face à la Mairie, pour une cause restée inconnue. Beaux actes de courage de la part des Russes et des requis français : 8 officiers qui logeaient dans le magasin furent difficilement sauvés, 5 autres brûlés vifs devant de nombreux témoins impuissants. Dans la nuit du 8 au 9 mai, vers 1 heure du matin, éclatent brusquement des tirs de tous les soldats russes dans la ville en même temps que se déclenche un feu d’artifice extraordinaire de fusées de toutes couleurs. Des soldats tirent sans arrêt, vidant chargeurs sur chargeurs de leurs fusils, mitraillettes, mitrailleuses. On devine que c’est la fin de la guerre, mais c’est seulement le lendemain que l’on apprend la capitulation sans condition de l’Allemagne dans la journée du 8 mai. Pour nous autres, ex-prisonniers, la joie est immense, mais nous savons que nous ne sommes pas rentrés dans nos foyers et que plus de 150 km nous séparent de la rivière de l’Elbe et que les moyens de communication pour y parvenir sont détruits, que nous restons coupés du monde extérieur : les Russes ne montrent aucun signe de libération prochaine ; les camarades restés à Cölditz avaient été libérés fin avril dans de meilleures conditions par les américains. 11 mai : je fête, non sans une certaine inquiétude, le 9ème anniversaire de mon mariage. 12 mai, : je donne ma démission du commandement du camp de la mairie et me mets à la recherche d’un logement plus confortable. Je le trouve dans l’immeuble de la Reichsbank, 12 Bahnhofstrasse. Désordre indescriptible, pillage complet, coffres-forts ouverts au chalumeau, tous les tiroirs répandus par terre, meubles fracturés, etc. L’évacuation par le personnel avait dû être précipitée. L’appartement du directeur est cependant pratiquement intact beaux tableaux au mur, salle de bains intacte. Je prends un bain et me pèse pour la première fois : 39 kg.. 20 mai, : Pentecôte. Belle messe dans l’église catholique absolument intacte. Nombreuse assistance d’ex-prisonniers. Eglise richement décorée, de style baroque a11emand - 21 mai, : réveil à 5 heures du matin. Ordre de se préparer immédiatement pour le départ. Constitution de compagnies de départ. 17 heures, départ pour la gare. Entassement à 57 par wagons à bestiaux. Départ du train à 4 heures le lendemain matin. Le train roule jusqu'à 6h30, s’arrête à Kohlfur. Arrêt jusqu’à 17 heures, puis marche normale jusqu’à 6 heures. Arrêt définitif à Beutersitz (près de Falkensberg). 23 mai : On reprend la marche à pied à 9 heures du matin, direction Torgau s/Elbe. Après une vingtaine de kilomètres, direction Mühlberg, marche très pénible sous une pluie battante. Après reprise de notre route à 21 heures, arrêt à 24 heures dans une petite localité où les russes nous offrent un bon repas chaud. Je tombe de fatigue. La région que nous traversons n’a pas beaucoup souffert de la guerre, elle est occupée par des troupes russes très disciplinées. Pas de pillage, pas de vexation de la population, rien de comparable avec la région précédente, pratiquement dépeuplée et pillée sans merci. 24 mai : Le camp de Mühlberg étant surchargé, on nous met en rouge et l’on tourne en rond pendant toute une journée jusqu’au village et camp de Kôssdorf. Depuis notre départ de Zeithain, nous sommes sur les routes, sans ravitaillement régulier, sans cantonnement préparé, mangeant et logeant à la bonne fortune. On est à 30 km de Torgau, parqués dans un camp russe où des camions américains déversent des ex-prisonniers (ou travailleurs) russes et chargent, nombre pour nombre des ex-prisonniers français. Les ex-prisonniers russes sont immédiatement repris en main par des commissaires militaires qui les haranguent et les traitent comme déserteurs. Sous d’immenses portraits de Staline et de Koniev. Pour beaucoup d’entre eux, c’est le début d’un nouveau vrai calvaire. 25 mai : Chargés sur des camions américains, nous franchissons enfin l’Elbe à Torgau sur un pont en bois qui vient d’être construit. Tout le monde pousse un immense soupir de soulagement. Du côté américain, nous passons aussitôt dans un système perfectionné de désinfection : 1ère salle : déshabillage, remise de tout vêtement, linge, objets personnels pour désinfection 2ème salle : des infirmiers habillés comme des scaphandriers nous aspergent par pulvérisation de grandes quantités de désinfectant et nous font attendre ainsi le temps nécessaire pour son action, 3ème salle : douche intense et prolongée, 4ème salle: séchage à l’air chaud, 5ème salle : reprise des vêtements et objets désinfectés et échange du linge hors d’usage, Ensuite seulement, restauration à volonté. 27 mai : Anniversaire de mon fils Gérard. Rassemblement à 7 heures, organisation modèle en groupe de 40. A 8 heures, départ en camions pour LEIPZIG, traversons la ville. Enormes destructions par l’aviation alliée. Dans nos camps, nous ne pouvions imaginer l’étendue des dégâts. Embarquement dans un train à une gare de la banlieue de Leipzig. Environ 4 000 partants civils et militaires. Passons par Zeitz, Weissenfels, Naumburg, Weimar, Erfurt, Eisenach. Toute ces villes avaient terriblement souffert. Le train s’arrête souvent : 200 km dans la journée. 28 mai : 8 heures du matin, arrivée à Fulda. Gare complètement détruite ; entonnoirs gigantesques, des wagons éventrés par centaines, réduits en miettes. Déjà avant-hier, en pénétrant dans la zone américaine, nous avons pu constater la différence des conditions de vie de la population allemande dans les deux zones. Dans la russe, villes et villages dépeuplés fuyant devant l’invasion. Peu de gens (surtout femmes et enfants) restés, ou revenant. Apeurés, femmes violées, vivant dans l’anxiété. Adultes masculins de 15 à 60 ans arrêtés. Pas de ravitaillement. Anarchie et arbitraire, sauf dans la zone d’une trentaine de kilomètres à l’est de Torgau occupée par une division d’élite de russes blancs. Chez les Américains, énormément de population civile circulant librement. Sans doute, beaucoup de réfugiés de l’est. Population endimanchée. Malgré les grosses destructions, les gens paraissent heureux de vivre. Beaucoup d’hommes valides, libres. Nous avons croisé un seul camp de prisonniers allemands d’environ 3.000-4.000 hommes. Sur 1es routes, beaucoup de jeunes en civil ou même encore en uniforme allemand. Aucune trace de pillage. De 10 heures du matin à 21 heures, arrêt en gare de Hanau, près de Francfort. Lors d’un bombardement en mars, 10.000 des 40.000 habitants auraient péri. Pendant l’arrêt dans cette gare, passage d’un train de rapatriés russes, surtout de jeunes filles ukrainiennes, excessivement libres d’allure, boulottes, riantes, se faisant copieusement peloter par leurs compagnons de route. 29 mai - 1er juin : Le train cherche un passage sur le Rhin. A 17 heures, traversée du train à Offenbach sur un pont reconstruit par le Génie américain voie unique du Rhin à Mayence dont le quartier situé sur la rive droite du Rhin complètement rasé. Le train repart lentement vers Sarrebruck. Arrêts prolongés à Worms, Kaiserslautern et Sarrebruck. 2 juin : Arrêt forcé faute de train, d’une journée à Sarreguemines où je vais voir une partie de ma famille dont j’étais sans nouvelles depuis 5 ans. Une de mes cousines, Berthe Mosser a été condamnée à mort par les nazis pour avoir hébergé un aviateur australien. Détention dans les pires conditions pendant deux ans dans une prison de Berlin, libérée in extremis et rapatriée depuis peu de semaines. Note : Le calvaire de ma cousine ainsi que l’exécution à la hache, par les Nazis, du prêtre et des hommes impliqués dans l’affaire de l’aviateur australien Russel NORTON sont décrits en détail dans les pages 111 à 120 du Tome I de "La Tragédie Lorraine’ de Eugène HEISER- Editions Pierron- Sarreguemines 1979. 3 et 4 juin : Démobilisation à Sarrebourg - Longues formalités (Curieusement, pour les officiers tant d’active que de la réserve, les autorités voulaient savoir s’ils avaient constaté, durant la "drôle de 3uerre", ou en captivité, quelque chose méritant d’être signalé Ce n’était pas vrai dans mon cas. De toute façon, le fait est que la carrière des officiers d’active prisonniers a été stoppée net au profit de ceux qui avaient combattu ou fait partie de la RESISTANCE.
5 et 6 juin : arrivée à Paris très tard. Passé la nuit dans le métro et la gare d’Austerlitz, faute de train. Le lendemain, départ pour Blois. Retrouvailles avec ma famille sur le quai de la gare, avec ma femme, mes fils Gérard, 9 ans et Bernard, 5 ans que je n’avais vu qu’une seule fois, à sa naissance, en février 1940. ATTESTATION concernant KLEIN Paul, François, classe 1923
OFLAG VIII F -MAËRISCH TRÜBAU 1942 GROUPE BANQUE ET BOURSE
|
|


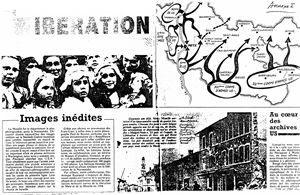
Par l’intermédiaire de sa famille, nous avions reçu le témoignage de notre camarade KLEIN alors qu’il était déjà décédé, et n’avions jamais à même de demander des détails supplémentaires sur le témoignage. Nous pensions que notre camarade avait eu un joli coup de crayon et que les quelques dessins en noir et blanc qui illustraient son récit étaient de sa main.
Grâce à l’obligeance d’un visiteur du site, M. Jacques ANCEL, qui détient un ouvrage relié complet de 25 dessins couleur, nous avons appris que l’auteur des dessins était un certain A. CARLUT. Ce carnet a été légué M. ANCEL par son oncle Xavier FROGEUL, lui aussi prisonnier à l’Oflag VIII B. M. FROGEUL, officier commandant une unité de chars Renault, n’est pas cité dans le témoignage de M. KLEIN, car il ne mentionne que quelques uns des membres du groupe « Banque & Finances », dont M. FROGEUL ne faisait pas partie, puisqu’il était ingénieur des Arts et Métiers. Néanmoins, on peut supposer qu’ils se connaissaient, vu la longueur de leur séjour au camp, tout comme ils connaissaient sans aucun doute l’auteur A. CARLUT dont ils avaient tous deux conservé des exemplaires des dessins.
Nous remercions vivement M. ANCEL de nous avoir permis d’enrichir notre site de ces documents, et nous souhaiterions vivement qu’un visiteur puisse nous donner plus d’informations sur ce talentueux artiste officier.