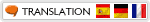- Parcours de la terre sur le plan de l'écliptique autour du soleil 365.22 jours
- Coordonnées polaires
- Coordonnées
- Vue du ciel 24 septembre 2021 hémisphère Nord
- Coordonnées équatoriales
- Coordonnées géographiques
- Illumination de la terre par le soleil au solstice d'été.
- Illumination de la terre par le soleil au solstice d'hiver.
- Rotation de la terre autour du soleil sur le plan de l'écliptique
- Oscillation sinusoïdale du soleil entre solstices et équinoxes
- Durée du jour en hémisphère Nord
- Système de coordonnées horizontales
- Culmination: grand cercle Méridien
- Culmination: grand cercle Méridien (mesure avec théodolite
- Equateur polaire et écliptique
- Obliquité d'environ 23°27' ou 27,45°
- Obliquité
- Pôle Nord
- Coordonnées géographiques
- Vue du ciel le 23 octobre 2021
- Horloge temps en secondes
- Mesure du temps: horloges atomiques.
- Rotation de la terre en 24h
- Rotation de la terre autour du soleil en 365.2522 jours
- Jour sidéral - Définition et Explications
- Histoire des calendriers
Point (hi)vernal: passage de l'été à l'automne
Nous sommes passés de l'été en automne le 23 septembre, jour de l'équinoxe d'automne; ce jour là, en tout point de la terre et à la latitude de 43,65°Nord où je me trouve, presque à mi chemin entre l'équateur et le pôle Nord, la durée du jour était égale à celle de la nuit, 12 heures. A partir de ce jour, dans l'hémisphère Nord, les nuits deviennent chaque jour plus longues et cela durera jusqu'au 21 décembre, jour du solstice d'hiver. Le 21 décembre, ce sera la durée du jour la plus courte, 8 heures 30min.
Après le 21 décembre, la durée du jour recommencera à croître jusqu'au 21 mars jour de l'équinoxe de printemps dit point vernal; la durée du jour sera à nouveau égale à celle de la nuit, 12 heures. Et elle continuera de croître jusqu'au 21 juin où elle sera de 15 heures 30 min, jour du solstice d'été.
Après le 21 juin, le durée du jour recommencera à diminuer jusqu'au 23 septembre, jour de l'équinoxe d'hiver; un cycle complet d'une année solaire se sera déroulé, d'une durée de 365 jours; mais pour que le soleil retrouve la même position que l'année précédente, ce sera un peu plus: 365,2422 jours soit 365 jours 5 heures 48 minutes et 46 secondes, ce qui sera expliqué plus loin. C'est l'année tropique.
En fonction des latitudes, voir ici les durées de jour et de nuit.
Le temps: jour solaire et sa division
L'écoulement du temps est la durée qui s'écoule entre deux passages successifs du soleil en un point fixe visible par un observateur. Ce temps est un jour solaire; il est divisé en 24 heures, de 60 minutes par heure et de 60 secondes par minute; soit 24 heures, 1440 minutes et 86400 secondes par jour. La durée du jour correspond à la rotation de la terre sur elle-même et à un petit déplacement autour du soleil sur le plan de l'écliptique.
Le mouvement annuel de la terre autour du soleil est représenté sur cette image. C'est une variation sinusoïdale. La terre tourne autour du soleil sur le plan de l'écliptique, qui est incliné d'environ 23°27' ou 27,45° (*) sur le plan perpendiculaire aux pôles. Et la terre tourne elle même autour de l'axe des pôles en 24 heures solaires (**). La terre tourne autour du soleil en 365.2422 jours de 24 heures, c'est à dire en 31 557 793 secondes de temps.
(*) L'obliquité varie entre 24,5044° (ou 24°30'16") et 22,0425° (ou 22°2'33"), suivant un cycle de 41 000 années LIEN.
(**) Le temps solaire est la durée qui s'écoule entre deux passages du soleil au méridien d'un lieu. Depuis les chaldéens, cette durée est comptée en 24 heures divisées en 60 minutes et les minutes en 60 secondes. Le mouvement des astres, étoiles, soleil, planètes (dont la terre et son satellite la lune) se réfère au temps solaire de 24h.
Mesure du temps: L'unité de base de la mesure du temps est la seconde. On mesurait le temps autrefois par le clepshydre ou le sablier ou par l'hologe hydraulique. Il y eut ensuite l'horloge à pendule, puis la montre mécanique, et la montre à quartz; aujourd'hui le smartphone. Tous ces dispositifs sont conçus pour suivre le déroulement du temps seconde par seconde avec la plus grande précision possible, c'est à dire sans écarts entre eux. Aujourd'hui, la seconde est définie par un nombre d'oscillations de l'atome de césium, soit exactement 9 192 631 770 par seconde. La mesure et le comptage de ces oscillations sont effectuées par les horloges atomiques. Il s'agit donc d'une mesure très précise. Une journée de 24h (1 heure=60minutes=60x60secondes) c'est 84600 secondes de temps.
heure sidérale: Les étoiles passent au méridien du lieu 86164 sec après le jour précédent, c'est à dire 236 sec ou 3 minutes 56 secondes (#4 minutes) avant le soleil qui y passe tous les 86400 sec. En effet pendant une journée de 24 heures la terre a aussi tourné un peu autour du soleil. En un an la terre tourne autour du soleil durant 365.2422 jours mais la terre fait un tour de plus soit 366.2422 jours. Le temps qui sépare le passage d'une étoile au méridien chaque jour est ainsi de 365.2422/366.2422=0.997269jours soit 23.9345 heures, ou 23h 56min 4sec, soit 4 minutes par jour avant le passage du soleil.Voir ce gif; et lire Jour sidéral - Définition et Explications.
Organisation sociale: Calendriers
Le temps et le mouvement annuel du soleil permettent la constitution de calendriers par les gouvernants d'une société. Un calendrier est un système de repérage des dates en fonction du temps qui a pour but de synchroniser les moments des évènements et des activités humaines, le mieux possible avec la durée de l'année tropique qui est de 365,2422 jours. Les effets du choix d'un système de calendrier sur l'organisation de la vie sociale ne s'observent que sur de longues durées. En fonction de ces effets, des ajustements du calendrier sont effectués pour mieux synchroniser l'organisation sociale avec le mouvement du soleil. L'observation des phénomènes périodiques - comme le passage du soleil aux méridiens, le cycle de la lune, le cycle des saisons, la hauteur et le déplacement de l'ombre d'un bâton planté dans le sol, la variation de la durée du jour et de la nuit, ont servi de références pour organiser la vie agricole, sociale et religieuse des sociétés.
Le calendrier utilisé aujourd'hui dans la majeure partie du monde est le calendrier grégorien qui date seulement de 1582, décrété sous le pape Grégoire XIII. Le calendrier grégorien fut créé pour corriger le calendrier julien qui avait été créé sous Jules César 45 ans avant JC, lequel avait été créé pour corriger le calendrier Romain créé 450 ans avant JC.
Le problème, c'est comment on répartit les 365,2422 jours dans le calendrier pour sychroniser les activités sociales avec le soleil. Voir l'histoire des calendriers
Observation du ciel et de la sphère céleste: Référentiels, systèmes de coordonnées
Je me place maintenant dans ma position fixe en un point de la terre - 43,65° soit 43°38'53"Nord 6°44'41"Est au sud de la France. J'observe la sphère céleste au dessus de mon horizon de jour comme de nuit. Je suis en un lieu donné de la terre où je me considère comme le centre de la sphère céleste. Je suis tourné vers le Sud. Tous les astres: étoiles, soleil, lune, planètes se déplacent au dessus de moi. Image. Je considère un premier système de coordonnées. D'abord la verticale du lieu où je suis; c'est la direction de la pesanteur: cette verticale perce la sphère céleste au dessus de mes pieds au Zénith et sous mes pieds au Nadir. Perpendiculairement à cette verticale, je définis le plan horizontal qui coupe la sphère céleste en un grand cercle horizontal. Tout plan passant par le Zénith, le Nadir et moi ou un point du grand cercle horizontal, coupe la sphère céleste selon un grand cercle vertical et le plan horizontal suivant une droite.

Voir cette figure.
Ce système de coordonnées est dit système de coordonnées horizontales. À un moment donné, la position d'un astre A sur la sphère céleste se détermine au moyen de deux angles: l'azimut et la hauteur. Sur cette figure: soient T le centre de la sphère céleste, TZ la verticale zénith-nadir, HH' l'horizon correspondant, et TZF un vertical fixe à partir duquel je mesure tous les plans verticaux dans le sens des aiguilles d'une montre, de ma gauche vers ma droite. Cela posé, on appelle azimut de l'astre A, l'angle que fait le plan vertical fixe TZF avec le plan vertical TZAa de l'astre. L'azimut se compte de 0 à 360° de ma gauche vers ma droite de l'observateur - dans le sens direct - et a pour mesure son angle plan FTa ou l'arc Fa. Azimut et hauteur définissent la position de l'astre sur la sphère céleste. On utilise aussi la distance zénitale c'est à dire la distance de l'astre au Zénith; c'est le complément à 90° de la hauteur.
J'ai ainsi un système de coordonnées pour me repérer et suivre le mouvement des astres: les étoiles, le soleil et la lune qui m'intéressent ici. Ces coordonnées horizontales, basées sur le Zénith, le Nadir et le plan horizontal d'un lieu sont la hauteur qui est l'angle que fait un astre avec le plan horizontal, et l'azimut, l'angle que fait son cercle vertical avec un cercle vertical choisi comme origine.
Commençons les observations: successivement les étoiles, le soleil et la lune.
Première observation du mouvement des astres. De nuit j'observe le ciel en me tournant vers le Sud. J'observe que les étoiles se déplacent de ma gauche vers ma droite, c'est-à-dire de l'Est vers l'Ouest; et je les vois disparaître à l'horizon vers l'Ouest. Il en est de même du soleil que j'observe de jour; il se lève le matin à l'Est, culmine au Sud, redescend et se couche le soir à l'Ouest. Il en est aussi de la Lune quand elle est visible; elle se lève à l'Est, culmine au Sud, redescend et se couche à l'Ouest. On va voir plus loin que les étoiles, le soleil et la lune ont des mouvements différents sur la sphère céleste.
Culmination: Plan méridien d'un lien.
Considérons une étoile A située vers l'Est et observons la monter avec la lunette d'un théodolite monté avec son axe vertical; Image. L'angle que fait la lunette avec l'horizon donne la hauteur h de l'étoile; le vertical ZTD de l'étoile est déterminé par la direction de l'aiguille horizontale et par la verticale du théodolite. Un moment après, l'étoile, par suite de son mouvement ascendant, cessera d'être vue dans la lunette. Alors, sans changer l'inclinaison de la lunette, faisons tourner sur lui-même l'axe vertical de l'instrument, de l'Est vers l'Ouest, jusqu'à ce que l'étoile, descendant dans le ciel, soit à nouveau visible dans la lunette. A ce moment l'étoile aura la même hauteur h que dans la première visée; le cercle vertical du théodolite aura passé de la position ZTD à la position ZTD'. En menant la bissectrice TM do l'angle D'TD, le plan vertical ZTM sera défini; c'est le plan méridien du lieu; toutes les étoiles, le soleil et la lune y culminent dans leur mouvement diurne. Image.
La culmination c'est donc la hauteur maximum d'un astre lors de son mouvement diurne
Je vais maintenant modifier le système de coordonnées horizontales en notant les directions Sud, Nord, Ouest et Est, la direction Sud étant la direction où le soleil culmine chaque jour à midi, l'Est la direction où il se lève et l'Ouest la direction où il se couche. Un grand cercle vertical qui passe par le Zénith et le Nadir et par le Sud, est un Méridien (milieu du jour, car le soleil y culmine). Image.
Si je me tourne vers le Nord (direction opposée au Sud), j'observe encore un mouvement des étoiles de l'Est vers l'Ouest; mais, tandis que certaines étoiles ont un lever et un coucher, d'autres restent toujours visibles et décrivent des cercles qui diminuent à mesure que ces étoiles sont plus rapprochées deu nord et de l'étoile polaire (alpha de la Petite Ourse). Cette dernière, d'ailleurs, semble rester à peu près immobile dans le ciel. Les peuples de l'Australie, du sud de l'Amérique et de l'Afrique, observent les mêmes phénomènes que moi; mais leur étoile fixe n'est plus l'étoile polaire; c'est une autre étoile, qui est diamétralement opposée à l'étoile polaire sur la sphère céleste. Enfin, on peut encore constater que toutes les étoiles mettent le même temps pour décrire leurs circuits: 84164sec du temps solaire soit 23h.56min.4sec. Ces premières observations, faites à l'oeil nu, avaient fait croire chez les Anciens, à l'existence d'une sphère solide, mobile autour de deux pivots diamétralement opposés, et entraînant dans son mouvement les étoiles qui y seraient enchâssées. C'est ce mouvement qu'on appelle mouvement diurne des étoiles.
1: Les étoiles. En regardant vers le Sud, j'observe que les étoiles se déplacent devant moi de manière identique chaque jour; elles apparaissent à l'Est à ma gauche, montent vers le Sud, y culminent au passage d'un cercle vertical, au Méridien (plan Zénith-Nadir-Sud-Nord) du lieu où je me trouve, redescendent vers l'Ouest et y disparaissent; elles poursuivent alors leur course sous l'horizon, sont visibles par quelqu'un comme moi mais situé dans l'hémisphère Sud. Elles apparaissent pour lui après leur coucher pour moi, montent, culminent et disparaissent devenant alors à nouveau visibles pour moi. Chaque jour, la culmination d'un astre choisi, une étoile, se produit au méridien, à la même hauteur par rapport au plan horizontal du lieu où je me trouve et toutes les 84164sec du temps solaire soit 23h.56min.4sec ou 4min plus tôt que le passage du soleil au méridien. J'ai choisi Altaïr de la constellation de l'Aigle. J'observe aussi des étoiles qui sont plus hautes sur l'horizon et en me tournant alors vers le Nord pour observer des étoiles de plus en plus hautes, j'observe des étoiles qui restent toujours visibles; elles décrivent alors des cercles sur la sphère céleste qui sont perpendiculaires à la direction des pôles Nord et Sud. Plus une étoile est au Nord, plus le cercle décrit est petit. Une étoile semble ne pas faire de cercle et même rester fixe, c'est l'étoile polaire. Au vu de ces observations, je vais considérer un autre système de coordonnées, les coordonnées équatoriales, axé sur les pôles.
2: Je passe au soleil. Comme les étoiles, le soleil se lève à l'Est, culmine au Sud, mon Méridien, tous les jours à la même heure et se couche à l'Ouest. À la différence des étoiles, je ne peux l'observer que de jour. Et le soleil a un mouvement différent. Sa hauteur au dessus de l'horizon, lors de sa culmination au Méridien, varie de jour en jour et de mois en mois. Le 21 juin, cette hauteur est maximum; le 21 décembre elle est minimum. A la latitude où je suis 43°38'53N, la durée du jour est d'environ 15h le 21 juin (le soleil se lève tôt et se couche tard) et de 9 heures le 21 décembre (le soleil se lève tard et se couche tôt). Voir cette image. C'est le mouvement apparent du soleil autour de la terre d'une durée de 365.2522 jours.
3: Je passe à la lune. Comme les étoiles et le soleil, la lune se lève à l'Est, culmine au Sud, mon méridien, tous les jours, et se couche à l'Ouest. Mais elle ne culmine pas au Sud à la même heure tous les jours; elle culmine chaque jour avec environ 1 heure ou 12° de retard; idem pour son lever à l'Est et son coucher à l'Ouest. C'est le mouvement apparent de la lune autour de la terre d'une durée de 29.5 jours.
La Lune se déplace autour de la Terre selon une orbite dont le plan est très proche de celui de l'écliptique du Soleil. Elle tourne également sur elle-même dans le même temps qu'elle décrit son orbite autour de la Terre ce qui explique qu'elle nous présente toujours la même face. Au cours du mois lunaire, la lune se lève chaque jour 50 minutes plus tard (son parcours journalier s'effectue en 24 heures 50 minutes environ) et parcourt les 12 signes du Zodiaque (à raison d'un peu plus de deux jours par signe) en modifiant son apparence.
La Lune décrit son orbite en 28 jours (27 jours 7 heures 43 minutes) mais pour l'observateur situé sur la Terre, l'intervalle de temps entre deux phases semblables correspond à un mois lunaire de 30 jours (ou révolution synodique : 29 jours 12 heures 44 minutes ou 29.5 jours).
Le Soleil éclaire la Lune par moitié et cette moitié, pour l'œil terrien, forme un fuseau variable. Au début du cycle, la nouvelle lune est invisible (elle est entre le Soleil et la Terre et sur l'alignement qu'ils forment) ; la nouvelle lune passe au méridien à 12 heures. Petit à petit le croissant grandit, la lune croît. Quand la partie éclairée représente un demi-cercle, c'est le premier quartier (la Lune forme avec le Soleil, par rapport à la Terre, un angle droit) et la Lune franchit le méridien à 18 heures. Quand la partie éclairée représente un cercle complet la lune est pleine (elle est sur l'alignement Soleil-Terre, en opposition au Soleil) ; elle franchit le méridien à minuit. Ensuite la lune décroît ; son apparence redevient un demi-cercle (la Lune forme avec le Soleil, par rapport à la Terre, un angle droit) et c'est le dernier quartier qui franchit le méridien à 6 heures.
Voici le schéma des coordonnées équatoriales: La Terre est au centre. Le prolongement de son équateur sur la sphère céleste donne l'équateur céleste (cercle bleu). De même pour ses pôles Nord et Sud. L'écliptique (cercle jaune) est le plan de l'orbite de la Terre autour du Soleil. Le cercle horaire, ou Méridien de l'astre considéré, est le grand cercle passant par les pôles et l'étoile. L'intersection de l'écliptique avec l'équateur céleste définit deux points: le point vernal. À partir de ce point, on établit l'ascension droite sur l'équateur céleste (ligne rouge horizontale). La déclinaison est déterminée à partir de la position de l'astre sur le Méridien (ligne rouge verticale).