 Pacte européen de stabilité et de croissance
(PSC, 1997), qui a précisé les règles que devaient respecter les États
membres de la zone euro.
Pacte européen de stabilité et de croissance
(PSC, 1997), qui a précisé les règles que devaient respecter les États
membres de la zone euro.Notre situation financière est très préoccupante. Notre dette publique financière (cf. l’encadré infra) a en effet été multipliée par cinq depuis 1980 et s’élevait à 1 067 milliards d’euros à fin 2004. Et à côté de cette dette, il ne faut pas oublier l’existence des autres engagements de l’État qui, s’ils ne figurent pas dans son bilan, sont néanmoins réels. Le plus important d’entre eux provient de l’engagement qu’a pris l’État de verser une retraite à ses agents.
L’alourdissement de l’endettement des administrations publiques ne leur a pas été imposé. Il est le résultat d’une gestion des dépenses publiques qui n’a pas été suffisamment rigoureuse depuis 25 ans. La dette est en fait une facilité à laquelle la France a cédé en raison des lourdeurs et des incohérences de son organisation administrative, et, plus fondamentalement, de ses pratiques politiques et collectives.
Définition : dette et déficit au sens des règles européennes
Les administrations publiques (APU) sont classées traditionnellement en quatre catégories : l’État, les collectivités territoriales, les organismes de protection sociale – c’est-à-dire la Sécurité sociale (assurance maladie obligatoire, régimes obligatoires de retraite, prestations familiales, accidents du travail et maladie professionnelles) et l’assurance-chômage – et une quatrième catégorie, plus diffuse (les Organismes divers d’administration centrale – ODAC), qui regroupe notamment certaines entreprises publiques.
Chaque année, ces administrations publiques perçoivent des ressources (impôts et taxes, et autres recettes non fiscales) et payent des dépenses pour la collectivité (salaires, fournitures, prestations...). Lorsque ces dépenses sont supérieures aux recettes, un déficit est constaté. Pour financer ce déficit, les administrations publiques doivent s’endetter. Concrètement, elles se trouvent dans ce cas dans la même situation qu’un ménage qui serait contraint d’emprunter, ses ressources étant inférieures à ses dépenses.
Toutefois, à la différence d’un ménage, les administrations publiques n’empruntent généralement pas auprès d’une banque, mais émettent des titres, essentiellement des obligations, sur les marchés. Elles s’engagent à rembourser ces obligations, en payant des intérêts, à une date future.
Si les administrations publiques sont en déficit pendant plusieurs années, leur dette augmente. En revanche, si elles sont capables de dépenser moins qu’elles n’ont de ressources, elles ont un excédent qui leur permet dans ce cas d’émettre un montant d’obligations inférieur à celui des obligations arrivant à échéance cette année-là. Dans ce cas, l’encours total des obligations – c’est-à-dire le montant de la dette – diminue.
En France, lorsque l’on évoque la dette publique, on fait le plus
souvent référence au traité de Maastricht de 1992, qui a décidé la
création de l’euro et au  Pacte européen de stabilité et de croissance
(PSC, 1997), qui a précisé les règles que devaient respecter les États
membres de la zone euro.
Pacte européen de stabilité et de croissance
(PSC, 1997), qui a précisé les règles que devaient respecter les États
membres de la zone euro.
Pour mettre en place la monnaie unique, il fallait en effet que les pays de l’Union monétaire respectent un minimum de règles budgétaires et financières communes. Celles-ci sont indispensables pour assurer la force et la crédibilité de l’euro et empêcher certains pays de profiter égoïstement de la monnaie unique, pour pratiquer des gestions peu rigoureuses.
Le PSC a fixé une valeur de référence en matière d’endettement (60 % du Produit intérieur brut, le PIB, c’est-à-dire la production nationale de richesses). Il a aussi fixé un plafond pour le déficit annuel des administrations publiques : 3 % du PIB. Pour s’assurer que tous les pays s’efforcent de le respecter dans les mêmes conditions, il a également donné sa définition de ce déficit et de cette dette. Sans entrer dans les détails, la dette au sens du PSC est une dette brute consolidée, c’est-à-dire qu’elle ne tient pas compte des actifs et des dettes entre administrations publiques. Si l’on prend l’exemple d’un foyer rassemblant plusieurs personnes, la dette du foyer, entendue au sens du PSC, serait la somme de la dette totale de ces personnes, sans prendre en compte les sommes qu’elles se seraient éventuellement prêtées entre elles. La valeur de la dette ne serait en outre pas diminuée des biens que possède le foyer, par exemple sa maison, sa voiture...
À force d’augmenter sans cesse, la dette publique au sens du Pacte européen de stabilité et de croissance représente désormais les deux tiers de la production nationale. Encore ne parle-t-on ici que de la dette financière.
Or, l’État, outre sa dette financière, a d’autres engagements qui doivent être impérativement pris en compte lorsque l’on veut apprécier la situation financière des administrations publiques. Le plus important d’entre eux concerne la retraite de ses agents, qu’il s’est engagé à financer.
On pourrait chercher à se rassurer, en constatant que la dette publique a pu être plus importante dans le passé ou que certains pays dans le monde sont également très endettés. Mais ces comparaisons ne sont pas pertinentes. La dette de la France n’a rien à voir avec sa dette passée et la situation des autres pays n’atténue pas la gravité de notre situation et de son évolution.
La dette financière des administrations publiques a atteint, fin 2004, 1 067 milliards d’euros. L’État supporte 79 % de cette dette, les administrations publiques locales 10,5 %, les administrations de Sécurité sociale (y compris la Caisse d’amortissement de la dette sociale CADES) 8 % et les Organismes divers d’administration centrale (ODAC) 2,5 %.
Le montant de la dette financière est difficile à interpréter. Pour prendre la mesure du problème, deux approches sont possibles. La première consiste à regarder l’évolution du montant de la dette ; la seconde, à comparer la dette à d’autres grandeurs, par exemple la production de notre pays.
Pour mesurer correctement l’évolution de la dette, il faut éliminer l’effet de l’inflation. 1 euro de dette d’aujourd’hui n’est en effet pas équivalent à 6,60 francs de dette en 1980. Lorsque l’on corrige l’effet de l’inflation, il apparaît que la dette publique financière a été multipliée par cinq depuis 1980, soit une augmentation de 6 % par an, ce qui est considérable. Sur la même période, notre production nationale corrigée de l’inflation n’a en effet augmenté que de 2 % par an.
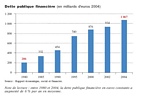
Dette publique financière (en milliards d'€ 2004)
Cette multiplication par cinq de la dette montre l’ampleur du problème. Mais ces grandeurs parlent peu au grand public. Pour apprécier la gravité de la situation, il faut comparer la dette avec des grandeurs plus concrètes.
Traditionnellement, on rapporte la dette à la production nationale annuelle de richesses, définie par le Produit intérieur brut (PIB). Le Pacte européen de stabilité et de croissance a conforté cette approche, en considérant que la dette publique financière ne devait pas représenter plus de 60 % du PIB. Dit autrement, chaque pays de la zone euro s’est engagé à limiter la dette financière de ses administrations publiques à moins de 60 % de sa production annuelle.
Cette approche a un mérite substantiel, celui de la simplicité : elle rapporte la dette à l’une des grandeurs économiques dont dépend la capacité des administrations publiques à la rembourser.
En effet, une augmentation de la part de la dette dans le PIB signifie qu’il faudra prélever de plus en plus de ressources sur la production nationale pour la rembourser et qu’en conséquence, la charge de son remboursement sur les citoyens s’alourdit. Le poids de la dette de la France a, à cet égard, triplé depuis 1980, passant de 21 % à 64,7 % du PIB. Paradoxalement, c’est dans les années qui ont suivi immédiatement la négociation de Maastricht, en 1991, qu’elle a le plus rapidement augmenté : entre 1991 et 1997, la part de la dette dans la production nationale est passée de 36,2 à 58,5 %, soit une augmentation de près de 60 %.

Dette publique financière en % du PIB.
D’autres données sont encore plus parlantes. Du fait de la dette publique financière, chaque ménage français supporte sans le savoir une dette d’environ 41 000 €. C’est le double de la dette qu’il a, en moyenne, à titre privé, pour l’ensemble de ses crédits (crédit à la consommation, crédit immobilier...).
Lorsqu’il veut emprunter, un ménage s’adresse à sa banque. Les administrations publiques sont dans une situation différente : en général, l’État ne s’endette pas directement auprès des banques mais auprès des marchés financiers.
Néanmoins, les conséquences sont les mêmes : chaque année, les administrations publiques doivent payer les intérêts correspondant aux sommes empruntées. Dès lors, plus la dette augmente, plus le montant des intérêts à payer chaque année s’accroît, et moins les administrations publiques peuvent utiliser à leur gré les ressources à leur disposition pour des dépenses utiles.
C’est exactement la situation de la France aujourd’hui. En 1980, un tiers seulement du produit de l’impôt sur le revenu était nécessaire pour payer les intérêts de la dette des administrations publiques et non des dépenses utiles, alors que les taux d’intérêt étaient élevés. En 2004, c’est l’intégralité du produit de cet impôt qu’il a fallu consacrer au paiement des intérêts de la dette, alors que les taux d’intérêt sont bas. Ce qui signifie concrètement que lorsqu’un Français paie l’impôt sur le revenu, il paie en fait uniquement les intérêts de la dette passée des administrations publiques. Et cette dette reste entièrement à rembourser. Si l’on regarde seulement la dette de l’État, il apparaît que la France consacre aujourd’hui presque autant à payer les intérêts de sa dette financière passée qu’à assurer la défense nationale ou à éduquer ses enfants. Et encore, bénéficions-nous aujourd’hui de taux d’intérêt particulièrement bas.
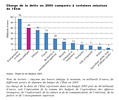
Charge de la dette en 2005 comparée à certaines missions de l'État
Le niveau de la dette financière des administrations publiques n’est qu’un élément dans l’appréciation de la situation des finances publiques.
En effet, l’État pourrait avoir à assumer la dette financière de certains acteurs publics qui, à ce jour, ne font pas partie du périmètre des administrations publiques au sens du Pacte européen de stabilité et de croissance. Surtout, l’État, en tant qu’employeur public, a d’autres engagements, notamment celui d’assumer la retraite de ses agents. Ces engagements constituent un élément d’appréciation incontournable de la situation financière de l’État. Leur évaluation est donc un enjeu central dans l’analyse de la situation des finances publiques.
La France applique avec exactitude les règles comptables européennes applicables au secteur public, qui sont moins exigeantes que celles qui s’imposent au secteur privé. Les États demandent en effet aux entreprises de recenser le plus largement possible toutes les dettes qu’elles auront un jour à supporter, sans exiger autant d’efforts de la part des acteurs publics.
En effet, la dette financière au sens du PSC se limite au seul périmètre des administrations publiques. Dans chaque pays, il peut exister d’autres acteurs publics qui ne font pas partie de ce périmètre, mais dont la dette pourrait à l’avenir être assumée par l’État.
L’entreprise minière et chimique (EMC) en est un exemple en France. Jusqu’en 2004, sa dette n’était pas comptabilisée dans la dette des administrations publiques. En 2005, elle a intégré le périmètre des administrations publiques et en 2006, l’État a prévu au titre de ses dépenses de l’année le remboursement de la dette restante, d’un montant de 600 millions d’€. En réalité, il était à peu près inévitable qu’il reviendrait à l’État d’assurer le remboursement. Dans le secteur privé, une telle dette aurait dû être inscrite dans les comptes consolidés de sa maison mère bien avant l’arrêt de l’activité de l’entreprise.
Ceci ne constitue qu’un exemple des dettes de certains acteurs publics que l’État pourrait être conduit à assumer.
Il est difficile d’en évaluer précisément le montant total. On peut néanmoins l’estimer dans une fourchette comprise entre 15 et 20 milliards d’€ environ.
Si le ratio d’endettement financier des administrations publiques, calculé à partir de la définition du PSC était de 64,7 % à la fin de l’année 2004, ce ratio aurait probablement été plus proche de 66 % en intégrant ces risques potentiels.
L’État a pris l’engagement de payer une retraite à ses agents, « en rémunération des services qu’ils ont accomplis (1) Article L. 1 du Code des pensions civiles et militaires.». L’État assume lui-même en large partie cet engagement : il n’en partage pas la responsabilité avec d’autres employeurs au sein d’un régime mutualisé.
Cet engagement ne figure pas directement dans le bilan de l’État, mais uniquement dans son hors bilan. Il n’en est pas moins un élément important de sa situation financière. L’évaluation de cet engagement est donc essentielle.
Le régime de retraite des fonctionnaires de l’État est un régime d’employeur
Au sein des régimes de retraite, il convient de distinguer les régimes d’employeur des régimes mutualisés. Un régime d’employeur prend en charge les salariés d’un seul employeur ; un régime mutualisé regroupe les salariés de plusieurs employeurs. En France, dans le secteur privé, la retraite de base et la retraite complémentaire sont mutualisées. La plupart des salariés relèvent d’un régime de base unique, géré par la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV).
Les entreprises privées peuvent également assurer un supplément de retraite, en créant un régime spécifique pour leurs salariés. Elles sont alors responsables de ce régime, des retraites qu’il verse et des droits à retraite acquis par les salariés de l’entreprise. C’est un régime d’employeur, puisqu’il est propre à l’entreprise.
En France, dans le secteur privé, il n’y a donc qu’une petite part des retraites qui n’est pas mutualisée mais qui relève d’un régime d’employeur. Dans d’autres pays en revanche, c’est l’essentiel, voire la totalité des retraites des salariés qui sont placées sous la responsabilité des entreprises. Les entreprises françaises qui opèrent dans ces pays ont souvent mis en place des régimes d’employeurs pour assurer une large partie de la retraite de leurs personnels locaux. Pour les fonctionnaires, il convient de distinguer deux cas dans notre pays.
Pour les collectivités territoriales et les hôpitaux publics, la retraite de base relève d’un régime mutualisé entre tous les employeurs qui est géré par une caisse unique, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL).
Dans le cas des fonctionnaires de l’État, la situation est différente. Il ne s’agit pas d’un régime mutualisé, mais d’un régime d’employeur. Concrètement, les retraites des fonctionnaires de l’État sont payées essentiellement à partir de deux ressources : d’une part, des cotisations des salariés, dont le taux n’a pas varié depuis de nombreuses années ; d’autre part, une contribution de l’État à partir de son budget (1). Le régime de retraite des agents de l’État n’est donc pas mutualisé avec d’autres employeurs, privés ou publics.
(1) Cette contribution de l’État, qui représente plus des trois quarts des recettes du régime, est affichée depuis 2004 comme un pourcentage de la masse salariale, ce qui pourrait laisser penser que c’est une cotisation employeur identique à celle qui existe dans le secteur privé. En réalité, cette contribution n’est pas une cotisation d’employeur mais une subvention d’équilibre : son taux évolue chaque année pour équilibrer le régime.
L’engagement de payer des retraites est un élément important de la situation financière de l’État, qui pourrait être dans quelques années considéré comme une dette par les normes comptables internationales La distinction entre régime mutualisé et régime d’employeur est fondamentale.
En effet, si un employeur a des difficultés, les conséquences sont très différentes selon que l’on se trouve dans un régime mutualisé ou dans un régime d’employeur. Dans un régime mutualisé, les retraites pourront être versées, à condition que les cotisations reçues de l’ensemble des autres employeurs et des autres salariés du régime soient d’un montant suffisant pour faire face aux engagements vis-à-vis des retraités. L’engagement de verser des retraites sera alors honoré.
En revanche, dans le cas d’un régime d’employeur, c’est-à-dire si l’employeur est seul à assumer l’engagement qu’il a pris de verser une retraite, les retraites ne pourront plus être versées si l’employeur n’a pas anticipé ces difficultés.
Or il est évident que c’est un risque qui est inacceptable pour les retraités et les futurs retraités. C’est pourquoi il est progressivement apparu indispensable que les entreprises évaluent le montant de leur engagement au titre de leur régime de retraite employeur et l’inscrivent à leur passif aux côtés de leurs dettes. Ainsi, leurs actifs couvrent l’ensemble des engagements, y compris celui relatif aux régimes de retraite employeur. Il est en outre primordial que les comptes de l’entreprise reflètent de manière exhaustive et fidèle la situation financière réelle de l’entreprise, et en particulier l’ensemble de ses engagements.
C’est pour ces deux raisons – principe de prudence et principe de sincérité – qu’il a été progressivement demandé aux entreprises du secteur privé, dans le cas de régimes d’employeur, de passer d’une simple comptabilisation hors bilan à la reconnaissance d’une dette et à l’inscription de celle-ci dans leur bilan. Les normes comptables internationales (IFRS International financial reporting standards) l’ont prescrit. L’Union européenne a rendu obligatoire l’application de ces normes pour les entreprises européennes cotées.
Les États, contrairement aux entreprises, ne sont pas aujourd’hui obligés d’appliquer ce type de règles. Mais par prudence l’État français a décidé en 2003 de calculer le montant total des sommes qu’il devra verser jusqu’en 2100 si les règles du régime de retraite des fonctionnaires de l’État n’étaient pas modifiées. Toutefois, comme le faisaient les entreprises dans le passé, il n’inscrit pas ce montant à son bilan dans les dettes. Il le fait uniquement figurer dans une note technique.
Pourquoi cette différence entre les États et les entreprises privées ? Deux arguments sont en général avancés.
Le premier, c’est que le régime de retraite des fonctionnaires de l’État est un régime par répartition – c’est-à-dire un régime où les retraites de l’année sont financées par les cotisations perçues la même année. L’engagement de l’État à verser une retraite serait donc sans impact sur la situation financière de celui-ci, puisque des cotisations permettraient d’honorer cet engagement.
Ce premier argument repose sur une confusion. L’analyse ne doit pas reposer sur le mode de financement du régime (répartition ou capitalisation), mais sur le nombre d’employeurs qui assument la responsabilité (régime mutualisé ou d’employeur). Lorsque l’employeur est seul à assumer son engagement de retraite, il est dans une situation très différente du cas où il partage cette responsabilité avec d’autres.
Le second argument part du constat que l’évolution des règles comptables du secteur privé provient notamment du fait que les entreprises privées peuvent faire faillite à tout moment. Il ne serait donc pas pertinent d’inscrire en dette l’engagement de retraite de l’État à l’égard de ses agents, puisqu’il apparaît inconcevable que ce dernier puisse faire faillite. Il est vrai que l’évolution des règles comptables vise notamment à empêcher que les entreprises en difficulté, voire en liquidation, ne puissent plus honorer leur engagement de retraite. Mais cette évolution a également un autre but : apprécier le plus justement possible la situation financière et la valeur d’une entreprise, en tenant compte de l’ensemble de ses engagements.
L’évaluation précise de l’engagement de retraite d’une entreprise et son inscription en dette permettent ainsi à tous ceux qui sont en rapport avec elles – actionnaires, salariés, clients, prêteurs – d’avoir une appréciation aussi fidèle et exhaustive de sa situation financière, et donc en particulier de sa capacité d’endettement. C’est également un élément à prendre en compte lorsque l’on veut comparer la valeur et les perspectives financières de deux entreprises.
Ce raisonnement vaut pour les États aussi bien que pour les entreprises : l’évaluation de la situation financière doit être parfaitement transparente et ne peut donc pas ne pas tenir compte de l’engagement de verser des retraites, dès lors que l’on est dans le cadre d’un régime d’employeur.
C’est ce raisonnement qui guide aujourd’hui la réflexion au plan international sur les règles comptables que doivent appliquer les États. Il est très probable, à ce titre, que le groupe de travail international (1) qui étudie actuellement ces questions considère que l’engagement des États qui ont un régime de retraite d’employeur doit être évalué précisément, et qu’il doit être inscrit à leur bilan à côté de leurs dettes. D’ailleurs, certains États appliquent déjà ces principes. Ainsi, le Canada a décidé, dès le milieu des années 1990, d’inscrire en dette le déficit prévu sur les cinquante prochaines années de la part des retraites de ses fonctionnaires dont il a la responsabilité. L’État australien a également fait le choix d’inscrire dans ses comptes la dette liée aux retraites de ses fonctionnaires.
(1) Ce groupe de travail réunit les secrétariats de plusieurs organisations internationales : ONU, Banque mondiale, OCDE, FMI et €tat. Ce dernier a, dans une communication du 2 décembre 2004, reconnu la pertinence de l’évaluation des engagements de retraite dans le cadre des régimes d’employeur.
On comprend donc qu’au-delà de la question du traitement comptable de cet engagement et de son éventuelle inscription en dette, l’analyse de la situation financière d’un État, comme pour une entreprise, doit tenir compte de cet engagement, qui doit être évalué le plus justement possible.
La Commission propose un mode d’évaluation de l’engagement de retraite tenant compte des spécificités de l’État
L’évaluation de l’engagement de l’État en matière de retraite est une question complexe, car l’unique référence aujourd’hui est la norme comptable du secteur privé, qui n’est pas nécessairement parfaitement adaptée au fonctionnement des États.
Deux méthodes sont envisageables, entre lesquelles les institutions internationales n’ont pas encore tranché. À cet égard, il serait souhaitable que l’Union européenne adopte rapidement une norme en la matière, pour que les comparaisons entre les États membres puissent prendre en compte leur éventuel engagement en matière de retraite.
La première méthode consiste à appliquer à l’État le mode de calcul qui s’impose aux entreprises du secteur privé, en calculant la valeur actuelle des pensions des retraités et des droits à retraite de ses agents en activité, sur la base de la législation en vigueur. C’est la méthode qui est utilisée aujourd’hui par l’État dans la note technique qui accompagne son bilan. Au 31 décembre 2004, cette méthode conduit, suivant les hypothèses, à évaluer l’engagement de l’État dans une fourchette comprise entre 790 et 1 000 milliards d’€.
La seconde méthode a pour but de tenir compte des spécificités des États et des régimes par répartition. Dans les pays développés, les États, à la différence des entreprises du secteur privé, ne risquent pas d’être à tout moment en cessation de paiement. En conséquence, il apparaît plus pertinent, plutôt que de chercher à calculer ce que l’État devrait débourser pour honorer à un instant donné l’intégralité de son engagement, d’évaluer, sur les années à venir, la part aujourd’hui non financée de cet engagement, c’est-à-dire le surcoût annuel de cet engagement pour l’État par rapport à ce qu’il finance aujourd’hui.
L’État peut certes augmenter sa contribution, c’est-à-dire son taux de cotisation employeur, et ainsi équilibrer année après année le régime de retraite des fonctionnaires de l’État.
Ce qui importe cependant, ce n’est pas l’équilibre apparent du régime, qui sera forcément obtenu en diminuant d’autres dépenses voire en pesant sur le déficit, mais le poids financier croissant pour l’État de l’engagement qu’il a pris de payer ses retraites.
En conséquence, la part aujourd’hui non financée des retraites est la différence, dans les règles actuelles, entre les prestations et les recettes (taux de cotisation des salariés et part de la contribution employeur dans la masse salariale maintenus à leur niveau actuel). C’est la somme actualisée de ces écarts qui constitue le manque de financement du régime.
Cette seconde méthode a la préférence de la Commission. Elle tire en effet toutes les conséquences à la fois du principe de la répartition, des caractéristiques du régime d’employeur, et de la continuité de l’État. Cette méthode conduit à un montant d’environ 430 milliards d’€, variant entre 380 et 490 milliards d’€ en fonction du taux d’actualisation retenu, en se limitant aux manques de financement jusqu’en 2050. Au-delà de cette date, nous ne disposons pas d’évaluation fiable des manques de financement du régime de retraite des fonctionnaires de l’État. C’est donc au vu de deux éléments, dette financière d’une part et poids supplémentaire pour l’État de l’engagement résultant des retraites de ses agents, que l’on comprend déjà à ce stade que la situation financière des administrations publiques est très préoccupante.
Trois précisions doivent encore être apportées.
D’abord, le fait d’évaluer aujourd’hui le poids de cet engagement ne signifie pas que l’on fige son montant. Par définition, il évoluera en fonction de la démographie, des comportements d’activité, des recrutements et de l’évolution des règles du régime de retraite des fonctionnaires de l’État.
D’autre part, ce raisonnement ne vaut ni pour le régime de retraite des fonctionnaires des collectivités territoriales, ni pour les régimes obligatoires du secteur privé, qui sont tous mutualisés.
Enfin, l’État assume aujourd’hui une partie du financement de certains régimes spéciaux de retraite – entreprises publiques, SNCF, RATP, régime des mineurs, des salariés agricoles etc. – par l’intermédiaire de subventions. On pourrait en conséquence considérer que l’engagement de ces régimes à verser une retraite est en réalité un engagement de l’État, puisque c’est à ce dernier que revient la charge de financer une partie des prestations.
Cette question est plus complexe que cela. Les exemples d’EDF et de GDF ont montré ces dernières années que lorsque leur régime de retraite était amené à évoluer, leur engagement de retraite n’était pas nécessairement repris par l’État mais pouvait être financé par d’autres voies (taxe sur les consommateurs). Ceci invite à aborder avec prudence le traitement de l’engagement de retraite de la RATP ou de la SNCF. La Commission ne s’est donc pas prononcée sur ce point.
Pour d’autres régimes, il serait en revanche probablement pertinent de les intégrer dans l’engagement de l’État (notamment les régimes des mines, des marins, des ouvriers d’État, ou encore des salariés agricoles). La Commission n’a cependant pas disposé d’estimations précises du montant du manque de financement qui serait finalement à la charge de l’État.
Pour relativiser le niveau de la dette de la France, deux arguments sont souvent avancés. D’abord, un argument fondé sur l’histoire : la dette publique financière de la France a été à plusieurs reprises largement supérieure à son niveau actuel. Ensuite, un argument lié à la comparaison internationale : d’autres pays ont aujourd’hui un endettement financier public comparable ou largement supérieur au nôtre.
Ces arguments sont fondés sur des comparaisons qui laissent de côté les engagements correspondant aux droits à la retraite des fonctionnaires. Or, ceux-ci ont changé de dimension dans notre pays depuis 1950, en raison de l’accroissement massif du nombre des fonctionnaires. Et il y a peu de pays où les effectifs d’agents publics représentent une part aussi importante de la population active.
Pour s’en tenir à la dette financière, si les administrations publiques ont connu d’autres épisodes de fort endettement dans le passé, c’était en réalité dans un contexte radicalement différent. En outre, l’importance de la dette de certaines autres économies développées ne remet pas en cause la gravité de la situation française, bien au contraire.
À la fin du XIXe siècle, la dette financière des administrations publiques s’élevait à près de 100 % du PIB. En 1918, à 130 % du PIB. Entre 1945, à 170 %. Au regard de tels précédents, la situation actuelle n’aurait donc rien d’exceptionnel. Mieux, la situation n’aurait même rien de dramatique, puisque, dans ce passé lointain, notre pays a été capable de réduire rapidement le niveau de sa dette. Entre 1945 et 1946, en un an, les administrations publiques sont parvenues à diminuer de moitié le rapport de leur dette au PIB.
Mais la situation de notre pays est bien différente de celle qui prévalait dans ces périodes antérieures de fort endettement. Les périodes de fort endettement dans le passé correspondent toutes à des circonstances historiques exceptionnelles. À la fin du XIXe siècle, l’endettement provenait notamment du paiement par emprunt des dommages de guerre. En 1918 et 1945, il résultait des déséquilibres des deux guerres mondiales.
En outre, la France ne peut plus, comme par le passé, compter sur l’inflation pour réduire considérablement et rapidement le montant de sa dette.
L’inflation a en effet longtemps permis de réduire le poids de la dette par rapport à la production nationale. C’est l’inflation qui a conduit à la réduction très rapide de la dette rapportée à la production nationale dans les années qui ont suivi la seconde guerre mondiale.
Aujourd’hui, notre pays ne peut plus décider seul de se laisser aller aux facilités illusoires de l’inflation, car il n’a plus la maîtrise de sa politique monétaire. Concrètement, c’est la banque centrale européenne qui définit la politique monétaire. Celle-ci s’est fixée comme objectif de limiter l’inflation dans l’ensemble de la zone euro à 2 % par an environ. En outre, la liberté des mouvements de capitaux pourrait conduire les épargnants, face à un État qui s’engagerait dans la voie de la hausse des prix et d’un endettement excessif, à transférer leurs fonds dans des pays plus vertueux.
Certains pourraient regretter que notre économie ne dispose plus de l’inflation pour réduire rapidement l’endettement public dans le passé. Ils auraient tort. En effet, l’inflation élevée aboutissait à ruiner les épargnants qui plaçaient leur argent dans notre monnaie nationale et, plus généralement, affectait le niveau de vie de tous les Français, particulièrement les plus vulnérables. Elle était également la source de perturbations économiques et financières majeures. Elle débouchait inévitablement sur des crises financières, en raison des pressions subies par notre monnaie sur le marché des changes.
Compte tenu de cette évolution, la France n’a plus aujourd’hui la possibilité de réduire subrepticement le poids réel de sa dette. En théorie, elle peut toujours en revanche l’annuler officiellement en tout ou partie. Ce choix a pu être fait dans le passé, mais dans un contexte radicalement différent, puisqu’il s’agissait de la Révolution française. On comprend bien à la lumière de cette référence historique qu’une annulation, même partielle, de la dette de notre pays est aujourd’hui inconcevable. Ce sont en effet la position de la France, en Europe et dans le monde, et son crédit international, c’est-à-dire l’avenir de notre Nation, qui seraient affectés.
Pour se rassurer encore, certains avanceront que la dette de la France, exprimée en part de sa production nationale, n’est pas si importante que cela, au regard de la situation dans d’autres économies européennes. Certains pays européens comparables à la France ont en effet une dette financière – c’est-à-dire sans prendre en compte les éventuels engagements liés à l’existence d’un régime employeur de retraite – égale ou supérieure à la nôtre. C’est le cas notamment de l’Allemagne (66 % du PIB), mais surtout de la Belgique (96 %), de l’Italie (106 %) et de la Grèce (110,5 %).
En réalité, le fait que certains pays européens présentent un niveau de dette publique financière plus élevé que le nôtre ne doit pas nous rassurer, pour deux raisons.

Dette publique financière dans l'Europe des 15 en 2004 (% PIB)
En 2004, la France faisait partie des cinq pays les plus endettés de l’Europe des quinze. En 1994, la situation était radicalement différente, puisque nous faisions partie des deux pays les moins endettés de l’Europe des quinze.
Cette évolution s’explique simplement : nous sommes le pays d’Europe dont le ratio d’endettement a le plus augmenté depuis dix ans (+ 10,5 points de PIB). Cette évolution à contre-courant de celle de la majorité des pays de l’Europe des quinze a été particulièrement forte ces dernières années. En effet, entre 2000 et 2004, le ratio d’endettement moyen des pays de l’Europe des quinze, hors France, a diminué de 3,4 points de PIB, alors qu’en France il s’est accru de 8,3 points de PIB.
Au-delà de la trajectoire d’endettement des administrations publiques françaises, le fait que deux des principales économies de la zone euro – l’Allemagne et l’Italie – partagent nos difficultés ne diminue pas les risques qui pèsent sur notre pays, bien au contraire. En effet, comme nous le verrons plus loin, dans un tel cas, la conjonction d’un fort niveau d’endettement actuel et de perspectives démographiques et économiques dégradées conduirait chacun de ces pays, si rien n’était fait, à connaître de très graves problèmes de financement.

Évolution de la dette publique financière dans l'Europe des 15
entre 1995 et 2004
On ne peut pas préjuger la réaction des marchés et des autres acteurs économiques si la France, l’Allemagne et l’Italie se trouvaient ensemble dans une telle situation. Les expériences passées de crise financière indiquent cependant que, dans ce cas, le fait qu’une crise ait lieu au même moment dans des pays voisins est de nature à aggraver la situation. Sur le plan financier, cela renforce l’inquiétude des marchés. Sur le plan économique, en raison de l’intégration croissante des économies européennes, ce serait une part importante des débouchés des entreprises de chacun de ces trois pays qui dans ce cas disparaîtrait.
Au total, la question n’est donc pas de savoir si d’autres pays sont plus endettés que nous, mais de tirer les conséquences de deux réalités. D’une part, que la France est le pays d’Europe où la dette publique a progressé le plus vite ces dernières années. D’autre part, qu’il est dangereux que trois des plus grandes économies européennes soient si lourdement endettées.
Il est indispensable que chacun de ces trois pays tire les conséquences de sa situation. C’est ce vers quoi semble s’orienter l’Allemagne aujourd’hui, puisque le nouveau gouvernement s’est engagé à réduire les déficits publics. Au demeurant, une partie de l’augmentation de la dette allemande est liée au financement de la réunification, qui peut-être considérée, au-delà de sa signification politique, comme un investissement dont l’Allemagne tirera parti dans le futur. En revanche, en Italie, le ratio d’endettement est reparti à la hausse en 2004, après sept années de baisse consécutive.
L’exemple du Japon et celui des États-Unis, sont également souvent avancés pour apaiser les craintes que suscite le niveau de la dette française ou de celle d’autres pays européens. Il est vrai que ces pays ont leurs propres problèmes. Le Japon présente en effet une dette publique financière deux fois et demi supérieure à celle de la France (157 % du PIB en 2004), et celle des États-Unis est désormais proche de la nôtre (63,4 % en 2004). Mais ces deux pays sont dans des situations fort différentes de la nôtre. Le Japon est dans une situation économique très problématique.
Il a été enlisé pendant près de quinze ans dans la récession et dans la déflation et est confronté, en outre, à des perspectives démographiques particulièrement défavorables. Face à cette situation, le gouvernement japonais a essayé de relancer l’économie en augmentant son déficit budgétaire. La France n’a, à l’évidence, pas connu un tel contexte économique. Le Japon est en outre d’autant plus enclin à s’endetter que le niveau d’imposition de ses citoyens est faible – les prélèvements obligatoires ne dépassant pas 26 % du PIB, contre 44 % pour la France, en 2004. Ceci signifie concrètement qu’il pourrait réduire sa dette, le moment venu, par une augmentation très significative de ses recettes, sans compromettre la compétitivité fiscale de son territoire.
Aux États-Unis, les administrations publiques ont fortement augmenté leurs dépenses et réduit leurs recettes ces dernières années, ce qui a entraîné un net accroissement du déficit public et de la dette. En 2001, la dette financière des administrations américaines représentait 58 % de la production nationale. Quatre ans plus tard, environ 63 %. L’exemple américain conduirait ainsi à relativiser l’endettement public français, puisque les États-Unis ont désormais un niveau de dette proche de celui de la France et que leur croissance économique n’en a pas souffert.
Il y a cependant trois grandes différences entre les États-Unis et la France en la matière.
Les États-Unis connaissent depuis plusieurs années une croissance économique forte et le plein emploi. Ils ont en outre prouvé récemment qu’ils étaient capables de redresser très rapidement leurs finances publiques, de revenir à l’équilibre et ainsi de réduire rapidement leur dette : entre 1993 et 2001, la part de la dette financière dans la production nationale a ainsi diminué de 17,5 points de PIB, passant de 75,4 % à 57,9 %. Certes, la croissance économique a été particulièrement forte sur cette période aux États-Unis, ce qui a largement contribué à cette évolution. Mais, d’autres facteurs interviennent, notamment le comportement des pouvoirs publics qui, lorsque la croissance est élevée, augmentent les prélèvements sur les ménages – ce qui est facilité par le niveau limité des prélèvements obligatoires. Les administrations publiques françaises n’ont pas démontré une telle capacité à redresser rapidement leur situation financière. Le déséquilibre des finances publiques en France n’est pas temporaire : il dure depuis vingt-cinq ans.
Enfin, les États-Unis ont l’avantage d’émettre et de gérer eux-mêmes la monnaie dans laquelle ils s’endettent : le dollar. La France emprunte, elle, dans une monnaie (l’euro) dont les règles d’émission sont régies par un traité international et sur laquelle l’emprunteur qu’elle est n’a aucune action discrétionnaire.
Si la dette a autant augmenté en France depuis la fin des années 1970, c’est parce que les dépenses publiques se sont accrues en moyenne plus vite que la production nationale. Les recettes progressent elles au même rythme que le PIB.
La France est à ce titre dans une situation paradoxale. Alors qu’elle a l’un des niveaux de prélèvements obligatoires les plus élevés au monde en part de la production nationale, ses administrations publiques ont quand même besoin de s’endetter pour financer leurs dépenses, parce que celles-ci sont elles aussi, et plus encore, parmi les plus élevées au monde.
Rien de substantiel n’a été véritablement mis en oeuvre pour enrayer cette spirale d’endettement. Les objectifs de remise en ordre des finances publiques sont rarement respectés. Les opportunités qui ont été offertes à la France pour réduire sa dette (forte croissance à certains moments, faibles niveaux des taux d’intérêt, recettes de privatisation) n’ont été que partiellement exploitées.
Notre pays n’a pas de difficultés à emprunter, en raison notamment de sa réputation, de la force de son économie et de l’efficacité avec laquelle sa dette est gérée. Ceci a probablement renforcé son indifférence à la croissance de sa dette financière.
Un ménage peut s’endetter pour réaliser un investissement durable (bien immobilier, automobile...). Il peut également choisir de s’endetter s’il traverse une mauvaise passe, c’est-à-dire si ses revenus diminuent temporairement et deviennent inférieurs à ses dépenses de manière passagère. Dans ce cas, s’endetter peut être une solution pour passer le cap, s’il estime soit que ses ressources augmenteront, soit qu’il sera capable de réduire son train de vie rapidement. Sa dette n’est alors que temporaire parce qu’il ne veut pas vivre à crédit en permanence. Tel n’est pas le cas de nos administrations publiques.
Prises globalement, celles-ci sont en effet constamment en déficit depuis la fin des années 1970, du fait principalement du déséquilibre des comptes de l’État. Il existe donc un déséquilibre durable entre les dépenses et les recettes, qui constitue la principale explication de l’endettement actuel.
On pourrait toutefois répondre que les administrations publiques ont été condamnées à vivre à crédit du fait d’une croissance trop faible. Il est vrai que la croissance en moyenne depuis le milieu des années 1980 n’est pas très forte (2,2 % par an en moyenne). Il est vrai également que dans les périodes où la croissance ralentit, le déficit des administrations publiques a tendance spontanément à augmenter. C’est ce que les économistes appellent le jeu des stabilisateurs automatiques. C’est ce que l’on peut aussi appeler l’effet de ciseau. Les revenus des ménages et des entreprises sont moins élevés, ce qui réduit donc les recettes publiques (TVA, impôt sur les bénéfices des sociétés, CSG...). Dans le même temps, une partie des dépenses s’accroît fortement, notamment les dépenses d’indemnisation du chômage et les minima sociaux.
Il est possible de mesurer cet effet de ciseau, et donc de faire la part chaque année entre un solde dit « conjoncturel », dû à cet effet, et un solde « structurel ». En faisant cette distinction, on isole la partie du solde qui ne dépend pas de la situation économique du moment : le solde structurel, qui traduit l’augmentation (en cas de déficit) ou la diminution (en cas d’excédent) volontaire de l’endettement.
Dans le cas de la France, l’effet de ciseau a joué dans les deux sens, c’est-à-dire que la France a alterné des phases de croissance soutenue et des périodes de ralentissement économique parfois très marquées.

Soldes structurel et conjoncturel des administrations publiques
En revanche, le solde structurel est constamment négatif depuis près de vingt ans (- 2,9 % de la richesse nationale en moyenne). Autrement dit, si le rapport de la dette au PIB a plus que triplé en vingt-cinq ans, ce n’est pas parce que la France a été confrontée à une croissance trop faible, mais parce que ses dépenses publiques sont durablement supérieures à ses recettes. Ces dix dernières années, les dépenses des administrations publiques ont été supérieures à leurs ressources, en moyenne, de 7 % chaque année. Les dépenses de l’État lui-même ont été en moyenne supérieures à ses recettes de 18 % par an pendant cette période.
Le déficit de l’État se situe donc à un niveau qui heurte le bon sens : on imagine mal une entreprise qui connaîtrait chaque année pendant dix ans un déficit égal à 18 % de son chiffre d’affaires, ou un ménage qui dépenserait chaque année 18 % de plus que son revenu.
Expliquer l’endettement par la faiblesse de la croissance est donc abusif. C’est pourtant une explication que l’on avance souvent, tout particulièrement pour la dette sociale, qui en moins de quinze ans a atteint 110 milliards d’€. Là encore, l’impact de la croissance sur cette dette a été très limité. Si cette dette existe et s’est accrue, c’est parce que les dépenses d’assurance maladie augmentent à peu près continûment plus vite (+ 3,2 % entre 1982 et 2002 en volume) que les recettes, bien que celles-ci augmentent globalement aussi vite que la production nationale (2,1 %). De ce fait, l’assurance maladie est en déficit permanent depuis quinze ans.
En réalité, les administrations publiques se sont habituées à vivre à crédit. Malgré un niveau de prélèvements très important (1), il n’y avait en effet pas d’autre solution que la dette pour financer des dépenses publiques qui ont fortement augmenté. Entre 1980 et 2004, elles ont augmenté de 7 points de PIB, soit une croissance moyenne de 2,7 % par an en volume.
(1) 44 % environ de la production nationale contre 39,5 % en moyenne dans la zone euro en 2004 pour les prélèvements obligatoires ; 50,7 % contre 45,8 % pour l’ensemble des recettes publiques en tenant compte des recettes non fiscales.

Évolution de la part des dépenses publiques dans le PIB entre 1987 et 2004; Source : OCDE.
Le niveau des dépenses publiques en France est désormais le plus élevé de la zone euro. Au sein de l’Europe des quinze, seuls le Danemark et la Suède présentent un ratio des dépenses publiques rapportées au PIB plus élevé que la France. Depuis près de vingt ans, la France est également l’un des pays européens où les dépenses publiques ont le plus augmenté.
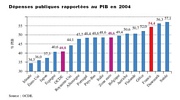
Dépenses publiques rapportées au PIB en 2004: Source : OCDE.
Du fait du dérapage de ses dépenses publiques, la France est donc à la fois une des économies où les administrations publiques prélèvent le plus et où elles sont le plus lourdement endettées.
Pour expliquer la croissance de la dette, notamment dans les années 1990, on dit parfois que celle-ci augmenterait toute seule : l’endettement serait désormais une fatalité.
Pour les tenants de cette thèse, concrètement, les administrations publiques seraient piégées par le niveau des taux d’intérêt. Ceux-ci seraient très élevés, ce qui rendrait les frais financiers si importants que les administrations publiques n’auraient pas d’autre solution que de s’endetter à nouveau pour les payer. La dette augmenterait donc toute seule même si les administrations n’augmentaient pas leurs dépenses. C’est ce que l’on appelle l’effet « boule de neige ».
Jusqu’au début des années 1980, les taux d’intérêt réels étaient très faibles et cet enchaînement ne s’est pas produit. De même, dans la période récente, le niveau très bas des taux d’intérêt n’est guère compatible avec cette thèse. En revanche, à partir du milieu des années 1980, et jusque vers la fin des années 1990, cet effet a pu jouer, les taux d’intérêt ayant été plus élevés. Si les taux d’intérêt avaient été égaux chaque année au taux de croissance du PIB entre 1980 et 1997 – soit un niveau de taux d’intérêt exceptionnellement bas – le ratio d’endettement public en 1997 aurait été de 40 % environ et non de 58,1 % du PIB. Certains en déduisent qu’il était impossible d’empêcher cette augmentation de la dette. L’endettement des années 1990 n’aurait donc pas de responsable, si ce n’est le niveau des taux d’intérêt.
Ce raisonnement est étrange. Tous les pays, toutes les entreprises et tous les ménages endettés ont connu le même problème. Or, ils sont généralement parvenus à éviter l’explosion de leur endettement parce qu’ils savent bien que rien n’est plus dangereux que de payer ses intérêts par une augmentation de sa dette.
Quand les taux d’intérêt sont élevés, chacun sait en effet que les frais financiers, qui constituent des dépenses incompressibles, seront très lourds. Si l’on ne veut pas creuser le déficit et augmenter la dette, il faut donc compenser ces frais financiers par une maîtrise des autres dépenses et/ou une hausse des recettes au niveau adéquat. Concrètement, cela signifie qu’il faut atteindre un solde entre les recettes et les dépenses qui permette d’empêcher l’augmentation de la dette financière. C’est ce que les économistes appellent le solde primaire stabilisant (cf. l’encadré infra).
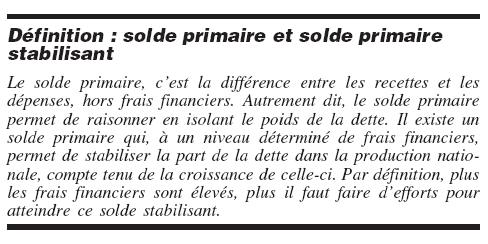
Le solde primaire, c’est la différence entre les recettes et les dépenses, hors frais financiers. Autrement dit, le solde primaire permet de raisonner en isolant le poids de la dette. Il existe un solde primaire qui, à un niveau déterminé de frais financiers, permet de stabiliser la part de la dette dans la production nationale, compte tenu de la croissance de celle-ci. Par définition, plus les frais financiers sont élevés, plus il faut faire d’efforts pour atteindre ce solde stabilisant.
Il est certain que face à une augmentation subite des taux d’intérêt, il est difficile d’amortir totalement le choc en diminuant d’autant les autres catégories de dépense la même année. Les administrations publiques peuvent donc avoir à subir, une année, l’effet boule de neige et voir la dette augmenter alors même que les recettes et les autres dépenses sont restées stables.
Mais lorsque les taux restent élevés pendant plusieurs années, si l’on veut enrayer la progression de la dette, il est possible d’améliorer progressivement le solde primaire afin d’atteindre le seuil stabilisant.
Ce qui est frappant dans le cas de la France, c’est que l’effort pour atteindre le seuil stabilisant a été faible. Sur les vingt dernières années, le solde stabilisant n’a été atteint que quatre fois, en 1988 et de 1999 à 2001. Autrement dit, les administrations publiques ne se sont donné les moyens de compenser le coût des frais financiers afin de stabiliser l’endettement qu’une année sur cinq.
C’est un domaine dans lequel on peut parler d’exception française. Parmi les principaux pays industrialisés, la France apparaît comme l’un de ceux où la dette financière est la plus élevée, et où les efforts pour la contenir ont été les plus faibles. Tel a été particulièrement le cas dans les années 1990, durant lesquelles la majeure partie des pays comparables à la France sont parvenus à améliorer leur solde primaire beaucoup plus que nous ne l’avons fait.
Au total, si la dette a augmenté, ce n’est pas parce qu’un haut niveau de taux d’intérêt conduit automatiquement à plus de dette. Mais c’est parce qu’à la différence des autres pays, lorsque les taux d’intérêt ont été particulièrement élevés, nous n’en avons guère tiré de conséquences sur les autres dépenses publiques. Nous verrons par la suite qu’en outre, lorsque les taux d’intérêt sont particulièrement bas, nous n’en profitons pas non plus pour réduire notre endettement.
Les pouvoirs publics fixent des objectifs en matière de dépenses et de recettes publiques.
Chaque année, la France transmet à la Commission européenne un Programme de stabilité. Celui-ci présente les objectifs de déficit et de dette du gouvernement pour les trois années suivantes. Ces objectifs doivent être conformes aux engagements pris par notre pays au titre du Pacte européen de stabilité et de croissance (déficit inférieur à 3 % de la production nationale, dette inférieure à 60 % de la production nationale).
Le dernier programme de stabilité porte sur la période 2007-2009 et a été réalisé à l’automne 2005. Deux scénarios économiques ont été établis, avec une croissance économique à 2,25 % ou à 3 %. En fonction des hypothèses retenues, le déficit passerait de - 3,0 % en 2005 à - 1,4 % ou à - 0,1 % du PIB en 2009. Dans le même temps, la dette diminuerait entre 2007 et 2009 pour atteindre 64,6 % ou 60,8 % du PIB.
C’est la huitième fois que les pouvoirs publics se livrent à un tel exercice. Le problème, c’est que les objectifs des sept programmes précédents n’ont jamais été respectés.
Ces programmes reposaient tous sur des hypothèses économiques favorables. À vrai dire, l’exercice incite au principe d’optimisme plutôt qu’au principe de prudence, car il importe d’adresser aux ménages, aux entreprises et aux marchés financiers un message de confiance pour soutenir la croissance. Mais cet optimisme apparaît aujourd’hui, à l’épreuve des faits, avoir été assez excessif : les prévisions de recettes, par nature difficiles, n’ont pas toujours été atteintes, ce qui signifie que les objectifs affichés n’ont pas eu l’effet espéré sur les comportements et donc sur la croissance ; mais les prévisions des dépenses, qui devraient pouvoir être mieux maîtrisées par les pouvoirs publics, ont elles-mêmes été systématiquement dépassées.
Si ces programmes n’ont jamais été respectés, c’est en partie la conséquence du choix d’un scénario de croissance très favorable, ce qui a conduit notamment à surestimer les recettes attendues. Mais c’est également le résultat du manque de maîtrise des dépenses. Tel est particulièrement le cas pour les collectivités territoriales et la Sécurité sociale, dont les objectifs de dépenses, tels qu’ils ont été présentés dans les programmes de stabilité, ont été dépassés dans des proportions extrêmement importantes. Entre 1997 et 2002, les dépenses d’assurance maladie ont ainsi augmenté deux fois plus vite qu’annoncé.
L’optimisme sur les recettes et le dérapage des dépenses aboutissent chaque année à un très large écart entre les objectifs de déficit et de dette inscrits dans les programmes de stabilité et les montants effectivement réalisés, qui sont généralement très supérieurs. Le système fonctionne en réalité en escalier : les objectifs sont recalés au fur et à mesure que l’on s’aperçoit que les objectifs initiaux ne seront pas atteints. Ces programmes n’ont donc qu’un effet d’encadrement très limité : on adapte d’année en année les objectifs aux tendances, alors que c’est l’inverse qui devrait se produire.
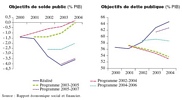
Objectifs de solde public et Objectifs de dette publique (% PIB)
Commentaire : le déficit des administrations publiques a dépassé 4 % du PIB en 2003. Pourtant, à l’automne 2000, la France s’était engagée à limiter ce déficit à 0,4 % du PIB à la fin de l’année 2003. Constatant que la cible initiale ne serait pas atteinte, elle a réduit ses ambitions de réduction du déficit 2003 chaque année entre 2000 et 2002.
Le dernier objectif (fixé en 2002) était de limiter le déficit à 2,6 % du PIB. Cet objectif a néanmoins été dépassé de 50 %.
Le programme de stabilité actuel est également fondé sur des hypothèses volontaristes. Le scénario de base, qualifié de prudent, fait l’hypothèse que la croissance ne sera pas inférieure à celle qu’a connue la France en moyenne ces vingt dernières années, soit 2,25 %, ce qui est supérieur à la croissance enregistrée en moyenne sur les cinq dernières années (2,1 %). Quant aux objectifs de dépenses, ils supposent une nette amélioration des tendances passées pour toutes les catégories d’administrations publiques.
D’autres pays en Europe ne respectent pas non plus leurs engagements. En effet, au terme des programmes de stabilité 2003-2005 communiqués en 2001 par les différents États membres, le déficit aurait dû être totalement résorbé dans la zone euro en 2004. En réalité, le déficit moyen de la zone euro s’est établi cette année-là à - 2,8 % du PIB. Et, comme dans le cas de la France, l’objectif correspondant a été revu à la baisse au fur et à mesure des programmes de stabilité successifs. On l’a vu, il n’est pas rassurant que certains pays connaissent des niveaux d’endettement similaires à celui de la France. Il ne l’est pas davantage que la France ne soit pas la seule à ne pas respecter ses objectifs. En effet, plus les dérapages budgétaires sont fréquents dans la zone euro, plus le risque est important pour l’ensemble des économies de cette zone. En tout état de cause, il ne faut pas oublier que plusieurs pays d’Europe ont respecté très largement ces dernières années leurs programmes de stabilité. Tel est le cas notamment de la Finlande, du Danemark, de l’Espagne ou de la Belgique. Ce sont précisément là les pays de la zone euro qui ont le plus réduit la part de la dette publique dans le PIB ces dix dernières années.
La France fait donc peu d’efforts pour limiter l’accroissement de sa dette lorsque les circonstances économiques sont défavorables (croissance faible, taux d’intérêt élevés).
Mais lorsque les circonstances économiques sont favorables (croissance forte, taux d’intérêt faibles), notre pays n’en profite pas pour se désendetter. Pire, alors que ces périodes lui permettraient de se désendetter sans trop de peine, la France continue à augmenter sa dette publique.
Les périodes de forte croissance
Depuis vingt ans, la France a connu deux phases de forte croissance de sa production : 1988-1990 (+ 3,6 % par an en moyenne) et 1997-2000 (+ 3,4 %). Or, pendant ces périodes, la dette financière a continué à augmenter en volume ; et rapportée à la production nationale, elle n’a que très faiblement diminué.
Si l’endettement n’a pas diminué en dépit de la forte croissance sur ces deux périodes, c’est parce que le solde structurel primaire (c’est-à-dire 52 Rompre avec la facilité de la dette publique le solde budgétaire hors effets croissance et taux d’intérêt) s’est alors dégradé. Entre 1988 et 1990, il est passé de - 0,1 % à - 0,5 % du PIB ; sur la période 1997-2000, il est passé de + 1,2 % du PIB à + 1,0 % du PIB. Cette dégradation démontre que l’on n’a pas suffisamment profité des circonstances économiques favorables pour se désendetter.
Ceci distingue fondamentalement la France des pays de niveau économique comparable, qui tous, à l’exception de l’Italie et du Japon, ont réussi à dégager un excédent budgétaire ces dix dernières années. La France, même en période de très forte croissance, n’a jamais fait mieux ces dernières années qu’un déficit de -1,4 % du PIB.

Dépenses et recettes totales des administrations publiques françaises (en % du PIB)
C’est particulièrement vrai durant la deuxième moitié des années 1990 où l’on a à la fois augmenté les dépenses et diminué la part des prélèvements obligatoires dans le PIB plutôt que de profiter des circonstances pour améliorer le solde structurel.
La part des prélèvements obligatoires dans le PIB a en effet été réduite entre 1999 et 2001. Si l’on avait profité des circonstances pour rechercher une répartition plus efficace des prélèvements obligatoires sans réduire le produit global des prélèvements, le solde des administrations publiques aurait été amélioré de 1,2 point de PIB en 2000 et de 1,0 point en 2001. En outre, en 2000, les dépenses publiques ont augmenté plus vite que la croissance potentielle, ce qui a aussi contribué à dégrader le solde des administrations publiques.
Si ces choix n’avaient pas été faits, la dette n’aurait pas été en 2001 de 56,2 % du PIB mais de 53,6 %. Et si l’on avait voulu stabiliser la dette en montant, il aurait fallu, non seulement ne pas faire ces choix, mais faire des efforts supplémentaires en matière de dépenses, en profitant de la bonne conjoncture.
En fait, lors des périodes d’amélioration de la situation économique, les suppléments de recettes inattendus sont rapidement considérés comme des « cagnottes », qui n’ont pas vocation à diminuer le déficit et à rembourser la dette, mais à être rendues aux citoyens, soit sous la forme de dépenses supplémentaires, soit par des baisses d’impôts.
Le phénomène a été particulièrement fort en 2000, un an après l’apparition du terme de cagnotte dans les médias. C’est une année qui s’est achevée sur un déficit de l’État de 35 milliards d’€, soit 12,4 % de ses recettes alors qu’il aurait pu être réduit de plusieurs milliards si le débat public sur la cagnotte n’avait pas conduit à consommer par des augmentations de dépenses et des diminutions de recettes les améliorations du solde budgétaire provoquées par la bonne conjoncture. La dette des administrations publiques s’est accrue de 21 milliards d’€ seulement, grâce à l’excédent global des autres administrations.
Du fait de ces choix, les marges de manoeuvre des pouvoirs publics pour soutenir la croissance ont été limitées lorsque la conjoncture s’est retournée en 2001.
Les taux d’intérêt
Comme nous l’avons vu, le niveau des taux d’intérêt ces dernières années ne saurait justifier l’augmentation de l’endettement. Il ne permet pas non plus de justifier la faiblesse de la baisse du ratio d’endettement dans les périodes de forte croissance. Un argument souvent entendu est qu’il aurait été impossible de profiter des phases de croissance forte pour se désendetter en raison du niveau des taux d’intérêt pendant ces périodes. L’importance du relèvement des taux aurait annulé l’effet positif de la croissance sur les recettes et les dépenses publiques. Il est exact que les taux d’intérêt réels étaient élevés (supérieurs à 6 %) à la fin des années 1980. Mais tel n’était pas le cas à la fin des années 1990.
Bien au contraire, la France connaît un contexte très favorable en matière de taux d’intérêt depuis la fin des années 1990. Les taux d’intérêt réel sont aujourd’hui voisins de 2 %, et le coût apparent de la dette, c’est-à-dire le taux moyen auquel l’État est endetté, est passé de plus de 8 % à moins de 4 % de 2000 à 2004. Ceci a permis pratiquement de stabiliser les frais financiers des administrations publiques sur cette période (+ 4,4 % entre 2002 et 2004 en € courants), alors que le montant de la dette augmentait fortement (+ 18,5 % de 2002 à 2004).

Évolutions des taux réels et du solde primaire structurel
Au total, une période extrêmement favorable comme la fin des années 1990 aurait pu permettre de réduire significativement l’endettement de la France puisque dans ce type de situation, le désendettement est plus indolore. Tel n’a pas été le cas.
En réalité, l’analyse de la pratique budgétaire de ces dernières années montre que le désendettement est traité comme un objectif largement secondaire. Dès qu’une possibilité de réduire le déficit apparaît, soit parce que la croissance est plus forte, soit parce que le contexte permettrait d’infléchir la dépense, cette marge de manoeuvre est immédiatement utilisée non pas pour diminuer le déficit et donc limiter l’augmentation de la dette, mais pour financer de nouvelles dépenses ou des baisses de prélèvements obligatoires. Ce raisonnement repose sur l’idée incongrue que si la conjoncture tend à réduire le déficit, un État avec un niveau d’endettement tel que le nôtre et un déficit de 18 % de ses recettes en moyenne période, dispose de cagnottes, qu’il peut utiliser pour creuser à nouveau les pertes. Les pratiques et les débats des dernières années montrent que ce raisonnement étonnant reste toujours d’actualité.
À partir de 1986, les pouvoirs publics ont engagé la privatisation d’une partie des entreprises publiques. Entre 1986 et 2004, ces opérations ont rapporté 83 milliards d’€ (en € 2003).
Sur ces recettes, 12 milliards d’€ (en € 2003), soit 14 % du total, ont été affectés directement au désendettement de l’État, c’est-à-dire qu’elles ont servi à racheter des titres de dette. En outre, 1,7 milliard d’€ (en € 2003) a été affecté au Fonds de réserve des retraites (FRR). Ce dernier a été créé en 1999 pour constituer des réserves et les placer judicieusement afin de contribuer après 2020 au financement du régime général, des régimes des commerçants, des artisans, et des salariés agricoles.
Il y a une incertitude sur 14 milliards d’€ (en € 2003). On sait qu’ils ont financé des dépenses courantes de l’État ; ce que l’on ne sait pas, c’est si ces dépenses ont été réalisées en l’absence de ces recettes exceptionnelles. Dans l’affirmative, cette somme a limité d’autant la croissance de la dette financière.
Le reste des recettes de privatisation a servi à refinancer des entreprises publiques en difficulté. L’impact de ces opérations sur l’endettement des administrations publiques est impossible à déterminer. En effet, on ne peut pas savoir si l’État aurait recapitalisé ces entreprises s’il n’avait pas disposé des produits de privatisation. S’il l’avait fait, alors on pourrait dire que les recettes de privatisation lui auraient permis de limiter l’endettement.
En outre, l’impact de ces opérations de recapitalisation sur la situation de certaines de ces entreprises reste incertain. Dans certains cas, il a été excellent (Thomson par exemple). Dans d’autres, la situation des entreprises reste fragile. C’est le cas notamment de Réseau ferré de France et GIAT qui ont reçu entre 1986 et 2005 respectivement 10,7 et 3,8 milliards d’€ (en € 2003).
La mise en place de l’euro a modifié le contexte dans lequel les États européens s’endettent. Elle a en effet créé un marché de titres de dette libellés dans la même monnaie présentant une liquidité mécaniquement supérieure à celle des marchés nationaux antérieurs. À la fin de l’exercice 2003, l’encours de dette libellé en € s’élevait à 7 205 milliards d’€. Cet effet de liquidité a été d’autant plus fort que l’euro a acquis rapidement un statut de monnaie internationale. La part de l’euro dans l’encours de titres de dettes en devises est ainsi passée entre 1999 et 2003 de 29 % à 43 %.
Les États, qui représentent environ 50 % du marché obligataire, ont profité de cette situation. Ils bénéficient en outre aujourd’hui du niveau élevé des liquidités au plan mondial, qui rend les conditions de financement des emprunteurs, privés ou publics, encore plus favorables. La France a su particulièrement bien tirer parti de cet environnement financier favorable.
En effet, au sein de la zone euro, la France bénéficie des meilleures conditions de financement, avec des taux d’intérêt inférieurs d’environ 0,05 % ces derniers mois à la moyenne de la zone euro. Si la France empruntait au taux moyen de la zone d’euro, sa charge d’intérêt s’en trouverait augmentée d’environ 500 millions d’€.
La qualité de la gestion de la dette assurée par l’Agence France Trésor (AFT) explique sans doute pour une part cette situation. L’agence offre aux marchés les produits traditionnels de dette, selon des modalités d’émission et avec une clarté des objectifs correspondant à leurs attentes. Elle leur propose des produits nouveaux, susceptibles de mieux répondre à leurs besoins. Elle a ainsi introduit en 2001 les premières obligations indexées sur l’inflation de la zone euro. L’AFT a également été la première en 2005 à émettre des obligations d’État à cinquante ans, répondant ainsi aux besoins nouveaux des fonds de pension.
Cette situation traduit fondamentalement la qualité de la signature de notre pays. La France a toujours accordé la plus grande importance au respect de ses engagements financiers depuis près de deux siècles et, depuis la fin de la seconde guerre mondiale, a démontré sa capacité à créer des richesses et à offrir aux investisseurs un environnement économique stable, même dans des périodes difficiles.
Mais la confiance des marchés est fragile. Elle dépend largement de la transparence de l’information, de la qualité des performances et du respect des engagements pris par l’emprunteur dans ce domaine. Et lorsque la confiance est entamée, les réactions des marchés sont souvent très brutales. Pour un emprunteur, rien n’est plus important que de présenter clairement et complètement sa situation financière, d’expliquer les politiques qu’il entend mettre en oeuvre pour traiter les problèmes auquel il doit faire face et d’atteindre les objectifs qu’il s’est à cet égard fixés.
L’endettement n’est pas forcément une mauvaise chose. Tout dépend de son utilisation Dans une entreprise, le recours à l’endettement vise généralement à financer des investissements, c’est-à-dire à augmenter la capacité de production de richesses. Une entreprise ne trouverait rapidement plus personne pour lui prêter de l’argent si son endettement venait uniquement financer des pertes récurrentes.
Autrement dit, l’endettement des entreprises repose sur un principe simple : s’endetter aujourd’hui pour être capable de produire et de vendre plus, c’est-à-dire de s’enrichir demain. Ce principe est tout aussi pertinent dans le cas des administrations publiques. Si l’endettement a été utilisé pour réaliser des dépenses qui permettront d’accroître leur patrimoine et la capacité de production de richesses de la collectivité dans le futur, alors les pouvoirs publics ont fait le bon choix.
Ils ont également fait le bon choix s’ils ont utilisé les variations de la dette publique pour compenser les à-coups de la croissance. En France, l’augmentation de la dette n’est pas la conséquence d’une augmentation des dépenses destinées à accroître notre potentiel de croissance. Elle n’a pas non plus été un instrument de régulation du cycle économique. La dette financière s’est accrue parce que, depuis vingt-cinq ans, l’endettement a permis d’éviter d’avoir à limiter et à sélectionner les dépenses des administrations publiques en fonction du niveau des recettes.
La croissance future de notre pays, ce que les experts appellent sa croissance potentielle, dépend pour une part de certaines dépenses publiques : les investissements publics, notamment dans les infrastructures, mais aussi les dépenses nécessaires à une amélioration de notre potentiel de savoir et d’innovations, dans la perspective européenne de société de la connaissance prévue par l’Agenda de Lisbonne.
On pourrait penser que l’alourdissement de l’endettement public des vingt-cinq dernières années trouve son origine dans un accroissement significatif de ces dépenses visant à améliorer notre potentiel de croissance. Tel n’est pas le cas.
L’importance de la dette n’est pas non plus liée à son utilisation comme outil de régulation de la croissance à court terme.
Dans toutes les économies de marché, l’activité est cyclique. À des périodes de croissance forte de la production succèdent des phases de ralentissement. Ces variations, lorsqu’elles sont trop amples peuvent être dommageables pour l’emploi, les entreprises et les ménages. Si la croissance est excessivement forte, l’économie risque de s’emballer, ce qui peut notamment déboucher sur l’inflation. À l’inverse, lorsque la croissance est faible, l’investissement est insuffisant pour assurer la création de richesses futures et le chômage augmente. Lisser la croissance pour éviter de telles difficultés est donc un objectif important de toute politique économique.
Les gouvernements disposent à ce titre de deux outils : la politique monétaire qui permet de faire varier les taux d’intérêt et la liquidité de l’économie, et la politique budgétaire, qui permet en agissant sur les recettes et/ou les dépenses publiques, de ralentir ou de renforcer temporairement l’activité.
Si l’activité économique ralentit ou s’accélère uniquement en France, la Banque centrale européenne, qui a aujourd’hui la responsabilité de la politique monétaire pour toute la zone euro, ne modifiera pas le niveau des taux d’intérêt autant que la situation française le nécessiterait. Les pouvoirs publics doivent donc nécessairement avoir alors recours à la politique budgétaire.
Pour que ce soit possible, la logique serait que les administrations publiques s’efforcent de dégager des excédents budgétaires dans les 60 Rompre avec la facilité de la dette publique périodes de forte croissance, de façon à disposer de marges de manoeuvre leur permettant de creuser des déficits dans les périodes de faible croissance. Globalement, de telles politiques conduisent à un endettement stable sur longue période : à l’endettement créé par les périodes de déficit succède un désendettement dans les périodes d’excédent. Cela suppose qu’en rythme de croisière, lorsque la croissance se situe autour de ce que l’on appelle la croissance potentielle, les finances publiques soient équilibrées.
Malheureusement, les administrations publiques s’étant installées durablement dans le déficit, leur capacité de régulation conjoncturelle de notre économie s’en trouve affaiblie.
En apparence, les gouvernements successifs ont eu largement recours à l’outil de régulation conjoncturelle. En effet, le solde des administrations publiques suit l’évolution de l’activité : le déficit augmente lorsque la croissance est faible et diminue lorsque la croissance repart. En réalité, l’effet de lissage est faible. Sur les dix dernières années, lorsque l’activité a diminué de 1 point de PIB, le déficit a augmenté en moyenne de 0,3 point de PIB. Autrement dit, le déficit compense moins du tiers des à-coups de la croissance.
C’est nettement moins que dans d’autres économies. Ainsi aux États-Unis, sur les dix dernières années, lorsque l’activité a diminué de 1 point de PIB, le solde des administrations publiques s’est dégradé de 1,1 point de PIB. Une part sensible de la forte croissance économique des États-Unis ces dernières années est sans doute liée à cette capacité à amortir fortement les variations de la croissance.
Si les États-Unis sont capables d’augmenter leur dette pour soutenir l’activité en cas de besoin, c’est parce qu’ils ont su la réduire lorsque l’économie allait mieux. Comme nous l’avons vu précédemment, les États-Unis ont en effet su constituer des réserves en période de croissance forte et les utiliser lorsque l’activité ralentit. Ainsi, au plus haut de la croissance fin 2000, les États-Unis avaient réduit la dette de 17 points de PIB par rapport à 1993 et affichaient un excédent budgétaire de 1,5 % du PIB. Ils étaient donc prêts à faire face au ralentissement de 2001.

Dette et déficit publics américains sur le dernier cycle économique (% PIB)
La France n’a pas cette capacité d’action. Elle aborde chaque ralentissement économique sans aucune réserve, puisque sa dette et son déficit sont proches des plafonds fixés par le Pacte européen de stabilité et de croissance. Ainsi, en raison des choix budgétaires faits en 2000, la France a abordé le ralentissement de 2001-2002 encore en déficit (- 1,6 % du PIB) et une dette de 56,2 % du PIB. Ce n’est donc pas le Pacte de stabilité et de croissance qui est responsable de notre manque de moyens budgétaires d’action, mais l’absence d’anticipation des pouvoirs publics
On pourrait donc en première analyse penser qu’à l’exception de ces trois années, l’augmentation de la dette a financé un effort particulier pour l’investissement. Si tel avait été le cas, le patrimoine des administrations publiques se serait accru, parce que l’endettement aurait eu pour but de financer des éléments d’actifs supplémentaires. Cet effort en faveur de l’investissement aurait en outre contribué à renforcer le potentiel de croissance de l’économie française.
En réalité, l’accroissement de l’endettement ces vingt-cinq dernières années ne provient pas d’un effort spécifique en faveur de l’investissement public.
Alors que la dépense publique a augmenté en moyenne de 2 % par an en volume entre 1993 et 2004, les dépenses en capital des administrations publiques sont restées pratiquement stables en volume sur cette période. Les administrations publiques consacrent donc à l’investissement une part de moins en moins importante de leurs dépenses : entre 7,5 et 8 % seulement depuis le milieu des années 1990 contre 9,5 % en 1978.
L’accroissement de la dette publique s’est en fait accompagné d’un appauvrissement global des administrations publiques, parce que leur patrimoine s’est dégradé : le déficit a mécaniquement augmenté leur passif, sans accroître dans le même temps leur actif à due concurrence. Le raisonnement est le suivant. En règle générale, un investissement augmente l’actif, c’est-à-dire le patrimoine d’une entité, s’il sert 62 Rompre avec la facilité de la dette publique non pas seulement à renouveler les installations existantes, mais également à en acquérir ou à en constituer de nouvelles. Si cet investissement est financé par endettement, il accroît dans le même temps le passif. L’augmentation du passif ayant pour contrepartie un accroissement de l’actif, le patrimoine ne diminue pas.

Déficit et dépenses en capital des administrations publiques (milliards d'€ 2002)
Or, depuis vingt-cinq ans, la plupart du temps (dix-neuf années sur vingt-cinq), le déficit public (et donc la dette correspondante) n’a pas servi qu’à financer de nouveaux éléments d’actifs mais d’autres dépenses : le renouvellement des équipements existants et des dépenses de fonctionnement courant. En moyenne sur ces dix-neuf années, ce sont donc 40 % du déficit (et donc de l’augmentation de la dette) qui n’ont pas eu de contrepartie à l’actif et ont donc contribué à dégrader le patrimoine des administrations publiques.

Part du déficit des administrations publiques sans contrepartie
à l’actif.
Pour ces années, il présente la part du déficit qui n’a pas financé des équipements supplémentaires, mais d’autres dépenses, c’est-à-dire du fonctionnement ou le renouvellement d’équipements existants. Cette part s’est élevée en moyenne à 40 % du déficit pendant ces dix-neuf années. Le montant des opérations de renouvellement a été estimé dans ce graphique à partir de l’amortissement calculé dans les comptes nationaux.
Par exemple, en 1994, 60 % du déficit (soit 42 milliards d’€ 2002) n’a pas financé d’équipements supplémentaires. Cela signifie que 60 % de l’augmentation de la dette cette année-là n’a pas eu de contrepartie à l’actif et a donc dégradé le patrimoine des administrations publiques. On comprend, dans ces conditions, la baisse de la valeur du patrimoine de l’ensemble des administrations publiques depuis 1978. D’après les comptes nationaux, la différence entre la valeur actuelle des actifs et les passifs a en effet été divisée par trois en € constants entre 1980 et 2002, passant de 807 milliards d’€ 2002 à 289 milliards d’€ 2002. Autrement dit, la différence entre la valeur des biens des administrations publiques et leurs dettes a été divisée par trois en vingt-cinq ans. Et encore, ceci ne tient pas compte de l’engagement qu’a l’État de verser des retraites, dont le coût s’accroît chaque année. Si on les intégrait, la valeur nette du patrimoine des administrations publiques serait négative.
En résumé, ce n’est pas parce que les administrations publiques se sont mises à investir massivement que la dette a augmenté depuis la fin des années 1970. C’est au contraire parce que l’augmentation de la dette a financé autre chose que des équipements supplémentaires que les administrations publiques se sont globalement appauvries.

Évolution du patrimoine net des administrations publiques; Source : INSEE.
L’État
Le constat d’appauvrissement, c’est-à-dire de la diminution du patrimoine, vaut particulièrement dans le cas de l’État. Même en comptabilisant plus largement dans l’investissement les équipements militaires et en tenant compte du fait que l’État finance en partie l’investissement des collectivités territoriales, on constate que les dépenses en capital sont constamment inférieures au déficit budgétaire entre 1993 et 2004. Autrement dit, chaque année, l’État s’appauvrit parce qu’une partie de l’augmentation de la dette finance d’autres dépenses que l’investissement.
On pourrait objecter ici que les collectivités territoriales dégagent chaque année une capacité d’autofinancement très importante (plus de 25 milliards d’€ en 2004). Comme l’État alloue par ailleurs près de 43 milliards d’€ de dotation globale de fonctionnement aux collectivités territoriales, il serait donc le financeur unique de cette capacité d’autofinancement. La quasi intégralité des 34 milliards d’€ d’investissements nets des collectivités territoriales seraient en fait financés par l’État, sous forme de subventions d’investissement ou de dotation globale de fonctionnement.
Mais raisonner de la sorte, c’est oublier que les collectivités territoriales ont également d’autres ressources, notamment la fiscalité locale, qui elle aussi chaque année est supérieure au montant des investissements. On ne peut donc pas dire que les transferts de l’État sont les uniques responsables de la capacité d’autofinancement des collectivités territoriales ; ils l’expliquent probablement pour partie, mais dans une proportion impossible à déterminer.
Cette part de l’endettement, qui n’a financé que des dépenses de fonctionnement et de transfert, a été variable selon les années. Selon que l’on comptabilise ou pas l’ensemble des dépenses militaires comme des investissements, elle a été en moyenne de 40 ou de 60 % du déficit annuel entre 1993 et 2004.
Les administrations publiques peuvent contribuer à renforcer la croissance d’une économie par l’amélioration des infrastructures publiques et par des dépenses susceptibles de renforcer la capacité d’innovation : l’enseignement supérieur et la recherche-développement.
Nous avons déjà vu que l’accroissement de la dette financière ne provenait pas d’une augmentation de l’investissement public, bien au contraire. Mais il est également nécessaire de savoir si l’accroissement de la dette a financé un effort spécifique en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche.
En effet, si ces dépenses n’apparaissent pas dans les comptes comme des investissements publics, elles peuvent cependant contribuer fortement à la croissance de demain.
Il ne s’agit pas d’affirmer qu’il serait aujourd’hui pertinent d’augmenter les dépenses publiques dans ces deux domaines, mais uniquement de souligner que notre dette aurait été plus utile si elle avait permis de renforcer ce type de dépenses. Or, cela n’a pas été le cas.
L’enseignement supérieur
En France, alors que le niveau de la dépense publique totale est l’un des plus élevés de l’Union européenne, la dépense publique d’enseignement supérieur par élève reste d’un niveau moyen. Cette situation contraste avec celles de la Suède et du Danemark. Ces États sont les seuls en Europe à avoir un niveau de dépense publique supérieur au nôtre, en pourcentage de la production nationale. Mais ils ont une dépense publique d’enseignement supérieur par étudiant nettement plus élevée que celle de la France.
On pourrait objecter que la dépense publique totale d’enseignement supérieur (État et collectivités territoriales) s’est accrue en volume de 3,2 % par an en moyenne entre 1980 et 2004, soit plus vite que l’ensemble des dépenses de l’État et des collectivités territoriales (2,7 %).
Cette analyse est cependant trop rapide. Il convient en effet de tenir compte de l’évolution du nombre d’étudiants sur cette période.
Lorsque l’on intègre ce facteur, la dépense publique totale d’enseignement supérieur par étudiant n’a en réalité augmenté que de 0,4 % par an entre 1980 et 2000, soit 1,6 point de croissance de moins que la dépense de l’État et des collectivités territoriales par habitant. Si la dépense publique d’enseignement supérieur par étudiant avait évolué au même rythme que l’ensemble des dépenses de l’État et des collectivités territoriales par habitant – ce que l’on ne pourrait toujours pas qualifier « d’effort particulier » pour l’enseignement supérieur – elle serait aujourd’hui supérieure de 40 %.
L’accroissement de notre dette financière n’a donc pas financé un effort public particulier dans l’enseignement supérieur, qui nous aurait permis d’être mieux placés en la matière que nos partenaires.
La recherche-développement
En ce qui concerne la recherche, le niveau de dépense global, c’est-à-dire à la fois public et privé, est en France dans la moyenne des pays développés (2,1 % de la production nationale). Dans de nombreux pays, la dépense est en revanche largement plus importante ; en Suède, elle est deux fois plus élevée.
Certes, cette situation s’explique pour partie par des financements privés de la recherche plus faibles en France que dans d’autres pays. Mais ce qui est étonnant, c’est que sur les dix dernières années, alors que la dette augmentait de 3,5 % par an en € constants et la dépense publique de 2 %, l’effort de recherche a fortement diminué, passant de 2,4 à 2,1 % de la production nationale, et ce en raison de la diminution des dépenses publiques de recherche, qui sont passées de 1 à 0,8 point du PIB.
Au total, la part des dépenses publiques qui permettront de créer plus de richesses demain a diminué ces dernières années. L’augmentation des dépenses publiques et de la dette n’a donc pas servi à renforcer notre potentiel de croissance future.
Sur les dix dernières années, la part des dépenses de recherche dans la richesse nationale a diminué en France. Les financements privés sont restés à peu près stables. Ce sont les financements publics qui ont diminué.
Il est impossible d’affecter l’augmentation de la dette à certaines catégories de dépenses publiques. En effet, dans les comptes des administrations publiques, il n’existe qu’un seul déficit, qui est la différence entre toutes les recettes et toutes les dépenses, sans que l’on sache identifier précisément les dépenses qui ont été financées par de la dette. Il n’existe que deux exceptions : la Sécurité sociale et l’assurance chômage. Pour ces deux catégories de dépenses, la dette est précisément identifiée.
La Sécurité sociale regroupe les dépenses d’assurance maladie, de retraite, de dépendance, les prestations familiales, et la prise en charge des accidents du travail et des maladies professionnelles. Jusqu’à la fin des années 1980, la Sécurité sociale ne s’était pas endettée. La situation a radicalement changé à partir du début des années 1990. En quinze ans, la Sécurité sociale a accumulé une dette qui s’élèvera, en tenant compte des déficits attendus en 2005 et 2006, à environ 110 milliards d’€ fin 2006. Cette dette provient exclusivement des dépenses d’assurance maladie.
Financer par endettement ce type de dépenses, c’est décider de reporter le coût de nos dépenses de tous les jours sur les générations futures. Cela signifie que les générations futures devront faire face à deux problèmes : leurs propres dépenses sociales, et le report très contestable de nos propres dépenses sociales de ces quinze dernières années.
Concrètement, jusqu’en 2020 au moins, les actifs assumeront une dette correspondant à nos dépenses courantes de santé des années 1990 à 2006. Dans le même temps, ils devront faire face à leurs propres dépenses de santé. Ils paieront donc deux fois.
À cet égard, il n’y a pas lieu de considérer que la décision récente du Conseil constitutionnel permettra désormais d’empêcher l’augmentation de la dette sociale. Le Conseil a certes considéré que le principe selon lequel tout nouveau transfert de dette à la CADES devrait être compensé par des ressources s’imposait au législateur. Mais ce principe n’est pas très contraignant pour au moins deux raisons. D’une part, le recours au déficit reste toujours possible. D’autre part, les nouvelles ressources de la CADES peuvent ne pas être des ressources supplémentaires, mais simplement des ressources existantes d’autres administrations publiques, ce qui, toutes choses égales par ailleurs, aboutirait à l’augmentation de l’endettement de ces dernières.
L’assurance chômage a également eu recours ces dernières années à l’endettement, alors même qu’il est tout aussi injustifié de demander aux actifs de demain de financer nos propres dépenses d’indemnisation du chômage en plus des leurs.
L’endettement actuel de l’assurance chômage s’élève à 14 milliards d’€ environ. Il s’est constitué entre 2001 et 2005. Entre 1997 et 2001, la croissance a été forte et le chômage a fortement diminué (près de 900 000 chômeurs en moins). En l’absence de mécanismes permettant de se préparer aux retournements conjoncturels, les excédents accumulés pendant cette période n’ont pas été mis en réserve en prévision de futures phases de ralentissement économique. Ils ont en partie permis de financer la nouvelle architecture du système d’assurance chômage mise en place par la convention de 2001. Sur les 14 milliards d’€ de dette, la moitié provient de cette réforme de l’assurance-chômage.
L’autre moitié résulte de l’augmentation du chômage depuis 2001. Comme excédents accumulés pendant la phase de forte croissance n’avaient pas été suffisamment conservés, l’assurance-chômage a dû emprunter.
L’actuelle convention d’assurance chômage, adoptée en 2003, ne permettra pas de dégager des excédents suffisants pour rembourser rapidement cette dette, même si le chômage structurel devait baisser significativement dans les prochaines années. Le financement des prestations chômage des années 2001 à 2005, risque donc de peser encore pendant de nombreuses années sur les actifs.
Au total, en raison de ces choix très contestables, nos enfants auront à financer nos dépenses de santé et peut-être d’indemnisation du chômage actuel en plus des leurs.
Comme nous l’avons vu, ce n’est pas l’augmentation des dépenses publiques les plus utiles au renforcement de notre croissance potentielle qui est à l’origine de l’accroissement de la dette publique, mais celle des dépenses de fonctionnement des administrations publiques et des dépenses de transfert.
Il ne s’agit pas ici de critiquer globalement l’action des administrations publiques depuis vingt-cinq ans. Celle-ci a permis d’améliorer la qualité de vie des Français, par exemple en développant le réseau de transport et en améliorant la performance du système de soins. Elle a également su renforcer, année après année, les mécanismes de solidarité en élargissant par exemple l’accès aux soins, en garantissant une retraite minimale aux plus modestes, ou en prenant en charge de nouveaux risques, comme la dépendance.
Mais lorsque l’on s’intéresse à la situation financière des administrations publiques, on doit nécessairement s’intéresser au rapport entre le coût de l’action publique et les résultats auxquelles elle aboutit. Or, une analyse des dépenses publiques actuelles, à partir d’informations accessibles, met en évidence dans différents domaines que la gestion de certaines dépenses pourrait être plus rigoureuse. L’action publique pourrait être dans différents cas aussi efficace avec un niveau de dépenses inférieur.
En fait, le recours à la dette a permis de limiter la contrainte de financement des administrations publiques, et, en conséquence, d’éviter de s’interroger sur le niveau de leurs dépenses et l’efficacité de leur gestion. Ce constat vaut particulièrement pour l’État et la Sécurité sociale, pour lesquels le recours à l’endettement a compensé, dans certains cas, une gestion peu rigoureuse des dépenses.
Dans le cas des collectivités territoriales, l’analyse est plus complexe. On ne peut pas dire que les collectivités territoriales aient cédé à la facilité du recours à l’endettement. On ne dispose pas d’informations globales qui permettraient de porter un jugement général sur l’efficacité de leur gestion. Mais on doit s’inquiéter de la rapidité de la croissance de leurs dépenses. Et il faut souligner que leur mode de financement, qui repose pour une large partie sur l’État, ne garantit pas la maîtrise des dépenses locales.
Ces dernières années, l’État n’est pas resté immobile. Dans plusieurs secteurs, il est parvenu à se réformer. De nombreux exemples en témoignent. L’État a su changer radicalement son mode d’action, par exemple en passant à l’armée de métier. Il a également déployé des efforts notables pour améliorer l’efficacité de ses missions, notamment dans la gestion de l’impôt. Il a engagé une réflexion sur ses moyens, en prenant conscience des faiblesses de sa gestion des ressources humaines, mais aussi de celles de son patrimoine immobilier.
Mais comment apprécier l’ampleur de ces évolutions ? Alors que son champ d’action a profondément évolué, que le secteur privé français a considérablement amélioré sa productivité, au point d’assurer le plus souvent sa compétitivité au niveau européen ou mondial, l’État a-t-il fait tout ce qu’il aurait dû faire ?
Non, notamment parce qu’il a commencé son adaptation tardivement, alors que son environnement a quant à lui commencé à évoluer il y a près de vingt ans maintenant.
D’abord parce que les missions de l’État ont considérablement changé depuis le début des années 1980. Une partie de ses compétences ont été transférées aux collectivités territoriales. Dans le même temps, de nombreuses entreprises publiques ont été privatisées. Hier opérateur, l’État a ainsi évolué vers un rôle de régulateur. Concrètement, dans de nombreux cas, l’État est censé intervenir aujourd’hui différemment en ne gérant plus directement, mais en encadrant d’autres acteurs. Ensuite parce que l’évolution des méthodes de travail s’est également accélérée dans les deux dernières décennies, sous l’effet notamment du développement des technologies innovantes. L’utilisation des technologies de l’information a été l’un des facteurs essentiels de l’amélioration de la productivité du secteur privé.
Ce contexte aurait justifié que l’État, soucieux d’améliorer sa situation financière, tire partie de toutes ces opportunités pour réduire ses moyens. Or, ce n’est pas ce qui s’est produit, puisqu’il ne les a pas réduits, mais les a au contraire accrus.
L’évolution de la masse salariale
Entre 1993 et 2004, la masse salariale de l’État a augmenté en moyenne de 1,3 % par an en volume, contre 0,6 % pour l’ensemble des dépenses de l’État. Sur la même période, les effectifs de l’État se sont accrus de 0,6 % par an.
Autrement dit, la masse salariale a été largement plus dynamique que les autres dépenses. Son augmentation provient pour moitié de la croissance des effectifs, et pour moitié de l’augmentation du niveau des rémunérations.
Porter un jugement sur la politique de rémunération de l’État nécessiterait une analyse approfondie et détaillée dont la Commission n’avait pas les moyens. Cela supposerait notamment de distinguer précisément les effets respectifs des décisions de revalorisation d’un côté et, de l’autre, l’évolution des qualifications des agents, de l’autre, ce qui est difficile.
On peut en revanche analyser plus en détail l’augmentation des effectifs.
Celle-ci diverge selon les ministères. En nombre, d’après les informations publiques, l’essentiel de la hausse repose sur le ministère de l’Éducation nationale (+ 187 000, + 19 %), de l’Intérieur (+ 29 000, + 20 %), de la Justice (+ 24 000, + 51 %), de la Culture (+ 3 000, + 24 %) et de l’Agriculture (+ 3 000, + 8 %). Sur la même période, seuls les effectifs du ministère des Affaires étrangères (- 14 000, - 42 %) et de la Défense (- 35 000, – 8 %) ont significativement diminué. Les effectifs du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie ont également diminué, mais plus faiblement (- 8 000, - 4 %).
Compte tenu des délais très courts qui lui étaient fixés, la Commission n’a pas pu s’engager dans des contrôles de ces données. Certaines des évolutions surprenantes constatées sont certainement tout à fait explicables, notamment par des changements de périmètres (par exemple dans le cas des ministères des Affaires étrangères ou de l’Intérieur).
Il est cependant significatif que les explications correspondantes ne soient pas bien connues : dans notre pays, le sujet de l’efficacité de la dépense publique n’est pas encore suffisamment au centre des préoccupations.
On peut cependant avancer plusieurs constats.
De 1982 à 2003, les effectifs de l’État ont augmenté de 310 000 agents, soit 14 %. En 2003, ils s’élevaient à 2,5 millions d’agents, soit la moitié des effectifs de la fonction publique. Or, pendant cette période, plusieurs vagues de décentralisation ont transféré des fonctions de l’État aux collectivités locales. En outre, cette période a été marquée par l’informatisation des fonctions administratives, dans le secteur public, comme dans le secteur privé. Dans les entreprises, cela a conduit à une réduction très substantielle des effectifs des services administratifs concernés.

Évolution des effectifs de la fonction publique 1982-2003
On pourrait penser que l’essentiel de la hausse des effectifs est dû à la réduction du temps de travail. Mais ce n’est pas vrai. 85 % de l’augmentation des effectifs constatée entre 1982 et 2003 a eu lieu avant le passage aux 35 heures.
Pour certains des ministères, la charge de travail a pu augmenter. C’est le cas au ministère de la Justice. Mais, pour d’autres, les évolutions des effectifs interpellent.
Dans le cas du ministère de l’Éducation nationale, la forte augmentation du nombre d’enseignants résulte, comme nous le verrons, de la priorité accordée à la diminution du nombre d’élèves par classe et de la multiplication des enseignements à l’école et au collège sans que l’organisation générale du système soit assouplie.
Au ministère de l’Agriculture, les effectifs ont augmenté de 8 % entre 1982 et 2003, (de 36 145 à 38 857) alors que le nombre d’exploitations agricoles a diminué de plus d’un tiers pendant cette période.
Dans le cas du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, la Commission a pu conduire une analyse plus fournie, en raison d’un accès plus direct à l’information. La longueur relative des développements consacrés dans la suite du rapport à ce ministère ne signifie pas qu’il a une gestion peu rigoureuse. Bien au contraire, il a été le premier à s’engager sur la voie de la réforme et a déjà enregistré des résultats encourageants. Il se trouve simplement qu’il a déjà procédé à des études sérieuses du problème, et que celles-ci ont été mises à la disposition de la Commission. Ces informations ont été utiles parce qu’elles permettent de constater que ces services ont été capables de s’adapter ; elles permettent également d’établir l’existence de réelles marges de manoeuvre pour l’État. Dans ce ministère, les effectifs ont diminué de 4 % depuis vingt-cinq ans. Mais cette baisse doit être relativisée au regard du potentiel d’économies.
En effet, sur 180 000 agents, 135 000 travaillent à la Direction générale des impôts (DGI) et à la Direction générale de la comptabilité publique (DGCP), c’est-à-dire dans des fonctions dont une large partie est quasi industrielle. Or, sur ce type de fonction, des gains de productivité importants sont forcément concevables, d’autant plus que les deux directions ont très fortement renforcé leur informatisation.
Certes, les deux directions réduisent actuellement leurs effectifs (1 200 emplois chaque année depuis 2000). Elles représentent la moitié des suppressions d’emploi dans la fonction publique d’État ces dernières années, alors même qu’elles représentent moins de 10 % des effectifs de celle-ci.
Mais les suppressions de postes réalisées par la DGI et la DGCP ne permettent pas d’apprécier l’ampleur de l’effort accompli par rapport aux gains de productivité possibles, faute d’informations sur le nombre de postes de travail qui ont été ou qui pourraient être théoriquement libérés par les progrès de l’informatique et de l’organisation et la disparition de missions.
Il existe toutefois des indices forts laissant penser que les diminutions d’effectifs sont faibles compte tenu de l’importance des opérations d’informatisation réalisées et des conséquences de la perte de certaines missions.
En ce qui concerne les opérations d’informatisation, alors que les deux directions ont engagé un programme informatique de grande ampleur (1 milliard d’€ sur dix ans), le rythme des réductions d’effectifs n’a pas augmenté. Une étude indépendante a estimé que les gains de productivité potentiels pour la seule DGI à un multiple des suppressions de postes en cours.
La DGCP offre par ailleurs un exemple de la façon dont sont aujourd’hui traitées les pertes de mission. En 2005, la DGCP a supprimé environ 650 emplois. Ceci représente environ 1,5 % de ses effectifs, et le non-remplacement de la majeure partie des départs en retraite. On pourrait donc considérer que les gains de productivité de la DGCP ont été de 1,5 %, et que la DGCP a profité de l’essentiel de ses marges de manoeuvre. Mais dans le même temps, une de ses missions a disparu (perception de la redevance audiovisuelle), ce qui a libéré environ 1 000 postes de travail. 350 postes ont été créés pour une nouvelle mission (recouvrement des amendes des radars automatiques). Les autres ont été affectés aux missions traditionnelles, dans le réseau (250) ou dans des structures support (500) nouvellement créées. Au total, le nombre de postes de travail qui ont disparu était donc beaucoup plus important que celui des départs en retraite. La productivité globale à périmètre constant s’est sans doute dégradée. Ce constat vaut plus largement pour d’autres services de l’État, qu’ils suppriment ou non aujourd’hui des effectifs. Ainsi, la Direction générale des douanes et des droits indirects conserve des effectifs très importants (19 567 emplois budgétaires en 2005 contre 20 388 en 1980). Pourtant, ses missions ont été considérablement réduites par la mise en place du grand marché intérieur européen. Contrairement à ce qu’on pourrait croire, les effectifs affectés à la surveillance n’ont pas augmenté. Et la Commission n’a disposé d’études que pour le seul ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie qui est sans doute le plus avancé en matière d’économies de gestion, il faut le répéter.
En définitive, la recherche de gains de productivité n’a pas constitué, pendant ces vingt-cinq ans, une priorité de la gestion des administrations publiques.

Évolution des emplois budgétaires de la Direction générale des douanes
Les autres dépenses de fonctionnement
En ce qui concerne l’immobilier, le parc de l’État a augmenté. Mais aussi étonnant que cela paraisse, il n’est pas possible de savoir précisément de combien. Cette méconnaissance du parc immobilier est un handicap sérieux pour la mise en place d’une gestion efficace. D’autres pré-requis indispensables à une gestion moderne de la fonction immobilière font également défaut. En effet, seul un petit nombre de services calcule des ratios d’occupation par agent et pratiquement aucun ne mesure le coût total de la fonction immobilière. En outre, les administrations publiques ne sont pas incitées à gérer efficacement leur parc immobilier, puisque les immeubles possédés par l’État sont mis gratuitement à la disposition des services qui les occupent.
L’État a pris conscience de son retard en matière immobilière. Une réforme intéressante est en voie d’application : la mise en place de loyers pour les locaux mis aujourd’hui gratuitement à disposition, ce qui permettra de sensibiliser les services administratifs au coût de leurs bureaux.
Les progrès demeurent cependant très lents. Les meilleures techniques de gestion immobilière ne sont toujours pas mises en oeuvre, plus de quinze ans après leur première application dans le secteur privé. Grâce à ces techniques, plusieurs acteurs industriels majeurs, de taille comparable à certains grands ministères, ont su réduire leurs coûts immobiliers de près de 50 % depuis dix ou quinze ans, en réduisant le nombre et le coût du m².
Dans ces conditions, l’État ne sait pas combien exactement lui coûte un agent public tout compris (coût immobilier, dépense informatique...). Il fonde donc ses décisions de recrutement sur une connaissance partielle des coûts, limitée au seul coût salarial. Et il ne peut en général pas assurer l’utilisation la plus efficace de ses surfaces. Les universités, dont le coût immobilier est en partie à la charge de l’État, sont un cas intéressant. Celles-ci ont suffisamment de locaux pour accueillir les étudiants, d’autant plus que le nombre de ces derniers diminue (- 4 % entre 1997 et 2003). La priorité en matière immobilière devrait donc être de rénover le parc existant, voire de le mettre aux normes de sécurité, or, il a été choisi, au contraire, de construire de nouveaux bâtiments, sans fermer les anciens. Les surfaces ont ainsi augmenté de plus de 1,7 million de m², soit 15 %, entre 1997 et 2003. Ces surfaces supplémentaires, qui, en partie, n’étaient pas indispensables, ont coûté à l’État et aux régions plus de 3 milliards d’€ (L’opportunité de créer un opérateur national de paye, rapport de l’Inspection générale des finances, 2005.)
Au-delà de l’immobilier, et sans entrer dans le détail, on ne peut qu’être frappé par les écarts de coût de fonctionnement constatés entre les services d’un même ministère (1). Ainsi, les dépenses courantes par agent au sein des directions du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie – qui, rappelons-le, est largement en avance sur les autres ministères – varient dans une fourchette très large. À la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, suivant les régions, les coûts de fonctionnement par agent – hors salaires – varient dans un rapport 1 à 3.
(1) La gestion immobilière et financière des universités, rapport de l’Inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche, du Conseil générale des ponts et Chaussées et de l’Inspection générale des finances, 2003.
Il semble que des écarts très importants existent également entre les ministères. L’Inspection générale des finances a ainsi constaté 1 que pour préparer la paye de cent agents de l’État, le nombre d’agents nécessaires varie, selon les départements et selon les ministères, dans un rapport de 1 à 9. Au-delà de cet exemple, il n’est malheureusement pas possible d’évaluer précisément les écarts de coût de fonctionnement entre ministères. Contrairement aux entreprises, les services administratifs ne suivent pas en effet dans la plupart des cas leurs coûts par fonction, ce qui rend impossible la détermination d’un coût de fonctionnement par agent fiable.
Au total, ces exemples, tirés de différentes missions d’enquête des services d’inspection de l’État, montrent que les méthodes de gestion des dépenses de fonctionnement des administrations publiques sont assez décalées par rapport à celles des grandes organisations du secteur concurrentiel, dont la gestion est devenue de plus en plus rigoureuse au cours des deux dernières décennies. Une évolution parallèle à celle des entreprises aurait probablement permis d’infléchir significativement l’évolution de la dépense publique, et donc des déficits. Ce retard relatif a une contrepartie positive : l’existence de marges substantielles de progrès pour l’avenir dans ce domaine.
Ce rapport n’a ni l’ambition ni la capacité d’effectuer une analyse exhaustive de l’efficacité des politiques publiques conduites par l’État.
La Commission a seulement essayé, ponctuellement, d’analyser certaines dépenses de l’État, en comparant leurs coûts à leur efficacité, au sein d’ensembles qui représentent une part importante du budget : les dépenses pour l’emploi (35 milliards d’€), l’enseignement scolaire (environ 60 milliards d’€) et les infrastructures de transport (4 milliards d’€). Il va de soi que la Commission n’est pas en mesure de porter un jugement global sur ces politiques. Elle a seulement relevé certains indices qui conduisent à s’interroger sur l’utilité de certaines dépenses, en termes d’efficacité. Une gestion rigoureuse, conduisant à une plus grande sélectivité, aurait sans doute permis de réduire certaines dépenses, et donc le déficit public.
L’efficacité de certaines dépenses pour l’emploi
Il y a longtemps que la France n’a plus connu le plein emploi. Depuis de nombreuses années, notre pays présente en effet un niveau de chômage élevé et une durée moyenne de chômage très importante. Un grand nombre de personnes n’accèdent pas au marché du travail chez les jeunes et parmi les personnes de plus de 55 ans. Dans ce contexte, l’amélioration de la situation de l’emploi est depuis très longtemps la priorité de nos politiques publiques. Les dépenses pour l’emploi ont constamment augmenté et représentent aujourd’hui 35,4 milliards d’€, soit 15 % du budget de l’État, hors charges d’intérêt.
Force est de constater que dans le domaine de l’emploi l’action publique est difficile. Il ne faudrait pas déduire de la situation du marché de l’emploi que les politiques menées sont globalement inefficaces. La question n’est pas de critiquer la pertinence de la politique de l’emploi dans son ensemble, mais simplement de s’interroger sur l’impact de certaines mesures au regard de leur coût. C’est une réflexion qu’il est nécessaire de mener pour la politique de l’emploi comme pour toutes les autres politiques publiques. Mais dans le domaine de l’emploi plus peut-être que dans tous les autres, l’opinion publique attend des gouvernements des résultats très rapides.
L’obligation d’afficher rapidement des résultats ne favorise pas l’analyse des dispositifs existants mais renforce au contraire l’incitation à les pérenniser et à en proposer de nouveaux. Ceci peut aboutir au maintien pendant un certain nombre d’années de dispositifs qui n’ont pas eu l’efficacité escomptée.
Les préretraites en sont un exemple particulièrement frappant. À l’origine, dans les années 1960, ce type de mesure devait permettre aux personnes exerçant une activité particulièrement pénible de partir à la retraite de manière anticipée, dans des secteurs industriels par ailleurs en difficulté ou en mutation. Les préretraites avaient donc vocation à s’appliquer de manière ciblée.
Dans les années 1980 et 1990, leur application a cependant été généralisée, afin de réduire le nombre de chômeurs. Outre son coût élevé pour les finances publiques, cette généralisation a finalement eu un effet négatif sur l’emploi, en réduisant le taux d’activité des personnes de plus de 50 ans. Mais la décision de supprimer l’essentiel des dispositifs de préretraite est intervenue tardivement.
Les subventions à l’emploi dans le secteur non marchand mériteraient aujourd’hui probablement une analyse. Ce type d’instrument peut avoir un effet positif, à condition qu’il constitue un véritable moyen d’accéder à un emploi stable dans le secteur marchand. Or, pour certains types de contrats aidés, l’efficacité au regard de cet objectif semble insuffisante. Certes, ces contrats permettent de maintenir des personnes fragiles dans une situation d’activité, ce qui peut être souhaitable lorsque le chômage est très élevé. Mais selon certaines études, les perspectives de leurs bénéficiaires sur le marché du travail seraient moins bonnes que celles des personnes présentant les mêmes caractéristiques socioprofessionnelles et n’ayant pas bénéficié de la mesure (Cf. DARES, Les politiques de l’emploi et du marché du travail (2003) ainsi que P. Cahuc et A. Zylberberg, Le chômage, fatalité ou nécessité ?, édition Flammarion, 2004.).
L’exemple de la prime pour l’emploi (PPE) confirme encore que dans le domaine de l’emploi il est nécessaire de s’assurer rapidement de l’efficacité des mesures mises en oeuvre, pour éviter que des dispositifs, bons dans leur principe, n’aient des résultats inférieurs aux attentes. La PPE est un dispositif d’incitation à l’activité. Ce type de mesure, qui a été mis en oeuvre avec succès dans plusieurs pays développés, peut avoir un effet positif sur l’emploi des peu qualifiés, en permettant d’accroître l’écart de rémunération entre l’activité et l’inactivité.
Mais telle qu’elle a été mise en oeuvre en France jusqu’à présent, la prime pour l’emploi est coûteuse pour les finances publiques (2,5 milliards d’€), sans que son efficacité semble à la hauteur. Pour l’être, elle devrait sans doute être réservée à un petit nombre de foyers, ce qui permettrait d’avoir un montant individuel élevé, C’est en tout cas ce que semble indiquer l’exemple de la Grande-Bretagne. Or, en France, elle est aujourd’hui attribuée à près de 9 millions de personnes. En conséquence, le montant moyen est très faible (23 € par mois), et ses effets sur l’emploi nécessairement limités.
On le comprend, dans le domaine de l’emploi, l’analyse permanente de l’efficacité des dispositifs est indispensable. C’est un domaine dans lequel la complexité des mécanismes économiques en jeu ne permet pas d’être sûr, au moment où l’on met en place une mesure, de ses effets exacts. Ce réflexe, qui gagnerait aujourd’hui à être développé dans le domaine de l’emploi, est un enjeu majeur pour réduire l’inactivité et le chômage, et donc pour renforcer notre croissance économique future.
L’efficacité de la dépense d’enseignement scolaire Sur les vingt-cinq dernières années, les pouvoirs publics ont choisi de manière constante d’augmenter les moyens consacrés au premier et surtout au second cycles. Ainsi, depuis 1980, la dépense publique d’éducation par élève a augmenté de 2,4 % par an dans le secondaire en € constants et de 2,2 % par an dans le primaire.
Les comparaisons internationales permettent d’apprécier l’ampleur de l’effort de la France en la matière. Notre pays consacre aujourd’hui pour son enseignement primaire et secondaire 1 point de PIB de plus que les autres pays de l’OCDE, et un élève dans le secondaire coûte 36 % de plus en France que dans les pays de l’OCDE en moyenne.
L’augmentation des moyens a été utilisée pour financer trois types d’actions. D’une part, la diminution du nombre d’élèves par classe : le nombre d’enseignants dans le primaire et le secondaire a augmenté de 12 % depuis 1990 alors que dans le même temps le nombre d’élèves dans le primaire et le secondaire diminuait de près de 5 %. D’autre part, l’augmentation du nombre d’enseignements (enrichissement de la palette d’options dans l’enseignement général, spécialisation sans cesse accrue des enseignements professionnels), ce qui a parallèlement réduit le nombre d’élèves par enseignant. Enfin, le renforcement des moyens dans les zones d’éducation prioritaire.
Mais cette augmentation des moyens ne semble pas avoir permis une amélioration des résultats du système scolaire français à la hauteur de l’effort budgétaire consenti. Trois indicateurs en témoignent. D’après les enquêtes internationales (Third International Mathematics and Science Study – TIMSS – de 1995 ; PISA de l’OCDE en 2000 ; Commission européenne, 2004) la performance de la France en mathématiques, en sciences, en compréhension de l’écrit et en langues étrangères apparaît moyenne.
La proportion des élèves qui sortent du système secondaire avec seulement le brevet ou sans diplôme stagne à environ 20 % depuis 1995. Le nombre de bacheliers, qui s’était fortement accru au cours des années 1980 (de 30 % en 1985 à plus de 60 % en 1995 d’une classe d’âge), n’augmente plus.
Surtout, les inégalités face à l’éducation restent fortes. Entre 1970 et 1993, la probabilité pour un enfant de cadre ou de chef d’entreprise d’avoir un meilleur diplôme qu’un enfant d’ouvrier est restée sept fois supérieure à la probabilité de la situation inverse. Entre ces deux dates, le lien entre diplômes des parents et diplôme des enfants se serait d’ailleurs renforcé.
La Commission n’a naturellement ni la capacité, ni les moyens de se prononcer sur la problématique générale de l’éducation en France. Mais la déconnexion que l’on constate entre la forte augmentation des moyens consacrés à l’enseignement scolaire ces vingt-cinq dernières années et les performances du système scolaire a fait l’objet d’analyses de spécialistes, dont les conclusions sont connues.
Il apparaît tout d’abord que les difficultés rencontrées par notre système scolaire ne peuvent être résolues par la seule augmentation des moyens. Au demeurant, l’OCDE a mis en évidence, dans ses comparaisons internationales, que la performance des systèmes scolaires ne reflète pas nécessairement l’effort budgétaire qui leur est consacré.
Ensuite, à supposer qu’une augmentation des moyens sans changement d’organisation puisse avoir un effet, les conditions dans lesquelles elle a été mise en oeuvre en France semblent avoir limité ses chances qu’elle soit efficace.
Ainsi, la réduction de la taille des classes n’a un impact sur les performances des élèves que si elle est très significative, ou si elle est 80 Rompre avec la facilité de la dette publique ciblée sur les populations les plus en difficulté. En France, la diminution a été marginale (deux élèves en moins par classe dans le secondaire depuis 1990) et a concerné l’ensemble des établissements. Son efficacité est donc incertaine, d’après ces études. Elle a dû néanmoins être coûteuse. Une diminution du nombre d’élèves se traduit en effet mécaniquement par une augmentation à due proportion de la masse salariale.
Le renforcement des moyens alloués aux établissements des zones d’éducation prioritaire répond également à des motivations incontestables. Mais plutôt que d’allouer beaucoup de moyens à un nombre limité d’établissements, le choix a été fait de renforcer de manière marginale les moyens d’un grand nombre d’établissements. 17 % des écoliers et des collégiens sont désormais concernés par le dispositif, contre 8 % en 1982, mais les ressources que les établissements reçoivent par élève ne sont supérieures que de 10 % à celles des autres établissements, ce qui est faible en comparaison des politiques conduites aux mêmes fins par d’autres pays. L’étude la plus récente sur ce sujet a mis en évidence que le dispositif des Zones d’éducation prioritaires (ZEP), s’il était beaucoup plus ciblé, pourrait diminuer nettement plus significativement l’écart de réussite entre élèves de ZEP et ceux hors-ZEP (L’impact de la taille des classes et de la ségrégation sociale sur la réussite scolaire dans les écoles françaises : une estimation à partir du panel primaire 1997 ; Thomas Piketty EHESS, mai 2004.).
Pour résumer, l’importance de l’effort budgétaire consenti pour l’enseignement scolaire n’a pas eu les résultats escomptés, sans que les conditions de l’utilisation des dépenses fassent l’objet d’une analyse critique et d’un aménagement.
La pertinence des projets d’infrastructures de transport
Il n’entre naturellement pas dans le champ de compétence de ce rapport d’apprécier la légitimité des grandes orientations de la politique des transports depuis la fin des années 1970. En revanche, d’après les informations recueillies par la Commission, un écart assez systématique existerait entre la rentabilité attendue au moment du lancement du projet et celle qui est constatée au moment de sa mise en service. Cet écart laisse penser qu’en matière d’infrastructures, le processus de décision ne garantit pas l’optimisation de l’utilisation des dépenses publiques.
L’appréciation de la rentabilité des projets d’infrastructure est par nature une question extrêmement délicate. Contrairement à un projet d’investissement privé, la rentabilité économique n’est en effet pas le seul déterminant. La rentabilité sociale doit également être prise en compte, même si elle est difficile à appréhender. Les effets sur l’environnement, sur la qualité de vie ou sur l’aménagement du territoire se prêtent peu à une mesure objective et sont très difficiles à comparer à la rentabilité économique.
La rentabilité des projets d’investissements publics est donc très difficile à estimer au moment de la prise de décision, c’est-à-dire cinq, dix ou quinze ans avant la mise en service. Mais ceci ne suffit pas à justifier les faiblesses qu’une étude de la Direction générale du trésor et de la politique économique a identifiées dans le processus de décision.
Premièrement, le coût des projets est souvent sous-estimé.
Pour ce type de projet, ceci n’est pas en soi étonnant. Des facteurs objectifs peuvent en effet expliquer que le coût des projets soit à l’arrivée plus élevé que prévu. Mais l’écart entre les coûts prévus et les coûts constatés semble être particulièrement élevé pour les infrastructures de transport public, tout particulièrement dans le domaine ferroviaire. Ainsi, pour la ligne « Grande Vitesse Nord », les surcoûts après déclaration d’utilité publique auraient été de 30 %.
Deuxièmement, les gains attendus, tant économiques que sociaux, sont souvent largement surestimés. Dans le domaine ferroviaire, le trafic sur la ligne « TGV Atlantique » serait inférieur de 30 % aux prévisions. La sous-estimation des coûts et la surestimation des gains conduisent à largement revoir à la baisse la rentabilité globale des projets.
D’après l’étude du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, la rentabilité prévisionnelle d’un projet d’infrastructure ferroviaire serait, en moyenne, divisée par deux entre les études préliminaires et la déclaration d’utilité publique. Et encore par deux entre cette dernière et la mise en service. Au total, la rentabilité constatée serait quatre fois plus faible que la rentabilité estimée au moment du lancement de la réflexion.
Il est frappant de relever que de tels biais aient été à plusieurs reprises constatés, sans que cela ait conduit à être plus rigoureux dans les critères de lancement des projets d’infrastructures publiques. Ici encore, la facilité du recours à l’endettement a permis de ne pas gérer certaines dépenses avec la rigueur nécessaire.
Une approche globale pourrait laisser penser que notre système de santé est pleinement efficace et que la forte croissance des dépenses d’assurance maladie est totalement justifiée.
Les indicateurs usuels de mortalité et de morbidité sont satisfaisants, ce qui attesterait de l’efficacité des dépenses d’assurance maladie. Par exemple, la mortalité infantile est près de deux fois moins élevée en France qu’aux États-Unis pour un niveau de dépenses de santé près de 30 % plus faible, et l’espérance de vie y est supérieure de deux ans.
L’augmentation des dépenses de santé, qui sont passées entre 1960 et 2005 de 3,5 à 10 % du PIB, n’indique pas nécessairement que celles-ci ont atteint un niveau excessif. Cette augmentation n’est en effet pas anormale. Dans les années 1950 à 1970, la mise en place de l’assurance maladie, l’amélioration des structures de soins et l’enrichissement des populations, ont rendu la santé beaucoup plus accessible. Et si la tendance à l’augmentation des dépenses de santé se poursuit aujourd’hui, c’est du fait de la conjonction du vieillissement des populations, de la découverte de nouvelles thérapeutiques et également de l’aspiration à une meilleure santé et à plus de soins.
Ces arguments laissent penser que la croissance des dépenses d’assurance maladie est largement justifiée. La facilité offerte par le recours à l’endettement a conforté cette interprétation en permettant de ne pas avoir à analyser en profondeur l’efficacité de ces dépenses.
Pourtant, comme l’a souligné le Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie dans ses avis et ses rapports ces deux dernières années, les zones de non-qualité sont nombreuses en la matière.
Les dépenses d’assurance maladie se sont élevées à 130 milliards d’€ en 2004. Elles se répartissent de manière pratiquement égale entre les établissements de santé (hôpitaux, cliniques, établissements pour personnes âgées et handicapées) et les soins de ville (consultations, analyses, médicaments...). Les études effectuées notamment par le Haut Conseil sur la situation de l’hôpital, la médecine libérale (généralistes, spécialistes...) ou la prescription de médicaments mettent en évidence la possibilité d’améliorer sensiblement l’efficacité des dépenses d’assurance maladie. Premier poste de dépense, l’hôpital public mobilise plus de 60 milliards d’€ par an. Il fait aujourd’hui l’objet de réformes importantes : un programme d’investissement (Hôpital 2007) et une réforme complète de son mode de financement (la tarification à l’activité). L’hôpital a certainement besoin de moderniser ses équipements et de modifier son mode de financement. Mais il a aussi, et depuis de très nombreuses années, besoin d’une rénovation de son organisation, si l’on souhaite qu’il soigne mieux et qu’il coûte moins cher.
L’hôpital peut en effet être un univers très cloisonné. Les différents services (obstétrique, chirurgie...) constituent autant d’îlots encore trop souvent indépendants au sein d’un même établissement. Cette organisation peut aboutir à des surcoûts. Chaque service a en effet ses propres moyens, humains et matériels, qu’il considère comme sa propriété et qu’il est parfois réticent à mettre à la disposition des autres quand ils en auraient besoin. En pratique, le cloisonnement par services peut conduire à un excès d’équipements et à une gestion parfois peu satisfaisante des équipes soignantes. La situation est d’autant plus difficile à maîtriser qu’il n’y a en général pas, face à ces services, de réels contre-pouvoirs. Ni au sein des établissements, car souvent les équipes administratives et les personnels médicaux se parlent peu et se comprennent mal. Ni en dehors de l’établissement, les services de l’État exerçant un suivi peu exigeant.
Dans ces conditions, personne ne rend véritablement de comptes, ni sur la qualité des soins, ni sur l’utilisation de l’argent public. Signe du peu d’attention portée à l’évaluation des établissements, il n’existe aucun indicateur de qualité à l’hôpital, ce qui est une exception française. Et les dotations budgétaires sont réparties entre les hôpitaux sans mesurer au préalable l’efficacité de ces derniers. Certains établissements ont plus, d’autres ont moins sans qu’on sache, en général, objectivement qui mérite plus et qui mérite moins. Les Centres hospitalo- universitaires (CHU) disposent ainsi depuis longtemps d’une enveloppe complémentaire, identique pour chacun d’entre eux. On la justifie par la nature particulière de leurs missions, mais personne ne semble avoir jamais mesuré si elle est trop modeste ou trop généreuse.
L’hôpital est sans doute capable de faire mieux avec autant de moyens, voire moins. L’État le sait. Mais faute d’avoir fait les efforts suffisants depuis 20 ans pour évaluer précisément les coûts et l’efficacité des hôpitaux, il ne sait pas aujourd’hui répondre à ceux qui soutiennent au contraire que l’hôpital public manque de moyens. Dans ce contexte, il utilise malheureusement toujours la même solution en cas de difficultés : augmenter les crédits. Les dépenses hospitalières ont ainsi augmenté de près de 4 % par an depuis 2000, soit 2 milliards d’€ environ supplémentaires chaque année, sans que l’on sache vraiment mesurer si ce surcroît de dépenses a été bien calibré, et bien réparti.
Deuxième poste de dépense, les soins dispensés en dehors de l’hôpital, c’est-à-dire essentiellement les consultations de médecins et les examens médicaux (plus de 40 milliards d’€ hors médicaments et dispositifs médicaux).
Comme pour l’hôpital, il y a d’abord un problème d’organisation, qui peut se traduire à la fois par des surcoûts et un risque de moindre qualité. Le système français présente en effet deux caractéristiques majeures. La première, c’est qu’il n’existe pas d’instrument efficace permettant de répartir les professionnels de santé là où on en a besoin, que ce soit dans des zones géographiques particulières ou dans des types de spécialités. La seconde, c’est que chaque professionnel de santé travaille de manière très isolée. En Île-de-France, la proportion des médecins généralistes qui travaillent seuls est de 58 %, contre 16 % au Québec ou 8,5 % au Royaume-Uni.
Cela n’est pas sans conséquence sur les dépenses d’assurance maladie. Lorsqu’il y a trop de professionnels de santé, les prescriptions tendent à augmenter. Lorsqu’il n’y en a pas assez, c’est l’hôpital, inévitablement plus coûteux, qui comble les manques. Et un médecin isolé, faute de pouvoir communiquer avec ses collègues, risque à terme d’être moins efficace dans sa pratique.
Tout ceci contribue probablement à expliquer qu’en France, sur des pathologies courantes et bien connues (traitement du cholestérol, des lombalgies...), les caisses d’assurance maladie constatent souvent des pratiques inadaptées dans 30, 40 voire 50 % des cas. C’est inquiétant pour la santé des Français. Cela a également un coût pour les comptes de l’assurance maladie.
L’organisation des soins pourrait donc être améliorée, à l’hôpital et en ville. Et malheureusement, l’hôpital et la ville fonctionnent également mal ensemble. Ils sont pensés comme deux entités séparées l’une de l’autre, entre lesquelles l’établissement de liens ne va pas de soi. C’est probablement l’une des explications essentielles de la lenteur avec laquelle se développent des modes de prise en charge plus modernes (hospitalisation à domicile, soins de suite et de réadaptation, maisons médicales...).
Ces nouveaux modes de prise en charge sont pourtant aujourd’hui essentiels pour bien soigner certaines populations (personnes âgées...) et certaines pathologies (affections longue durée : diabète...). Le retard dans ce domaine est d’autant plus préoccupant que les dépenses de santé sont de plus en plus concentrées sur les personnes âgées et les affections de longue durée.
Les nouveaux modes de prise en charge sont également indispensables pour éviter d’encombrer l’hôpital, et notamment les urgences, services très coûteux et qui accueillent trop souvent des patients qui devraient être soignés ailleurs.
Dernier poste de dépense : les médicaments qui représentent un montant global annuel d’environ 40 milliards d’€ environ, qu’ils soient fournis en pharmacie ou à l’hôpital. Les Français sont les plus gros consommateurs de médicaments au monde. Leur consommation est, sur certaines classes thérapeutiques, deux fois plus importante que la moyenne des Européens (antibiotiques, vasodilatateurs...).
Et en dépit du niveau atteint, la croissance des dépenses de médicament demeure extrêmement forte (+ 7 % par an en moyenne entre 2000 et 2004). Ce ne sont pas les prix qui augmentent. Ils ont même eu plutôt tendance à diminuer ces dernières années, avec le développement des médicaments génériques. Mais ce sont les quantités prescrites qui continuent à s’accroître très fortement.
Ceci est en partie le résultat de toutes les faiblesses du système de soins que nous venons d’analyser. À l’hôpital comme en ville, il n’y a souvent pas de contrôle de la pertinence des prescriptions. C’est également dû au fait que l’on accepte de rembourser beaucoup de médicaments dont l’intérêt médical est très réduit, ce qui coûte à l’assurance maladie plusieurs centaines de millions d’€ par an.
Les dépenses des collectivités territoriales ont connu depuis vingt-cinq ans une croissance très forte. Mais les informations nécessaires pour porter un jugement global sur l’efficacité de ce surcroît de dépenses ne sont pas disponibles au niveau national. C’est incontestablement un problème car les dépenses concernées représentent 20 % de la dépense publique.
Le faible endettement de ces collectivités, qui est en soi satisfaisant, ne garantit pas la qualité de la gestion de la dépense car les transferts financiers considérables de l’État vers ces collectivités reportent au niveau national une part importante de leurs besoins de financement.
Entre 1980 et 2004, la part des dépenses des collectivités territoriales dans la production nationale est passée de 7,9 à 10,8 %, les dépenses ayant progressé en volume de 3,4 % par an, contre 2 % pour la production nationale. Une telle évolution est préoccupante. Sur les dix dernières années, l’augmentation des dépenses d’investissement des administrations publiques provient pour les deux tiers des collectivités territoriales; pour les dépenses de fonctionnement, cette proportion est de 50 %.
Une partie de cette augmentation était inévitable. En effet, depuis vingt-cinq ans, l’État a décentralisé une large partie de ses compétences, ce qui peut justifier une augmentation significative des dépenses locales. La croissance des investissements peut notamment s’expliquer par la nécessaire remise à niveau de certains équipements transférés, en particulier les collèges et les lycées. En outre, comme les entreprises, les collectivités territoriales supportent le coût des réglementations que l’État leur impose.
D’après une étude de la Direction générale du trésor et de la politique économique, les transferts de compétence de l’État vers les collectivités territoriales n’expliqueraient cependant que la moitié de l’augmentation de la part des dépenses locales dans la production nationale. L’accroissement des dépenses locales ne serait donc pas uniquement dû aux évolutions institutionnelles.
À compétences inchangées, les dépenses des collectivités territoriales seraient passées de 7,9 à 9,5 % du PIB, de 1980 à 2004, soit une augmentation de 2,8 % en volume par an.

Dépenses des collectivités territoriales (en % du PIB)
Pour apprécier l’efficacité de ce surcroît de dépenses publiques, il serait intéressant de connaître l’évolution des dépenses par nature (investissement, fonctionnement...) pour les compétences transférées par l’État, et pour les autres compétences.
Malheureusement, cette information n’existe pas. Il est donc impossible de porter un jugement sur l’augmentation des dépenses d’intervention (subventions, prestations sociales...) et des dépenses d’investissement (infrastructures de transport), qui a été très forte mais qui pourrait s’expliquer par les transferts, également très importants, de l’État vers les collectivités territoriales.
Les dépenses de fonctionnement expliquent 60 % de l’augmentation des dépenses des collectivités territoriales sur les dix dernières années. Les collectivités territoriales emploient aujourd’hui 1,5 million d’agents, soit 450 000 de plus qu’en 1982. En vingt ans, le nombre de fonctionnaires territoriaux pour 100 habitants a augmenté de près de 30 %. Pourtant, pendant cette période, les collectivités territoriales se sont largement informatisées, et leurs dépenses informatiques continuent à progresser très rapidement (+ 12,6 % par an en moyenne ces dernières années). Tout laisse donc penser que les problèmes de gestion relevés dans l’analyse des dépenses de fonctionnement de l’État pourraient se retrouver au niveau de nombreuses collectivités locales. De nombreux rapport de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes mettent au demeurant en évidence, ici ou là, des anomalies de gestion. La multiplication rapide du nombre de ronds-points en France dans la période récente constitue peut-être à cet égard un indice de l’absence de caractère systématique des études d’efficacité des investissements locaux.
Mais pour pouvoir porter un jugement sur l’ensemble de ces évolutions, il faudrait savoir si les compétences transférées depuis vingt ans justifient l’accroissement constant des dépenses de fonctionnement et notamment des effectifs.
Il serait également intéressant de connaître les économies de dépenses de fonctionnement que la décentralisation a permis de réaliser au niveau des services de l’État.
Or, ces informations n’existent pas à un niveau global. Il est probable que certaines des collectivités disposent des informations les concernant dans ce domaine. Mais aucune consolidation des informations individuelles n’est disponible. Ou si elle existe, la Commission n’en a pas eu connaissance.
Compte tenu de ce manque de données, la Commission ne peut que rester extrêmement prudente dans l’appréciation de l’augmentation des dépenses locales depuis vingt-cinq ans. Elle ne peut que regretter que s’agissant de collectivités représentant désormais 20 % de la dépense publique, il n’existe pas d’information réellement pertinente sur la productivité de leurs services administratifs ou sur l’efficacité de leurs dépenses d’investissement et d’intervention. Cette situation est d’autant plus fâcheuse que les chambres régionales des comptes mettent régulièrement en évidence des problèmes de gestion de collectivités territoriales.
Il est difficilement explicable que l’État n’ait pas été plus loin dans l’analyse, alors même qu’il a mis en place un mode de financement qui permet aux collectivités territoriales de disposer, en large partie grâce à son budget, de ressources qui connaissent une croissance assez rapide.
En apparence, la situation financière des collectivités territoriales ne pose pas de problème. En effet, ces collectivités ont peu contribué à l’accroissement de la dette publique financière. Leur dette financière ne représente que 10,5 % de celle de l’ensemble des administrations publiques et elle a diminué en montant entre 1997 et 2002. En outre, les collectivités territoriales sont liées par une règle budgétaire fondamentale vertueuse, qui ne s’applique pas à l’État : elles ne peuvent s’endetter que pour investir. Concrètement, cela signifie que leur endettement ne peut pas financer des dépenses de fonctionnement, mais doit permettre d’apporter aux Français les instruments d’un cadre de vie et de création de richesses pour le futur.
Sur le plan financier, les collectivités territoriales apparaissent donc en première analyse dans une situation très différente de celle de l’État pour trois raisons : le niveau de leur endettement est modéré ; elles ont été capables de réduire le montant de leur dette financière six années de suite à partir de 1997 ; enfin, leur dette vise à financer des biens durables et non des dépenses de fonctionnement et de transfert.
Tout ceci pourrait donner à penser que leur gestion est globalement rigoureuse. Une telle conclusion serait cependant beaucoup trop rapide. Pour pouvoir analyser la qualité de la gestion financière des collectivités territoriales, il est nécessaire de connaître les spécificités du mode de financement mis en place par l’État.
Concrètement, les collectivités territoriales disposent de ressources s’élevant à environ 175 milliards d’€ en 2004. Celles-ci proviennent principalement de deux sources : les dotations de l’État et les impôts locaux, dont l’État assure une part croissante.
En effet, l’État verse directement aux collectivités territoriales un tiers de leurs ressources totales à travers des dotations, dont le montant atteint environ 60 milliards d’€. Il prend également en charge, par l’intermédiaire de dégrèvements et d’exonérations, une part croissante des impôts locaux (35 % contre 22 % au milieu des années 1990).
Au total, l’État assure aujourd’hui plus de la moitié des ressources des collectivités territoriales, contre environ 43 % au milieu des années 1990. Ces ressources venant de l’État sont utilisées par les collectivités territoriales principalement pour leur fonctionnement. L’État finance également une large partie de leurs investissements, par des subventions spécifiques (14 milliards d’€ en 2004), mais aussi par l’intermédiaire de la capacité d’autofinancement des collectivités territoriales. Les 75 milliards d’€ que l’État accorde aux collectivités territoriales pour leurs dépenses de fonctionnement contribuent en effet, pour une part qu’il est impossible de déterminer, à leurs 25 milliards d’€ de capacité d’autofinancement.
Du fait de ce mode de financement, les collectivités territoriales disposent de ressources importantes et en croissance assez rapide. En effet, l’État a garanti jusqu’à présent aux collectivités territoriales que leurs dotations évolueraient plus vite que l’inflation. Cet engagement lui a coûté près d’1,3 milliard d’€ pour les six dernières années.
Surtout, la prise en charge d’une part croissante de la fiscalité locale par le contribuable national permet aux collectivités de retrouver des marges de manoeuvre pour augmenter les impôts locaux. Ainsi, de 1997 à 2001, le taux de prélèvements obligatoires locaux est passé de 5,6 % de la production nationale à un peu moins de 5 %, en raison des réformes de fiscalité locale compensées par l’État. Cette baisse a permis aux collectivités territoriales de retrouver une plus grande capacité d’augmentation des impôts locaux depuis 2001, qu’elles ont utilisée depuis 2002.
Ce mode de financement, en facilitant l’accès des collectivités territoriales aux ressources, réduit probablement dans certains cas l’incitation à sélectionner les dépenses les plus efficaces.
Et le financement des collectivités territoriales reposant fortement sur l’État, le coût d’une éventuelle inefficacité de certaines dépenses locales (par exemple, de faibles gains de productivité ou des dépenses d’investissement peu utiles) est en fait supporté en partie par l’État. Et comme celui-ci s’endette pour financer ses dépenses, on peut aller jusqu’à dire que lorsqu’il y a des dépenses locales inefficaces, elles pèsent en partie sur l’endettement de l’État. Ce raisonnement illustre le caractère peu significatif de l’analyse par acteur de la dette publique. Dans le mode de financement actuel des collectivités territoriales, leur faible niveau d’endettement ne donne pas d’indication sur la maîtrise effective de leurs dépenses.
C’est donc une gestion peu rigoureuse des dépenses publiques qui explique, pour l’essentiel, l’augmentation continue de la dette publique depuis vingt-cinq ans.
Dans le secteur concurrentiel, il est impossible qu’une entreprise connaisse de manière ininterrompue des déficits sur une telle durée. Les entreprises vivent en permanence sous la pression de la concurrence, qui impose une recherche constante de maîtrise des coûts. Si leur service a un coût trop élevé, son prix l’empêche d’être vendu, soit parce qu’il dissuade le client d’y recourir, soit parce que les concurrents offrent un prix inférieur. Donc les coûts doivent être continûment ajustés, sauf à voir disparaître les services concernés, voire l’entreprise.
Les administrations publiques, pour la plupart de leurs tâches – production de services « non marchands » d’intérêt général et mise en oeuvre de politiques d’intervention économiques et sociales –, ne connaissent pas cette pression concurrentielle et n’ont pas cet indicateur de gestion qu’est le prix de marché.
Mais les niveaux des prélèvements et de la dette publique devraient jouer pour les administrations publiques le rôle des prix pour le secteur concurrentiel. Les citoyens, qui acceptent un certain niveau de prélèvements, différent selon les pays, devraient refuser des niveaux d’endettement excessifs, lorsqu’ils sont la conséquence d’une mauvaise gestion des dépenses. Ils devraient, dans ce cas, exercer, par l’intermédiaire de leurs représentants, une pression à la bonne gestion des dépenses.
Malheureusement, cet aiguillon joue très peu en France. La société française se caractérise même plutôt par une préférence pour la dépense publique et par une relative indifférence à l’endettement public. Dans ce contexte, les décideurs politiques ne sont pas incités à prendre les décisions nécessaires à la modernisation de l’appareil administratif et à une sélection plus rigoureuse des dépenses.
C’est ce qui explique qu’en dépit d’un discours volontariste sur la nécessité de moderniser les administrations publiques – ce que l’on appelle depuis des années la « réforme de l’État » – les lourdeurs et les incohérences de notre appareil administratif perdurent.
Et elles sont incontestables : les administrations publiques présentent des rigidités et des cloisonnements qui sont autant de freins à la bonne gestion de la dépense, c’est-à-dire à la sélection des dépenses les plus utiles et à l’identification des dépenses dont l’efficacité n’est pas avérée.
Pour résumer, si la dépense publique n’est pas gérée avec suffisamment de rigueur en France, c’est en première analyse en raison des lourdeurs et des incohérences de l’appareil administratif. Une réorganisation des services administratifs et une plus grande efficacité des procédures budgétaires et financières apparaissent indispensables. Mais les administrations publiques ne sont qu’un maillon. Si leur efficacité reste insuffisante, c’est fondamentalement en raison de nos pratiques collectives et politiques, qui nous conduisent, non seulement à privilégier la dépense mais aussi à retarder l’adaptation nécessaire de notre appareil administratif.
Que ce soit au sein de l’État, de l’assurance maladie ou des collectivités territoriales, on ne peut qu’être frappé par la prolifération d’acteurs et d’instruments. Ceci multiplie les sources de dépenses et ne favorise pas leur sélection.
Les procédures administratives devraient permettre de limiter cette incitation à dépenser inefficacement. Malheureusement, elles n’atteignent pas cet objectif.
Tout ceci contribue depuis de nombreuses années à accroître la dépense publique et donc la dette financière.
De nouveaux acteurs administratifs et de nouveaux instruments apparaissent régulièrement, sans jamais ou presque que d’autres soient effectivement supprimés. Ceci a pour première conséquence d’ajouter en permanence de nouvelles dépenses, sans en abandonner d’autres en contrepartie.
Cette profusion d’acteurs et d’instruments a également pour conséquence de réduire l’efficacité de certaines dépenses.
Le nombre d’acteurs publics augmente sans cesse dans notre pays.
C’est vrai pour les collectivités territoriales. À côté des communes et des départements, on a créé les régions, puis les structures intercommunales, sans parallèlement supprimer d’acteurs. Ainsi, on compte désormais 50 000 acteurs publics indépendants : 36 782 communes, 18 504 groupements intercommunaux, 100 départements et 25 régions. En outre, 344 pays ont été créés.
C’est également vrai pour l’État, à plusieurs titres. Tout d’abord, depuis quinze ans, l’État a décidé d’avoir plus de moyens au niveau local, en renforçant le rôle de ses services déconcentrés. Il a également confié certaines de ses compétences à des agences. Enfin, le nombre de ministères a augmenté, parce qu’on a voulu souligner l’importance de certaines missions.
Le plus souvent, toutes ces structures s’additionnent au lieu de se compenser. Les exemples sont nombreux.
La création d’un ministère de l’Environnement n’a pas conduit à concentrer en son sein la compétence environnementale, que ce soit au niveau central ou au niveau local.
En créant des agences, la France a voulu s’inspirer des pratiques étrangères. Mais au lieu, comme dans plusieurs pays étrangers, de supprimer en contrepartie les services qui jusque-là avaient la compétence, nous les avons conservés. Par exemple, les agences régionales d’hospitalisation se sont par exemple ajoutées aux directions départementales et régionales des affaires sociales.
Les différentes autorités de régulation (Conseil de la concurrence, Autorité de régulation des télécommunications, Commission de régulation de l’électricité et du gaz, Conseil supérieur de l’audiovisuel...) se sont également ajoutées aux services correspondants des ministères (ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, ministère de la Culture...).
Une situation financière très préoccupante 93 De la même manière, la création de l’Agence France Trésor pour gérer la dette de l’État n’a pas conduit à centraliser la gestion la dette de l’ensemble des acteurs publics. Réseau ferré de France (RFF), la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES), ou l’UNEDIC, par exemple, empruntent de manière autonome à un taux plus élevé que celui de l’État. Cette situation aboutit donc à un surcoût injustifié qui s’élève à environ une centaine de millions d’€ chaque année, sans compter le coût de fonctionnement des structures.
Quant à la déconcentration, même si elle est tout à fait souhaitable, on peut s’interroger sur les conditions de sa mise en oeuvre. Coexistent en effet aujourd’hui dans la plupart des ministères des structures au niveau régional, départemental, voire en deçà (sous-préfectures, subdivisions de l’équipement...), sans que leur nécessité apparaisse aussi clairement que dans le passé, lorsqu’elles permettaient de couvrir un territoire et une population alors largement ruraux. Rien ne permet en outre d’affirmer que la décentralisation vers les collectivités territoriales se soit accompagnée d’une révision systématique à la baisse des moyens des administrations déconcentrées.
Dans le cas de la Sécurité sociale, plusieurs structures nouvelles ont été créées (notamment Unions régionales des caisses d’assurance maladie (URCAM) et Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA)), alors même que la pertinence des structures d’origine était déjà devenue contestable. Il a également été maintenu, à côté des caisses primaires, des caisses régionales, sans que l’utilité de celles-ci ait toujours été démontrée.
Enfin, plusieurs régimes obligatoires continuent à coexister, ce qui rend le système particulièrement complexe. Pourtant, que ce soit pour l’assurance maladie ou le risque vieillesse, les différents régimes, hors régimes spéciaux, offrent des prestations désormais très proches. En outre, depuis la réforme de l’assurance maladie de 2004, une Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) a été créée, dont les décisions s’appliquent aux principaux régimes obligatoires d’assurance maladie. En dépit de cette convergence, chaque régime continue à avoir sa propre structure de gestion pour liquider les prestations et assurer le contrôle médical (services médicaux). Les écarts de coûts entre les structures sont importants. Le coût de gestion de l’assurance maladie des exploitants agricoles rapporté aux prestations est ainsi de 5,6 % contre 4,7 % pour le régime général. Outre la question du surcoût de gestion, la coexistence de plusieurs services médicaux rend plus difficile la mise en place d’actions coordonnées de gestion du risque maladie.
Dans le même temps, les instruments des politiques publiques se sont empilés. En effet, la création de nouveaux outils s’est rarement accompagnée de la suppression d’instruments existants. Les politiques de l’emploi et de la santé, précédemment analysées, constituent à cet égard des exemples intéressants.
En ce qui concerne la politique de l’emploi, les dispositifs de contrats aidés sont souvent très proches les uns des autres. Dans ce domaine, les réformes visent généralement à reprendre des dispositifs anciens, à les modifier à la marge et à leur donner un nouveau nom. Dans le domaine de la santé et de l’assurance maladie, les outils de programmation se multiplient : Programmes régionaux de santé (PRS) ; Programmes régionaux d’accès à la prévention et aux soins (PRAPS) ; Schémas régionaux d’organisation sanitaire (SROS) ; Schémas régionaux d’éducation pour la santé (SREPS) ; Programmes territoriaux de santé ; Programmes régionaux de l’assurance maladie (PRAM) ; Programmes régionaux hospitaliers (PRH) ; Plans régionaux de santé publique (PRSP). On finit par s’y perdre.
Ces programmes mobilisent le plus souvent les mêmes acteurs, sur des problématiques proches. Ceci crée une grande confusion parmi les acteurs eux-mêmes et des problèmes d’articulation entre les outils et les acteurs.
La prise en charge de la dépendance constitue un exemple illustratif : cette politique mobilise un grand nombre d’intervenants (agence régionale de l’hospitalisation, directions régionale et départementale des affaires sanitaires et sociales, caisses d’assurance maladie, services sociaux des départements et caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA)). Comme l’a souligné la Cour des comptes dans un rapport de novembre 2005, l’articulation entre ces différents acteurs est extrêmement complexe. La création d’une nouvelle structure, la CNSA, aurait pu permettre de clarifier les compétences respectives de chacun d’entre eux, voire de rassembler les compétences et les financements dans une structure unique. Mais tel n’a pas été le cas.
Dernier exemple, pour un même objectif, il existe souvent un grand nombre de dispositifs fiscaux dérogatoires, sans que l’efficacité de chacun d’entre eux et leur articulation ne soient nécessairement démontrées. Le Conseil des impôts a mis en évidence ce constat dans plusieurs domaines, par exemple pour les dispositifs de zones d’aménagement prioritaire du territoire.
Cette prolifération d’acteurs et d’instruments nationaux se poursuit alors que la construction européenne en suscite elle-même d’autres à l’échelle de l’Union.
Dans une organisation marquée par un tel enchevêtrement des compétences, toute action publique mobilise une multiplicité d’acteurs. Les affaires sociales sont particulièrement édifiantes à cet égard. Tout projet d’ampleur dans le domaine de la politique de la ville (grand projet ville...) ou de la lutte contre les exclusions (hébergement d’urgence, accès aux soins...) nécessite la réunion de deux ou trois niveaux de collectivités territoriales (départements, structures intercommunales, communes), de plusieurs services de l’État (équipement, affaires sociales, justice, intérieur, emploi, économie et finances), de l’ANPE et des associations.
Dans le domaine de l’assurance maladie, ne serait-ce que pour conduire une étude, il faut réunir à la fois les très nombreux services de l’assurance maladie (URCAM, services médicaux, caisses des différents régimes) et les services de l’État (DDASS, DRASS...).
L’action publique s’en trouve extrêmement ralentie. Elle est aussi nécessairement plus coûteuse, pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que pour un acteur public, exister signifie d’abord dépenser. Une partie de la multiplication des effectifs et des instruments est ainsi le résultat de l’augmentation du nombre d’acteurs publics.
Deuxièmement, la confusion dans les compétences aboutit à un enchevêtrement dans les financements. Un même projet va ainsi recevoir des fonds de plusieurs collectivités territoriales, de l’Union européenne, de l’État au travers de plusieurs instruments, etc. Chaque financeur dépensant moins que s’il avait été seul, il peut être moins attentif à la qualité du projet.
Cet effet sur l’utilité de la dépense est particulièrement visible dans le cas de financements croisés entre l’État et les collectivités territoriales. L’augmentation en partie inutile des locaux des universités, précédemment évoquée, est sans doute la conséquence de ce mécanisme. Les investissements dans les universités sont en effet réalisés dans le cadre de financements conjoints entre l’État et les régions, mais sur de mauvaises bases. Les régions n’ont aucun intérêt à réhabiliter les locaux existants, car elles préfèrent réaliser des constructions nouvelles, opérations plus visibles. C’est le choix qu’elles ont imposé à l’État, qui doit ensuite assumer les coûts de fonctionnement de ces nouvelles surfaces, ce qui le prive de moyens pour réhabiliter un parc par ailleurs largement délabré. Ce type de situation se retrouve dans certains projets réalisés dans le cadre des contrats de plan État-régions (CPER), notamment certains des projets d’infrastructures de transport.
Troisièmement, la multiplication d’acteurs aux compétences très proches aboutit à des coûts de fonctionnement trop élevés. Ainsi, la gestion de l’impôt est éclatée entre la Direction générale des impôts, la Direction générale de la comptabilité publique et la Direction générale des douanes et des droits indirects. Cette situation, rare en Europe, est une source de complexité pour le contribuable. Elle conduit à un surcoût pour le budget de l’État. Si le coût moyen de perception de l’impôt rejoignait celui des principaux pays industrialisés, l’administration française économiserait plus d’un milliard d’€ par an.
Cet exemple est le plus connu. Il est d’ailleurs souvent le seul cité, alors même que de gros efforts de rationalisation sont déployés par le ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie depuis plusieurs années.
Il y a pourtant beaucoup d’autres exemples, moins connus, également coûteux et qui ne font pas l’objet d’autant d’efforts d’ajustement. Ne serait-ce que quand, comme nous l’avons vu, l’État crée une nouvelle structure (agence, direction régionale...) sans en supprimer en compensation.
À ce titre, la coexistence de plusieurs services d’accompagnement des demandeurs d’emploi (ANPE, UNEDIC, ministère de l’Emploi, intervenants extérieurs...) ne peut qu’aboutir à des surcoûts : si le coût de placement d’un chômeur en France était identique à celui constaté en moyenne dans les pays de l’OCDE, l’économie serait d’environ 1,5 milliard d’€.
L’intercommunalité peut être également un facteur de surcoûts, alors qu’elle a vocation au contraire à améliorer l’efficacité des dépenses. Mais il n’existe pas d’analyse des conditions dans lesquelles sont transférées les compétences des communes vers les structures intercommunales. On peut cependant remarquer que, alors que la proportion de communes ayant adhéré à une structure intercommunale atteint désormais 90 %, l’augmentation des dépenses dans les groupements de commune n’a pas été compensée par une diminution de celles des communes.
En effet, les charges de personnel des structures intercommunales sont passées de 1,35 milliard d’€ en 2000 à 2,63 milliards en 2003, soit une augmentation de 30 % par an. Or dans le même temps, les charges de personnel des communes ont également fortement progressé (11,4 %), alors même que les communes ont transféré une partie de leurs compétences aux structures intercommunales, sans en acquérir de nouvelles. La récente étude de la Cour des comptes vient de confirmer l’existence de réels problèmes dans ce domaine.
Enfin, il est manifeste que la prolifération des acteurs rend nécessaire la multiplication des structures de concertation et conduit à un manque de réactivité des administrations publiques. Dans le secteur concurrentiel, les décisions de simplification des structures partent souvent du simple constat de ce coût de concertation (réunions, conférences...), compte tenu notamment du nombre des responsables mobilisés.
La prolifération des acteurs et des instruments est coûteuse pour les finances publiques, et donc pour le contribuable. Mais elle est aussi dommageable pour les citoyens et pour les entreprises. La complexité de l’organisation et des procédures est souvent pour eux une source de délais, d’incertitudes et d’appréhension.
La profusion des acteurs et des instruments incite à la dépense. Mais celle-ci n’est pas pour autant inévitable. On pourrait imaginer en effet que des procédures permettent d’éviter les dépenses inutiles. Effectivement, ces procédures existent dans les administrations publiques et sont, à première vue, analogues à celles des entreprises. Chaque année, un budget est élaboré, afin de répartir les dépenses entre les différents services administratifs. Dans le cas de l’État et des collectivités territoriales, chaque décision de dépense fait en outre l’objet d’un contrôle par plusieurs autorités.
Mais ces procédures ne parviennent pas à contenir l’incitation à dépenser.
Chaque année, le Parlement discute et vote le budget de l’État, sur la base de la proposition du gouvernement. Ce budget permet de répartir les moyens entre les politiques publiques, les instruments et les services administratifs.
La procédure de l’ordonnance organique de 1959, utilisée jusqu’en 2005, était devenue peu à peu inadaptée. En fait, ce que l’on appelait le budget de l’année n’était que la reprise du budget de l’année précédente, augmenté de nouvelles mesures.
Cela avait deux conséquences néfastes. La première, c’est qu’en général, l’on n’était, à aucun moment, véritablement confronté à la nécessité de justifier une dépense existante. Toute dépense décidée dans le passé était considérée comme a priori justifiée, quelle que soit son utilité actuelle. La seconde, c’est que toute l’attention des parlementaires, des administrations publiques, des médias et plus généralement de l’opinion publique se portait sur les dépenses nouvelles. Cette procédure n’était donc pas un frein à la dépense, mais plutôt un accélérateur.
Des aménagements ont été à plusieurs reprises apportés à cette procédure pour améliorer son fonctionnement, au niveau politique, comme au niveau de l’administration. Sur le plan administratif, par exemple, un système de Rationalisation des choix budgétaires (RCB) avait été créé dans les années 1960. Mais ces aménagements, plus ou moins éphémères, n’ont presque jamais eu les effets escomptés.
La procédure a été largement réformée en 2001 par l’adoption d’une nouvelle Loi organique relatives aux lois de finances (LOLF), qui rénove en profondeur les règles financières de l’État. Désormais, tous les crédits sont regroupés en un petit nombre de missions qui correspondent 98 Rompre avec la facilité de la dette publique aux grands axes des politiques de l’État. Il est en outre prévu la définition d’indicateurs permettant de mesurer la réalisation des objectifs assignés à ces missions.
C’est un progrès très significatif qui peut permettre de mettre fin à la reconduction des mêmes dépenses d’une année sur l’autre, en obligeant les administrations publiques, chaque année, à justifier leurs dépenses, au regard notamment d’indicateurs de résultats. Elle devrait permettre notamment d’enfin connaître avec précision les effectifs des administrations publiques.
Cette réforme est fondamentale, car elle entend changer en profondeur la logique des finances publiques en passant à une logique de résultat et en luttant contre les pratiques d’empilement des dépenses. Pour la première année de mise en oeuvre de la LOLF, le budget reste construit comme dans le passé, c’est-à-dire en repartant du budget de l’année précédente.
Certes, il était impensable que l’on remette à plat 250 milliards d’€ de dépenses dès la première année. Mais on aurait pu imaginer que, comme cela se fait dans les entreprises, on étudie en profondeur, dès la première année, la pertinence d’une partie significative des dépenses (quelques dizaines de milliards d’€). Ce n’est pas la méthode qui a été choisie. Il a seulement été demandé aux ministères d’expliquer leurs dépenses. Certains l’ont fait, d’autres non. Pour ceux qui l’ont fait, les informations sont souvent restées parcellaires et d’un niveau de fiabilité incertain. Et de toute façon, comme par le passé, les dépenses existantes n’ont le plus souvent pas été remises en cause.
Dans ces conditions, comme l’a souligné le rapport de MM. Alain Lambert et Didier Migaud relatif à la mise en oeuvre de la Loi organique relative aux lois de finances (LOLF), le budget reste encore excessivement le produit d’un dialogue souvent peu productif entre la Direction du budget du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et les autres ministères. Les ministères restent en effet focalisés sur un objectif d’augmentation des dépenses et la Direction du budget n’a pas toute la capacité de contester les dépenses annoncées.
Pour essayer de sortir de ce dialogue souvent stérile, des contrats entre les administrations et la Direction du budget ont été développés. Le principe est simple et intéressant : les administrations s’engagent à faire des efforts en matière de dépenses ; en contrepartie, elles obtiennent certaines garanties sur l’évolution de leurs moyens. Mais la Direction du budget n’ayant pas assez d’informations, ce sont essentiellement les administrations elles-mêmes qui déterminent leurs engagements, qui risquent donc d’être assez peu contraignants.
On comprend, dans ces conditions, que l’État ne soit pas vraiment capable de s’assurer que les crédits alloués aux ministères sont réservés à des actions dont la nécessité est avérée et affectée avec rigueur en fonction des priorités.
Mais cela va plus loin.
Une fois que les ministères ont été autorisés à dépenser, d’autres procédures ont été mises en place pour assurer l’utilisation la plus efficace des moyens. L’État dispose notamment de longue date d’une fonction, celle de comptable public. Seuls ces comptables peuvent payer une dépense publique et tenir les comptes des administrations publiques. C’est ce que l’on appelle le principe de la séparation entre l’ordonnateur et le comptable : celui qui décide de la dépense n’est pas celui qui la paye et chacun tient une comptabilité séparée. Cette fonction mobilise 7 400 personnes et coûte chaque année à l’État 0,7 milliard d’€.
Or, ce contrôle ne permet pas de s’interroger sur l’utilité et l’efficacité des dépenses. On a en effet choisi de le faire porter uniquement sur des aspects formels (présence des signatures obligatoires et de toutes les pièces justificatives...).
Dans ces conditions, il n’y a pas vraiment dans la décision de dépenser de garanties de vérification de l’utilité de la dépense, que ce soit au niveau global ou dépense par dépense.
Or, la LOLF va donner plus de liberté aux administrations publiques dans l’utilisation de leurs moyens. Cette évolution part du principe qu’en donnant plus d’autonomie aux administrations publiques, celles-ci seront plus incitées à bien dépenser. C’est d’ailleurs ce que font les entreprises privées qui, depuis de nombreuses années, donnent à leurs cadres plus de responsabilités dans l’utilisation des moyens.
Cependant, dans le secteur privé, cette liberté accrue a trois contreparties. D’abord, les directions financières ou les contrôles de gestion disposent d’informations pour juger de l’utilité des dépenses. Ensuite, ils peuvent contester certaines dépenses et obtenir leur remise en cause s’ils ont de solides arguments. Enfin et surtout, ceux qui décident de la dépense sont jugés sur leur capacité à bien dépenser et des indicateurs objectifs ont été mis en place pour permettre de le faire. L’État est très loin de cette organisation.
C’est ce qui explique en large partie que les gains de productivité soient limités. Concrètement, on ne demande pas aux services de justifier les moyens qu’ils consacrent à leurs missions traditionnelles. Lorsqu’ils demandent des moyens supplémentaires pour réaliser des investissements, notamment informatiques, on ne leur demande pas non plus précisément les économies rendues possibles par les investissements.
Lorsque les investissements ont été réalisés, on ne diminue pas automatiquement les moyens, notamment humains, qui leur sont alloués, à due concurrence des gains de productivité qui auraient, à l’évidence, dû être réalisés. Et en tout état de cause, l’évaluation des responsables ne porte pas principalement sur leur capacité à utiliser l’argent public de la façon la plus économe et la plus efficace possible.
Les collectivités territoriales, comme l’État, disposent en apparence de règles contraignantes permettant de gérer efficacement les dépenses. D’abord, comme nous l’avons vu, le recours à l’endettement pour des dépenses de tous les jours leur est interdit. Mais comme nous l’avons vu également, le faible endettement des collectivités territoriales s’explique en partie par l’importance des transferts de l’État dans leur financement.
Ensuite, la séparation entre l’ordonnateur et le comptable, qui vaut pour l’État, s’applique également aux collectivités territoriales, pour lesquelles elle mobilise 26 200 fonctionnaires du Trésor public pour un coût annuel de 1,8 milliard d’€. Mais, comme elle fonctionne sur les mêmes principes, elle est tout aussi incapable d’avoir un impact sur l’opportunité de la dépense.
Il n’y a donc pas de contrôle réel avant que la dépense soit décidée. Il existe en revanche des contrôles une fois la dépense réalisée. Les chambres régionales des comptes peuvent en effet examiner la qualité de la gestion des collectivités territoriales et ne se privent pas de contester certaines dépenses. Mais, une chambre régionale des comptes peut constater une situation de mauvaise gestion sans qu’il y ait de suites.
Le contrôle démocratique représente donc la seule véritable garantie de l’efficacité des dépenses des collectivités territoriales. Son exercice est cependant rendu difficile par la complexité du mécanisme de financement des collectivités territoriales et par l’enchevêtrement des compétences à la fois entre elles, mais également entre elles et l’État. En effet, le mode de financement fait reposer une large part des ressources des collectivités territoriales non pas sur le contribuable local mais sur le contribuable national. Et l’enchevêtrement des compétences rend peu transparente la répartition des responsabilités.
Avant 1996, les partenaires sociaux décidaient théoriquement seuls de la dépense en matière de Sécurité sociale. En réalité, l’État intervenait largement dans le processus et les responsabilités effectives de l’un et des autres étaient très confuses.
Depuis 1997, le Parlement discute et vote chaque année une loi de financement de la Sécurité sociale qui fixe le montant total des recettes et, pour chaque branche (maladie, vieillesse, famille...), le montant des dépenses. C’est là un progrès fondamental. La décision dans ces domaines essentiels pour notre société relève désormais des élus de notre Nation.
Cette procédure est l’équivalent pour la Sécurité sociale de l’adoption du budget pour l’État. Elle a été modernisée par la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ainsi que par la nouvelle Loi organique relative aux lois de financement de la Sécurité sociale adoptée en 2005 (LOLFSS), équivalent de la LOLF pour la Sécurité sociale. Les objectifs sont désormais pluriannuels, et les votes portent également sur le solde et non plus seulement sur le niveau des dépenses. La répartition des responsabilités a été précisée en confiant un pouvoir important au directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. Enfin, un comité d’alerte a été mis en place qui doit publiquement se prononcer sur la possibilité de respecter l’objectif annuel de dépense d’assurance maladie.
Cette procédure souffre cependant des mêmes limites que la procédure d’élaboration du budget de l’État. Le dialogue entre, d’un côté, l’équivalent de la Direction du budget pour la Sécurité sociale (la Direction de la Sécurité sociale) et, de l’autre, ceux qui décident de la dépense de Sécurité sociale est aussi peu constructif.
La Direction de la Sécurité sociale a peu de pouvoir pour peser sur les décisions de dépense. Sa situation est même plus difficile, puisqu’elle est confrontée à un nombre beaucoup plus important d’acteurs. Elle doit composer non seulement avec les directions dépensières de l’État (Direction générale de la santé, Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins...), mais également avec les organismes de Sécurité sociale gérés ou contrôlés par les partenaires sociaux.
La faiblesse du pouvoir de la Direction de la Sécurité sociale est un premier obstacle à la maîtrise des dépenses et à une analyse critique de leur efficacité. Elle explique par exemple que la Convention d’objectifs et de gestion (COG) avec la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) – qui est une sorte de contrat équivalent à ceux négociés par la Direction du budget – ait une portée très limitée. Elle ne contient aucun objectif d’efficacité. Elle n’a d’ailleurs pas permis de réduire les effectifs des caisses primaires d’assurance maladie. Pourtant, avec la généralisation de la carte Vitale (télétransmission) et la mise en place de la couverture maladie universelle, les tâches matérielles de vérification des droits ont largement diminué, ce qui devrait avoir libéré mécaniquement des postes de travail.
Le manque de transparence sur le contenu des objectifs du PLFSS et sur leur exécution constitue un autre obstacle, particulièrement pour l’assurance maladie. Sans entrer dans les détails, citons uniquement les deux principales faiblesses des procédures administratives qui empêchent de bien maîtriser les dépenses financées et de s’assurer de leur efficacité.
D’une part, la coexistence d’un budget de l’État et d’un budget de la Sécurité sociale introduit une grande complexité. Pour une même action, les financements sont souvent multiples, ce qui ne permet pas d’avoir une vision d’ensemble de la dépense. En outre, l’État et la Sécurité sociale cherchent en permanence à se renvoyer les dépenses. Le coût de l’aide médicale d’État, de la couverture maladie universelle ou des allègements de charges sociales, qui ne doit pas être supporté par le budget de l’assurance maladie, fait par exemple l’objet de discussions récurrentes entre l’État et la Sécurité sociale.
D’autre part, pour les dépenses hospitalières et médico-sociales, la transparence est très imparfaite, ce qui empêche le Parlement de savoir avec précision quels sont les objectifs dans ces domaines et de s’assurer de leur respect.
Les dysfonctionnements de l’appareil administratif que nous avons évoqués, qu’ils concernent l’État, la Sécurité sociale ou les collectivités locales, sont connus, et ce depuis de nombreuses années. On ne peut donc pas dire que l’on manque d’informations sur les problèmes à traiter. En effet, contrairement à ce que l’on entend souvent, l’administration dispose de très importantes ressources en matière d’audit et d’évaluation.
Les ministères ont tous au moins un service de contrôle, et souvent plusieurs. Pour examiner des questions spécifiques, les décideurs publics peuvent en outre s’appuyer sur des structures en dehors des ministères. Certaines d’entre elles sont en place depuis longtemps. Beaucoup d’autres ont été créées depuis vingt ans. Le nombre de commissions et d’observatoires divers est à ce titre très important : Conseil d’analyse économique (1997), Comité national d’évaluation (1984), Comité national d’évaluation de la recherche (1989), Haut Conseil du secteur public (1982), Conseil national de l’insertion par l’activité économique (1991), Conseil stratégique des technologies de l’information (2000), Observatoire de la démographique médicale...
Enfin, les pouvoirs publics peuvent saisir l’Inspection générale des finances dès lors que de l’argent public est en jeu. Les 180 magistrats de la Cour des comptes, dont l’indépendance est garantie par la Une situation financière très préoccupante 103 Constitution, peuvent également étudier tous sujets. Et rien n’interdit que certains sujets fassent l’objet d’audits par des sociétés privées spécialisées.
Grâce à ces moyens, les domaines d’action des administrations publiques ont pour la plupart été étudiés en profondeur par au moins un organe d’évaluation ces dernières années.
Dans le domaine de l’éducation, les corps d’inspection du ministère de l’Éducation nationale, le Conseil d’analyse économique, la commission mise en place lors du grand débat sur l’école ou encore l’Inspection générale des finances a souligné la part excessive des dépenses consacrées à l’enseignement secondaire au détriment de l’enseignement supérieur et la mauvaise gestion du système universitaire. Dans le domaine de l’emploi, le ministère de l’Emploi lui-même, les inspections générales des affaires sociales et des finances, la Cour des comptes, le Conseil d’analyse économique ou le Commissariat du Plan ont souligné les faiblesses des politiques de l’emploi. L’Inspection générale des finances et la Cour des comptes ont par exemple contesté les modalités de la mise en oeuvre de la prime pour l’emploi ainsi que l’efficacité des services de placement ou des aides à l’emploi.
La recherche publique a été étudiée ces dernières années sous la plupart des aspects : cohérence d’ensemble de la politique suivie, fonctionnement des organismes publics de recherche (Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Commissariat à l’énergie atomique (CEA) etc.), pertinence de certains outils (crédits d’impôts...). Les zones de moindre efficacité que nous avons rappelées en matière d’assurance maladie sont également bien connues et ont fait l’objet de nombreux rapports : rapports annuels sur les comptes de la Sécurité sociale de la Cour des comptes, qui insistent tous les ans sur les mêmes points, Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie, rapports multiples des inspections des affaires sociales et des finances...
Seules les collectivités territoriales souffrent d’un certain manque d’évaluation de la qualité de leurs dépenses. Ce n’est pas véritablement faute de services de contrôle, parce que les chambres régionales des comptes disposent de moyens significatifs. Mais c’est le résultat à la fois de la priorité qu’accordent les textes au contrôle des comptes au détriment de l’évaluation de la bonne gestion, ainsi que de l’insuffisante prise en compte des observations émises par les chambres régionales. Face à cette profusion d’instances d’évaluation et de rapports, on ne peut guère soutenir sur la plupart des sujets que l’on manque d’informations pour identifier les zones de dépenses de moindre efficacité et engager les réformes nécessaires.
Le problème n’est donc pas d’attendre d’avoir suffisamment d’informations pour décider, mais d’utiliser les informations disponibles pour décider. La multiplication des commissions, comités et observatoires tranche avec la faible utilisation de leurs travaux. Leur création apparaît 104 Rompre avec la facilité de la dette publique même souvent comme un moyen de reporter la décision dans un domaine déjà largement étudié.
Autre carte dans la main des décideurs publics pour améliorer l’efficacité de notre appareil administratif : les fonctionnaires. On souligne trop rarement la qualité des compétences dans la fonction publique. Elle est pourtant réelle. Que ce soit dans l’État, dans les collectivités territoriales ou dans les régimes sociaux, le niveau des compétences est globalement satisfaisant et comparable à celui que l’on trouve dans le secteur privé. On ne peut pas soutenir que les faiblesses de l’appareil administratif sont le résultat de l’incompétence des fonctionnaires. Au contraire, la qualité des hommes et des femmes est un atout pour l’adaptation des administrations publiques.
Nombre de nos partenaires européens ont su moderniser leur fonction publique. Mais en France on entend souvent que les rigidités du statut de la fonction publique rendent impossible l’amélioration du fonctionnement de l’appareil administratif.
Il est incontestable que le droit de la fonction publique repose sur un statut ancien, qui n’est plus nécessairement parfaitement adapté aux besoins de l’administration d’aujourd’hui et qui induit un certain nombre de contraintes pour les décideurs. Il est par exemple impossible de licencier, hors cas exceptionnel, et la plupart des décisions de gestion (avancement, mutations...) doivent être soumises aux partenaires sociaux.
Mais on ne peut pas se réfugier derrière cet argument pour justifier l’immobilisme, aujourd’hui encore moins qu’hier. Le statut général de la fonction publique n’est pas nécessairement beaucoup plus contraignant que le droit du travail et l’ensemble des conventions collectives et des accords de branche et d’entreprise qui s’y ajoutent. Les banques et assurances, organisations de taille comparable à certains grands services de l’État et qui, pour nombre d’entre elles, ont fait partie de la sphère publique dans le passé, n’avaient pas particulièrement moins de contraintes que les administrations publiques en matière sociale. Ces structures ont su se réorganiser intégralement ces dernières années et réaliser de forts gains de productivité en réduisant leurs effectifs globaux très souvent sans départs contraints. En effet, elles ont profité depuis plus de dix ans des départs en retraite pour ne pas remplacer tous les départs et ainsi réduire leurs effectifs globaux. Et elles ont su se réorganiser, c’est-à-dire supprimer certains postes de travail ou même certaines fonctions et parallèlement en renforcer ou en créer d’autres, grâce à la mobilité de leurs personnels.
Les banques, par exemple, qui disposaient d’effectifs administratifs très nombreux, les ont réduits pour tirer les conséquences des disparitions Une situation financière très préoccupante 105 de postes induits par l’informatisation en redéployant les personnels concernés, grâce à des actions de formation, souvent dans des fonctions commerciales.
Pourquoi les administrations publiques n’ont-elles pas su jusqu’à présent suivre le même chemin ? Pourtant leurs structures ont besoin d’une modernisation au moins égale à celles des banques il y a quinze ans. Et l’importance du nombre des départs à la retraite leur offre une opportunité historique.
Les départs en retraite vont en effet être massifs au sein de l’État dans les dix prochaines années. De 2005 à 2015, 850 000 fonctionnaires de l’État vont partir à la retraite, soit près de 50 % des effectifs. C’est en 2008 que les départs seront les plus importants (plus de 80 000). Mais au sein de l’État, il manque l’outil essentiel qui a permis aux grands services administratifs du secteur privé de se réorganiser et de profiter pleinement de l’opportunité des départs en retraite : la mobilité. La mobilité est très largement réduite, non pas du fait du statut général, mais de décisions qui ont conduit à créer une multitude de statuts particuliers : les « corps » (au nombre de 1 500 environ).
Ces statuts particuliers rigidifient considérablement la gestion des ressources humaines de l’État. Ils déterminent précisément les fonctions que peut exercer chacun des fonctionnaires qui en font partie. Dès lors, si l’on veut changer sensiblement la fonction d’un agent, il est nécessaire qu’il change de corps. En particulier, il faut le plus souvent changer de corps lorsque l’on change de direction. Ceci soulève de nombreuses difficultés, en raison notamment des différences de niveau de rémunération entre les corps.
Aussi y a-t-il très peu de mouvements de personnels entre ministères, et même entre directions d’un même ministère. La différence essentielle avec le secteur privé se situe à ce niveau. Ce manque de mobilité rend très difficile la réalisation de gains de productivité parce que ceux-ci sont limités au nombre de départs à la retraite dans le corps ou la direction concernés.
Ainsi, lorsqu’une direction de l’État réalise des gains de productivité très importants sur une fonction, qui aboutissent à la suppression possible de 1 000 postes, cette direction ne peut guère faire mieux que ne pas remplacer les départs en retraite des agents dans cette fonction. S’il y avait une mobilité professionnelle équivalente à celle que pratique le secteur privé, l’État pourrait redéployer les agents affectés à cette fonction, à l’extérieur de la direction, voire dans un autre ministère.
L’accroissement de la dette résulte donc pour partie d’un certain manque d’efficacité de l’action et de l’organisation publiques. Mais les obstacles à l’amélioration de l’efficacité des administrations publiques et à une meilleure sélectivité des dépenses que l’on mentionne habituellement sont surmontables.
La persistance des lourdeurs et des incohérences de l’administration laisse penser que le problème est plus profond. Il est lié fondamentalement à certaines de nos pratiques politiques et collectives. Certes, il est souvent difficile de distinguer les dysfonctionnements dont l’administration est seule responsable, de ceux qui relèvent d’une responsabilité collective.
En dépit de cette difficulté d’analyse, il apparaît néanmoins que certaines de nos pratiques nationales sont la cause première de la manière dont ont été gérées les finances publiques ces vingt-cinq dernières années. Elles ont en effet largement contribué à ce que l’adaptation des administrations publiques soit constamment retardée. Elles expliquent également que la dépense publique occupe une place telle dans l’action publique que l’endettement ait été une préoccupation de second ordre.
Les administrations publiques ont profondément besoin d’être réorganisées. Chaque gouvernement insiste d’ailleurs depuis vingt ans sur l’importance du thème de la réforme de l’État. Force est de constater l’importance du décalage entre ce discours et la portée des décisions qui ont été prises. L’évolution des structures et des effectifs reste en effet très lente. En ce qui concerne les structures, alors que les points essentiels à améliorer sont largement connus grâce au travail des services d’évaluation et de contrôle, le plus souvent, la démarche de modernisation consiste encore principalement à réaliser de nouvelles études (rapports de commission, audits, évaluations...).
Et lorsque l’on a essayé d’aller plus loin, on ne s’est pas donné les moyens d’imposer aux administrations publiques de véritables changements.
Le dispositif des Stratégies ministérielles de réforme (SMR) mis en place en 2004, visait à mettre à plat l’organisation et l’action de chaque ministère, et à leur donner de véritables objectifs de réforme. Il engageait une démarche novatrice et intéressante. Malheureusement, le jury chargé d’apprécier l’action des administrations n’avait pas été doté des moyens d’obtenir de celles-ci des informations fiables et d’exiger d’elles des engagements contraignants.
Le caractère velléitaire de la démarche de modernisation se retrouve à l’échelon local. Depuis plusieurs années, les outils destinés à permettre aux services de l’État de mieux travailler ensemble à l’échelon local se succèdent (documents stratégiques – projets territoriaux, projets d’action stratégique... –, structures de coordination – pôles de compétence interministériels, délégations interministérielles, missions interservices... –). Ces outils constituent souvent un progrès permettant de mieux tenir compte du caractère de plus en plus transversal de certaines politiques publiques (politique de la ville, emploi, environnement...). Mais leur mise en oeuvre s’accompagne rarement d’une réorganisation effective.
Ce qui vaut pour l’État vaut également pour la Sécurité sociale et les collectivités territoriales. Dans les deux cas, les décisions prises sont très en deçà des enjeux.
Par exemple, dans les établissements de santé, la démarche de modernisation n’a toujours pas traité le problème posé par les services dans le fonctionnement des hôpitaux. Les mesures d’amélioration de l’efficacité proposées ces dernières années sont partielles puisqu’elles se limitent à économiser de l’argent sur les fournitures, sans aborder en règle générale l’organisation, le fonctionnement ou les objectifs des établissements.
Dernier exemple, les pouvoirs publics n’ont pas suffisamment encadré le renforcement des pouvoirs financiers des collectivités territoriales. Nous avons vu que les niveaux d’administration se multiplient sans rationalisation des compétences de chacun d’entre eux. C’est là la conséquence directe des décisions prises lors de la mise en oeuvre la décentralisation. Les lois de décentralisation n’ont en effet pas cherché à donner à chaque catégorie de collectivité des compétences véritablement exclusives. On a fait de même une seconde fois lors de la mise en place des structures intercommunales, puisqu’il n’a pas été exigé des communes qu’elles abandonnent les compétences qu’elles étaient censées transférer. Les décisions politiques qui auraient permis de faire évoluer les structures n’ont donc pas véritablement été prises. Et la situation est identique en ce qui concerne les ressources humaines.
Les décisions politiques qui auraient permis de faciliter la mobilité des agents entre directions et entre ministères n’ont pas été prises. Les fusions de corps restent en effet trop rares (une dizaine par an environ). L’élargissement, au sein d’un même corps, du nombre de fonctions que ses membres peuvent exercer n’a pas non plus été mis en oeuvre jusqu’à présent.
En outre, les recrutements continuent au même rythme que dans les années 1960. En effet, près de 95 % des départs à la retraite au sein de l’État ont été compensés par des recrutements sur les cinq dernières années. Rien ne permet de penser que l’opportunité historique des départs massifs à la retraite dans les prochaines années des générations du baby boom sera véritablement saisie.
Plusieurs caractéristiques de nos pratiques expliquent largement le retard pris dans l’évolution de notre appareil administratif. Le processus de réforme d’une organisation est lent et difficile, parce qu’il suppose à la fois une bonne analyse préalable et un effort d’explication et de concertation auprès des partenaires sociaux et des personnels concernés. La réforme change les habitudes et nécessite un effort d’adaptation, et parfois de mobilité, professionnelle voire géographique, de la part des personnes concernées. Elle suppose donc que celles-ci intériorisent la nécessité de la réforme et se l’approprient, et que les partenaires sociaux aient négocié et accepté les modalités envisagées. Tout cela suppose beaucoup de travail et de pédagogie de la part des responsables de la réforme. Et ceci est vrai dans le secteur privé comme dans le secteur public. Le secteur privé dispose de trois caractéristiques qui lui permettent de faire comprendre et accepter les réformes nécessaires.
La première est son compte d’exploitation : le développement de l’entreprise, dont dépendent emplois, rémunérations et carrières, repose sur sa capacité bénéficiaire ; chacun dans l’entreprise comprend la nécessité de l’améliorer.
La deuxième est la concurrence : l’entreprise n’est propriétaire ni de ses clients, ni de ses marchés ; si elle ne s’adapte pas aussi vite ou plus vite que ses concurrents nationaux et de plus en plus souvent internationaux, elle est condamnée au déclin, à la perte de l’indépendance, c’est-à-dire de son identité, voire à la faillite, c’est-à-dire à la disparition ; de cela aussi, chacun des salariés est conscient.
Enfin, les responsables d’entreprises disposent en général de la durée : le renouvellement de leur mandat, tous les trois à six ans, dépend de critères objectifs, liés à la qualité de leur stratégie et de sa mise en oeuvre, de leur gestion et de leurs résultats ; leur capacité à adapter en permanence leur organisation pour optimiser son efficacité est un facteur clé de succès, un critère essentiel du renouvellement de leur mandat et, le plus souvent, des niveaux de leur rémunération.
Nos pratiques collectives n’ont pas jusqu’à présent doté nos responsables politiques d’atouts comparables. Au cours des vingt-cinq dernières années, l’équilibre des finances publiques n’a jamais été un objectif prioritaire. La compétitivité du territoire national par rapport aux pays voisins, en termes de coût et d’efficacité de son service public et de qualité de sa réglementation, n’est pas encore reconnue comme un problème essentiel du point de vue des perspectives de croissance et d’emploi.
Ces deux éléments privent les responsables politiques d’indicateurs essentiels et d’arguments vis-à-vis des personnels concernés et de leurs représentants syndicaux pour faire accepter les efforts nécessaires au succès des réformes. Cela prive aussi les responsables politiques du soutien de l’opinion publique nécessaire pour affronter les obstacles à la réforme que ne manqueraient pas de susciter les conservatismes, qui sont inévitables dans toute organisation et la peur des changements, qui est compréhensible. En outre, les responsables politiques tirent leur légitimité de l’élection démocratique. Or, si leurs mandats sont d’une durée analogue à celle des responsables des entreprises, le grand nombre d’échelons politiques aboutit à un calendrier électoral très chargé. Cette situation conduit à aborder la question de la réforme des administrations publiques et des effectifs essentiellement sous l’angle des risques politiques et sociaux à court terme, au détriment des gains qui peuvent en être attendus à plus long terme.
La fréquence des élections, lorsqu’elle s’accompagne d’un renouvellement rapide des élus nationaux et locaux, rend encore plus difficile l’investissement des décideurs politiques dans la gestion des administrations publiques. La réforme n’est en effet pas possible sans continuité. La succession de huit ministres des Finances en huit ans rend par exemple difficilement concevable l’élaboration d’un projet de réforme ambitieux, assorti d’objectifs précis, et sa mise en oeuvre avec une volonté constante et un dialogue social continu.
Du fait de la multiplication des échelons politiques, la France compte environ 500 000 élus locaux, qui souvent cumulent plusieurs mandats. Les obstacles à la réforme des services administratifs s’en trouvent nécessairement renforcés, le consensus étant plus difficile à obtenir. En particulier, toute modification de la carte administrative, particulièrement lorsqu’elle s’accompagne de la disparition ou du redéploiement de postes de travail publics, est très difficile.
La bonne gestion des finances publiques est certainement un des facteurs importants de réussite aux élections dans les communes. Elle n’a en revanche pas semblé jouer un rôle majeur dans les élections nationales, régionales ou départementales au cours des dernières années.
Nos pratiques politiques et collectives contribuent à faire de la dépense publique une réponse trop systématique aux problèmes de la société française, au détriment de l’endettement public.
L’opinion publique française et les décideurs politiques considèrent en effet de plus en plus qu’un problème, quel qu’il soit, a fortiori un problème de société, doit être traité sans attendre, par l’attribution de moyens publics spécifiques, ou par une dérogation fiscale.
L’efficacité de l’action publique et des décideurs politiques est jugée dans ce contexte sur deux critères : le montant des moyens supplémentaires qui sont dégagés, et la rapidité avec laquelle ils sont annoncés. Cette polarisation sur les nouveaux moyens consacrés à l’action publique emporte trois conséquences.
D’abord, l’impact des moyens mis en oeuvre est l’objet de nettement moins d’attention que les montants annoncés. À ce titre, il est symptomatique que l’on ait largement réduit la politique culturelle ou d’aide au développement à un chiffre : 1 % du budget pour la culture, 0,7 % du PIB pour l’aide publique au développement. Dès lors, un bon budget est celui qui se rapproche le plus de cet objectif, sans que l’opinion prête véritablement attention aux objectifs des mesures financées et à la qualité des politiques conduites. Il est également étonnant que le niveau des dépenses et/ou des effectifs de certains ministères soit considéré comme intangible, quelle que soit la nature de ces dépenses.
Ensuite, la dépense nouvelle a un avantage psychologique incontestable sur la dépense redéployée. Le cas échéant, des artifices peuvent être utilisés pour faire apparaître les moyens annoncés non comme un redéploiement de moyens existants, mais comme des moyens supplémentaires, afin de pouvoir annoncer un « déblocage de crédits ». Enfin, l’analyse de l’efficacité des dépenses existantes et leur éventuelle remise en cause deviennent un objectif largement secondaire. Finalement, des mesures décidées dans l’urgence sont trop souvent pérennisées sans que l’on sache si elles ont permis d’apporter une véritable solution au problème qu’elles étaient censées résoudre.
L’actualité fournit en permanence des illustrations de ce comportement collectif. Deux exemples dans des domaines où les enjeux sont particulièrement importants illustrent cette tendance. Les urgences hospitalières sont confrontées à des problèmes de fond (manque d’attractivité de la profession d’urgentiste, risque juridique, positionnement dans le système de soins...) auxquels il est essentiellement répondu par l’annonce immédiate de moyens supplémentaires. En quelques mois, plus d’une centaine de millions d’€ ont été « débloqués », sans que l’on puisse identifier l’origine des crédits. Et alors même que l’on sait très bien que le coeur du problème ne réside pas dans l’insuffisance des moyens mais dans le positionnement de ces structures dans le système de soins.
Dans le domaine de la recherche, le constat est le même. L’attribution de crédits supplémentaires, qui peut être souhaitable, ne devrait pas être décidée dans l’urgence, compte tenu des faiblesses actuelles de l’appareil de recherche public. Or, plusieurs plans d’urgence ont été mis en place ces dernières années pour répondre à la crise du secteur, sans que l’on ait dans le même temps corrigé les dysfonctionnements du système. Il y a pire. Bien souvent, ces mesures sont étendues, au nom du principe d’égalité. Notre pays pratique très peu l’expérimentation : dès lors que l’État intervient, des règles sont rapidement établies, qui étendent les mesures prises à tous les cas analogues ou proches de celui qui a nécessité l’action politique. Et cette généralisation débouche le plus souvent sur un élargissement des critères.
Ce réflexe peut conduire à une augmentation considérable du coût pour les finances publiques par rapport à l’enveloppe initialement envisagée pour traiter le problème posé. Ou, si les pouvoirs publics hésitent à trop élargir l’enveloppe, à un saupoudrage des dépenses qui rend l’action publique moins efficace que prévu. Nos traditions d’égalité et notre refus de l’expérimentation peuvent être ainsi dommageables à la fois à la maîtrise des dépenses publiques et à l’efficacité de l’action publique.
Cette conception de l’action publique n’est certainement pas propre à la France. Mais certaines caractéristiques de notre système politique conduisent très probablement à la conforter.
La multiplication des échelons politiques, que nous avons déjà évoquée, accroît la capacité des intérêts particuliers – qui ont tous une légitimité mais qu’il ne faut pas confondre avec l’intérêt général – à trouver un écho favorable, ce qui suscite souvent de nouvelles dépenses. La fréquence des élections renforce d’ailleurs l’incitation à satisfaire au plus vite le plus grand nombre de ces intérêts.
Le nombre important de ministères, tout particulièrement dans la sphère sociale, et le rythme de rotation rapide des ministres renforcent l’incitation déjà importante à la nouvelle dépense. Et au sein même des ministères, l’existence et l’influence de cabinets ministériels très étoffés contribuent également à limiter l’incitation à remettre en cause le fonctionnement administratif et à améliorer l’efficacité de l’action publique. La taille des cabinets est en soi une incitation à la dépense, car, comme nous l’avons vu, plus il y a d’acteurs, plus l’inclination à dépenser est importante. Mais surtout, la taille des cabinets réduit le rôle des directeurs des ministères et leur influence auprès du ministre. Or, ces directeurs sont seuls à disposer de la durée nécessaire pour concevoir les réformes, les faire approuver par un ministre et assurer leur mise en oeuvre, qui nécessite beaucoup de continuité. Malheureusement, les freins permettant de limiter l’effet de la pression de l’opinion publique en faveur de la dépense publique sont nettement insuffisants.
Le Parlement, dont l’une des principales fonctions est de voter le budget des principales administrations publiques, ne semble pas suffisamment peser aujourd’hui sur la gestion des finances publiques. L’essentiel du temps qu’il consacre aux finances publiques porte sur le projet de budget, et non pas sur l’utilisation qui est faite des crédits, ce qui différencie la France de nombreux autres pays européens. Dans la phase d’étude du projet de budget, pourtant très longue, le Parlement propose très rarement de remettre en cause des dépenses existantes, voire de modifier en profondeur l’équilibre général du projet du gouvernement. Ainsi, depuis 1990, il n’a été proposé qu’une seule fois de réduire le plafond de dépenses des administrations publiques, de 200 millions d’€ environ. Et une fois le budget exécuté, la discussion sur les résultats obtenus reste aujourd’hui très formelle, alors même qu’elle devrait permettre de remettre en cause les dépenses qui n’ont pas démontré leur efficacité.
Mis en ligne le 26/11/2006 par Pierre Ratcliffe. Contact: (pratclif@free.fr)