- Basil Liddell Hart: histoire de la deuxième guerre mondiale critique du livre
- Sir Basil Liddell Hart biographie
- Général André Beaufre
- Basil Liddell Hart
- Première guerre mondiale
- Deuxième guerre mondiale
- Deuxième guerre mondiale (mon dossier)
- Septembre 1939: invasion et effondrement de la Pologne
- Guerre Russo-Finlandaise février-avril 1940
- Avril 1940: Invasion de la Norvège et du Danemark
- Images de Narvik
- Mai 1940; invasion de la Hollande, Belgique, Luxembourg, France; effondrement de la France
- l'Opération Torch 1942 tournant de la guerre
- "The world at war"
par Jeremy Isaacs réalisé en 1974 (12 DVD, 26 épisodes, 22 heures et 32 minutes) - Guerres
Basil Liddell Hart: histoire de la deuxième guerre mondiale
Postface du général Beaufre
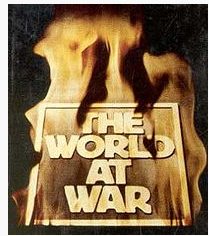
Dans ma préface, j'ai rendu à Sir Basil Liddell Hart l'hommage que je lui devais comme stratège, comme historien et comme ami.
Il n'en demeure pas moins que le lecteur français et peut-être — pourquoi pas? — quelque lecteur étranger parvenu à la fin de cette monumentale histoire de la Seconde Guerre mondiale, peut avoir le sentiment que, si informée et si objective que soit cette Histoire, elle ne paraît faire qu'une part bien limitée à la France et aux Français. Ceux qui, comme moi, ont bien connu et aimé Sir Basil et qui d'autre part ont participé à la guerre du côté français ne peuvent pas ne pas reconnaître dans cette réserve l' « hyperbritannocentrisme » de mon ami. Les hommes sont ce qu'ils sont, et c'est ce qui les rend intéressants et vrais. Personne, avec son élocution torrentielle et inaudible, sa silhouette mince au point d'être décharnée, sa pipe toujours éteinte et rallumée, ne pouvait être plus Britannique que Sir Basil Liddell Hart, — bien qu'il fût né à Paris. Ses hobbies même — la bonne cuisine et les couturiers — étaient bien ceux d'un intellectuel britannique jusqu'au bout des ongles.
Dans ces conditions, il était normal que son oeuvre soit britannique. Britanniques ont été ses débuts, où le jeune officier s'est révolté contre une stratégie — d'ailleurs en grande partie fautive — dirigée par un État-Major français. Britannique a été la critique (sévère) des grands chefs français de la Première Guerre mondiale. Britannique a été la solution préconisée (son premier grand livre : « The British Way in Warfare »). Parce que les Français avaient régné sur la Première Guerre mondiale, parce que cette guerre avait été menée sans mesure au nom des principes stratégiques erronés de Clausewitz, mais sous le drapeau de Foch, sa critique était implicitement antifrançaise et quand l'état-major français fut disqualifié par sa défaite de 1940, il était bien normal que Sir Basil eût eu la position intellectuelle de « celui qui l'avait bien dit ». Sa sympathie pour la France était incontestable, je puis en témoigner, mais son préjugé contre l'état-major français et contre son attitude d'esprit — d'ailleurs incroyablement suffisante dans l'erreur — était profond. Notre amitié nous permettait de parler librement de ces choses, mais son jugement était sévère et peut-être, dans son objectivité volontaire, a-t-il été involontairement injuste pour la France et les Français.
J'écris « peut-être », mais je suis certain qu'il l'a été, comme d'ailleurs la plupart de ses compatriotes. Comment en effet un Britannique insulaire pouvait-il se rendre compte des difficultés extraordinaires du problème posé à la France par la défaite, d'autant que les propagandes de guerre n'ont pas pu ne pas laisser leurs cicatrices?
D'ailleurs, les Français eux-mêmes ont-ils vraiment compris le cauchemar qu'ils ont vécu? J'ai participé au livre collectif « Vie et mort du Français 1939-1945 », j'ai dirigé la publication d'Historia sur la Seconde Guerre mondiale, mais j'ai eu le sentiment à cette occasion que tout ce qui était à dire n'a pas été dit et qu'il a été mal dit. J'ai pu constater, notamment à propos de films récents, des erreurs, des contre-vérités, des points de vue passionnels et injustes. Ce n'est pas une simple postface qu'il faudrait au livre de Sir Basil Liddell Hart pour chercher, s'il se peut, à rétablir les véritables perspectives : ce serait un ouvrage tout entier que j'ai moi-même abordé dans mes Mémoires.
Mais conscient de l'importance et de l'étendue du sujet, je ne veux pas laisser terminer ce grand livre d'histoire sans m'efforcer, par quelques explications simples, de donner au lecteur de bonne foi une vision plus exacte du drame incroyable dans lequel ma génération a été plongée.
La première difficulté fut celle que nous posa notre défaite si soudaine et si complète. Sur le moment, la surprise et la honte nous envahirent. Rien ne nous préparait à une telle épreuve qui n'avait aucun précédent dans notre histoire. La conséquence première fut que nous avons très mal apprécié la nature et la portée de notre défaite — tout comme d'ailleurs nos alliés britanniques. Nous avons cru à un effondrement total de la France, à un désastre irrémédiable, à une tache indélébile sur notre honneur militaire. Les Britanniques qui, assez curieusement, n'ont pratiquement pas combattu les forces allemandes principales, — les Panzerdivizionen — ont, eux aussi, pensé que les Français étaient devenus lâches, qu'ils étaient disqualifiés, et qu'eux-mêmes qui conservaient des troupes en ordre, pourraient s'en tirer tout seuls. Nous au contraire, subjugués par l'extraordinaire victoire allemande, pensions que personne ne pourrait résister. Les Anglais se trompaient, car ils eussent été incapables de résister victorieusement à une attaque de Guderian ou de Rommel et ils se seraient effondrés comme les autres dans ces circonstances — mais ce qui les a sauvés, une fois de plus, ce fut la Manche...
Ce qu'ils n'avaient pas compris, ni nous non plus, c'est que la victoire allemande était essentiellement une victoire technique, selon le mot de de Gaulle, celle de la « force mécanique» sur une armée à l'équipement et à la technique démodés. Nous avons cru — les Britanniques aussi — que cette victoire était due à des défaillances, Dieu sait si l'on a répété en France, et Churchill après nous, que « les Français ne voulaient plus se battre , mais c'était faux et cruellement injuste : l'armée française a perdu en 1940 environ plus de 100000 tués en un mois, chiffre très supérieur à la moyenne de la Première Guerre mondiale et encore supérieur à celui des mois les plus sanglants (1700000 morts pour 51 mois de guerre soit 34000 par mois). L'historique détaillé des premiers combats de 1940 que l'on commence à connaître, montre que le combattant de 1940, placé initialement dans des situations tactiques absurdes, a su combattre courageusement, et mourir sur place. Mais très vite les positions furent submergées et la déroute emporta les survivants. Ce phénomène qui s'est produit en France s'était déjà produit en Belgique; en Hollande, en Pologne (dont le courage militaire n'a jamais été mis en doute. Il devait se reproduire en Yougoslavie (des guerriers cependant) et même en Russie pendant l'opération Barbarossa où les Forces soviétiques s'effondrèrent comme les nôtres, malgré leur équipement plus moderne et elles laissèrent entre les mains des Allemands un butin de matériel et de prisonniers auprès duquel le nôtre pâlit. Mais personne en France à l'époque — sauf peut-être de Gaulle dont je puis témoigner qu'il refusait surtout de voir la triste réalité — ni en Grande Bretagne, ni en Amérique, où tant d'historiens militairement incompétents traitent de cette période, n'a diagnostiqué la victoire purement technique et, disons-le courageusement ici, parfaitement honorable pour les combattants, si elle était pleinement déshonorante pour le commandement. Seuls, les Allemands, qui n'en espéraient pas tant, ont eu l'attitude militaire correcte, et il faut bien dire qu'en 1945, leur défaite, produit par les mêmes conditions que celles qui nous avaient vaincus, ne fut pas plus glorieuse que notre effondrement.
Cette erreur de jugement, bien excusable d'ailleurs, au moins pour le grand public, car je demeure très sévère pour les militaires français responsables de la pensée stratégique, devait peser sur l'attitude française, sur la réputation de la France et même, peut-on dire encore aujourd'hui, sur la psychologie nationale, marquée de cette flétrissure.
La France effondrée, humiliée, déshonorée, ne pouvait que cultiver des complexes terribles d'infériorité. Le bouillon de culture de ces complexes d'infériorité a été cultivé à Vichy sous la direction morale du maréchal Pétain, qui avait toujours été un pessimiste. Cette attitude masochiste n'était pas jugée lâche, mais réaliste. Elle devait conduire à créer une difficulté nouvelle qui fut un piège pour bien des bons Français : l'équivoque sur la politique de la France.
Vichy, profondément persuadé de sa faiblesse, ne voyait de salut que dans l'équivoque: en comptant arrêter le désordre par l'armistice, puis "finassieren" vis-à-vis des Allemands pour sauvegarder ce qui pourrait être sauvegardé. La ligne générale de cette politique, que de Gaulle devait condamner sans appel, n'était pas fausse en elle-même comme expédient provisoire, et comme telle elle a joué un rôle très utile, mais elle a été catastrophique ensuite en ce qu'elle n'a pas compris ses limites. Pétain en 1940 sauvait les meubles — c'est incontestable. En 1942, il trahissait croyant bien faire. En 1944, enfermé dans sa vieillesse, ce qui n'avait rien d'étonnant pour un homme de son âge, il était investi de trop lourdes responsabilités. J'ajoute que ce raccourci sévère ne justifie pas le traitement que lui infligea la IVe République. Mais Pétain tenait de la Première Guerre mondiale un prestige national — à mon sens en partie exagéré — qui le plaçait au-dessus de tout jugement libre. Le pessimisme de vieillard de Pétain allait créer un nouvel obstacle extraordinaire à un relèvement rapide: la division de l'opinion.
Je suis scandalisé par les jugements sommaires de certains Français, sur la période 1940-44 en France métropolitaine. Aucun auteur, — encore moins aucun cinéaste — ne devrait avoir le droit de traiter de cette période, s'il ne l'a pas vécue. Mais, hélas! beaucoup de ceux qui l'ont vécue en France (je ne parle pas de ceux qui étaient à Londres ou à Alger) sont restés des partisans. Ils n'ont pas compris que l'aveuglement incroyable d'une partie importante de l'opinion française était due à l'attitude du maréchal Pétain et à la propagande de son gouvernement (Laval, Brinon, Déat, etc...). Des patriotes sincères, des anciens combattants glorieux — Darnand par exemple — ont été induits en erreur par l'équivoque de Vichy. Le double jeu y était la règle, mais personne ne pouvait savoir quel était le véritable jeu et ceci jusqu'au bout. Des chefs militaires patriotes et honnêtes en ont été victimes (le général Dentz, l'amiral Derrien, l'amiral de Laborde etc...) et c'est là ce que je reproche de plus grave à Vichy, donc au Maréchal, dont les intentions étaient tout autres, bien sûr. Mais aucun Français, ni surtout aucun étranger — fût-il britannique — n'a le droit de condamner moralement ces erreurs comme un crime de "collaboration" et encore moins de lâcheté. J'ai été en prison en France en 1941, j'y suis passé en Conseil de Guerre, j'ai été condamné. Je sais donc de quoi je parle. Je puis témoigner que dans cette période (avant novembre 1942) il n'y avait ni blanc ni noir, mais une gamme de gris indéfinissables. Tout le monde était patriote. Quelques imbéciles mordaient à la propagande allemande, mais là encore avec patriotisme. Le drame — car drame il y a eu — provenait de ce que l'opinion française était divisée, et chacun avait beaucoup de mal à découvrir son véritable devoir.
Il y avait de Gaulle dirait-on. Et c'est vrai. Mais de Gaulle à l'époque, qui avait son auditoire radiophonique, était encore dans les tâtonnements volontaristes de sa stratégie de guerre. Sa critique du Maréchal, bien que fondée en fait, on l'a vu après, était trop violente pour être acceptée. Ses initiatives à Dakar et en Syrie apparurent maladroites et prématurées, sa présence dans le Char Britannique, après le crime de Mers el Kebir, était très compromettante. De Gaulle, avec un instinct très sûr de l'opinion publique, a rallié assez vite l'homme de la rue, qui raisonnait plus avec son coeur qu'avec sa tête. Mais les élites françaises, militaires, bourgeoises et administratives, se défiaient de ce général à la solde des Anglais et entouré de politiciens de la IIIe République. Je ne suis pas sûr, pour revenir au parallélisme avec l'Angleterre, qu'un Anglais traditionnel se serait rallié à un général factieux, tant que le Roi — la légitimité — se serait maintenu.
Cette division de l'opinion, cette difficulté d'être sûrs du devoir à remplir dans ces circonstances exceptionnelles se compliquaient encore du fait que pour un Français moyen, fût-ce un militaire, il n'était pas facile de trouver la tâche utile pour le pays que l'on pouvait remplir.
C'est alors que les Français, selon les hasards de la géographie, se divisèrent en familles très différentes qui devaient longtemps garder leur individualité et leurs préjugés réciproques.
Ceux qui étaient hors de France, à l'étranger ou dans notre Empire, eurent toute facilité pour rejoindre les Forces du général de Gaulle. Ils furent peu nombreux (15 000 Français de race blanche. Chiffre cité par Jean Goulet.), mais généralement héroïques. Ce furent les FFL, les vrais, ceux de la première D.F.L. et de la colonne Leclerc. Ils se couvrirent de gloire partout avec des moyens dérisoires et souvent avec plus de courage que de technique militaire.
Ceux qui étaient en Afrique du Nord et en A.O.F. — voire en Syrie, hélas! — escomptaient bien reprendre le combat, lorsque la balance aurait suffisamment penché en notre faveur. Avec des mérites inégaux — mais difficiles à répartir, que l'on me croie — ce sont eux qui ont réalisé l'acte essentiel pour la France qu'a été le débarquement américano-britannique réussi de 1942, l'opération Torch. Personne ne s'y est trompé, de Gaulle moins que tout autre, mais la propagande et les politiques ont masqué en partie l'extraordinaire succès que ce devait être pour la France, quelles qu'aient été les bavures innombrables de cet autre bouillon de culture que fut Alger. C'est là peut-être que Liddell Hart, qui analyse avec soin cette période et qui par moi la connaît bien, omet de rendre à César ce qui lui revient, c'est-à-dire de reconnaître le cadeau incroyable de l'Armée d'Afrique et de l'Afrique du Nord françaises dans la carte de guerre de l'Alliance. Les résistances initiales de Vichy, les réticences américaines, désobligeantes et mesquines, les approches obliques de Churchill pour exploiter au mieux son poulain rétif de Gaulle, ont fait de cet épisode un moment moralement difficile et ingrat, alors qu'il s'agissait d'une magnifique victoire française d'abord et alliée ensuite. C'est de là que la reconquête devait partir, que la France devait renaître : Londres avait été l'oeuf, Alger la matrice. Le reste devait venir par surcroît.
Ceux qui étaient en France, démobilisés ou membres de l'Armée de l'Armistice, souvent abusés par la propagande comme je l'ai dit, brûlaient eux aussi de combattre : 25 000 rejoindront l'Afrique du Nord au travers des prisons espagnoles, parfois un régiment entier, le 2e Dragons, avec son colonel et son •drapeau..., mais io 000 allèrent en Russie aux côtés des Allemands. D'autres étaient en Allemagne, prisonniers, i 500 000 environ. Parmi eux 71 000 soit près de 5 %, réussirent à s'évader. Le nombre des évadés rattrapés est de plus du double. Il y a donc eu au moins is % d'évasions, dont des généraux d'armée comme le général Giraud.
S'évader, partir se battre à l'Armée d'Afrique n'était pas possible pour tous. Beaucoup, contactés ou spontanément, estimaient devoir combattre sur place par la Résistance. Seuls, peuvent en parler ceux qui en ont fait partie, qui ont ressenti l'angoisse terrible de la clandestinité, la forte solidarité des réseaux (266 réseaux homologués, io 000 membres homologués) l'aventure des maquis (plus de 75 000 maquisards organisés au moment du débarquement), les sinistres risques de mort (roo oco fusillés environ), de torture et de déportation dans les camps nazis. (250 000 déportés français dont la moitié seulement de Juifs et un quart de survivants). Cette Résistance, qui ne représente qu'une partie des innombrables sympathisants, démontre une prise de conscience qui contredit absolument la légende néfaste du Français en majorité combinard et collaborationniste. Il y en a eu bien sûr mais — peut-on le dire? — moins qu'en Norvège, en Hollande, en Belgique — et sans aucun doute en URSS — initialement.
La vérité, c'est que la France, dont la vie quotidienne était atroce — pas de chauffage, ravitaillement insuffisant, électricité peu d'heures par jour — a fait preuve, malgré sa division due à l'équivoque de Vichy, d'une attitude plus qu'honorable. Personne aujourd'hui, dans les générations plus jeunes, ne peut imaginer ce qu'il a fallu de courage et de détermination pour faire face à la brutalité et à la cruauté nazies, comme à l'étendue de notre malheur.
Malgré ces difficultés accumulées, malgré la divergence inévitable des efforts, la moisson de ces sacrifices a été extraordinaire. Les résultats obtenus par ces poignées de héros méritaient mieux que les notations distraites de mon ami Sir Basil. Les résultats d'ensemble sur la guerre sont loin d'avoir été négligeables, comme tant de Français le croient encore.
On va en juger.
Les F.F.L. d'abord. Ils faisaient partie de cette véritable Légion étrangère que l'Angleterre a entretenue dans ses armées. La 8e Armée, celle de Montgomery avait des Indiens, des Australiens, des Sud-Africains et fort peu de Britanniques. Mais elle avait aussi des Français — une brigade, c'est-à-dire un régiment, puis une petite division, c'est-à-dire une brigade, des Belges — un petit bataillon — des Polonais, jusqu'à un corps d'Armée (en Italie), des Hollandais — un commando — des Norvégiens, une légion israélienne etc., etc... De toutes ces troupes, les Français sont les seuls à avoir, malgré des tâches souvent secondaires, attiré l'attention mondiale
Monclar à Keren, Koenig à Bir Hakeim, et dans cette dernière circonstance, ils ont sans doute — malgré les exagérations de la propagande — joué un rôle stratégique hors de proportion avec leur nombre. Ils ont en tout cas contribué à maintenir le moral de tous ceux, en France ou en Afrique du Nord, qui attendaient l'occasion de reprendre la lutte.
L'Armée d'Afrique ensuite. J'ai déjà parlé du magnifique cadeau militaire et géostratégique qui fut fait à cette occasion à une stratégie alliée trop ambitieuse pour ses moyens réels et ses capacités. Si l'opération Torch avait été repoussée par nos troupes — et c'était non seulement facile mais probable, s'il n'y avait pas eu la connivence française assez générale, car les effectifs débarqués étaient faibles et extraordinairement mal entraînés — les conséquences eussent été considérables et la France de Vichy eût peut-être dû rejoindre le camp allemand dans sa défaite finale. Mais surtout, l'échec de cette énorme opération amphibie aurait probablement changé le cours de la guerre et certainement retardé son issue. Voilà ce qu'il faut mettre au compte de la France.
Ce n'est pas tout : le débarquement d'Afrique du Nord a été l'origine — disons le piège — où sont venus se faire prendre en Tunisie 250 000 Germano-Italiens de Rommel et de Graziani. Cette victoire de Tunisie, où les Français à eux seuls (ils étaient 60 000 au total) ont fait 50 000 prisonniers, où ils ont perdu 5 000 hommes tués et blessés, n'a été possible que grâce à l'action menée par nous dans les premiers mois, alors que la logistique américaine s'avérait impuissante à renforcer notre mince défense. Cet aspect de la bataille de Tunisie est généralement méconnu.
De Tunisie, la stratégie alliée a pu sauter en Sicile, en Italie, mais la manoeuvre compassée de Montgomery en fit une avance processionnaire. Giraud, sautant d'un coup en Corse par un coup de poker où il n'engageait que 4 bataillons et qui réussissait ainsi à rallier les Italiens qui venaient de capituler, montrait ce qu'une stratégie hardie aurait pu tirer de la victoire nord-africaine...
Mais en Italie, où la guerre traînait au nord de Naples, qui donc a rompu le front allemand et décidé de la campagne, si ce n'est le Corps expéditionnaire français du général Juin? Là encore, le livre de Sir Basil Liddell Hart le fait mal ressortir.
Le XVè Groupe d'Armées du Field Marshall Alexander est fort de 2 armées, 9 corps d'armée et plus de 35 divisions dont uniquement 2 divisions britanniques + 6 du Commonwealth, soit le double des Forces françaises. L'ennemi n'a que i8 divisions dont seulement 10 en ligne et 8 en réserve. Le Corps expéditionnaire français n'a que 4 divisions et demie (la demie étant le groupement des Tabors marocains du général Guillaume). Les Forces françaises ne sont que le neuvième du Groupe d'Armées, mais elles sont décidées à « faire des étincelles ». Tout le monde, du général au simple soldat, a la volonté de marquer aux Alliés — et aux Allemands — ce dont l'Armée française est capable. C'est la fleur de l'Armée d'Afrique, celle des F.F.L. et celle de l'Afrique et de Vichy. Tout le monde se connaît depuis longtemps. Cette campagne, qui sera si dure et meurtrière est — comme l'étaient les anciennes guerres d'Italie — une grande partie de chasse — un peu dure — entre amis.
Alexander doit attaquer. Son plan, approuvé à Londres, reproduit tous les mauvais schémas alliés de l'époque : attaque processive par les vallées pour ouvrir la route à l'exploitation blindée sur Rome — qui sera britannique naturellement — mais par des vallées étroites où elle a bien peu de chances de réussir. Ce premier bouchon à sauter sera Cassino auquel on affecte le Corps polonais pour cette mission de sacrifice. Les Américains et les Français couvriront l'avance au sud-ouest.
Les Français sont en ligne. Ils ont jugé leur secteur. Juin (tout le monde pense comme lui) est persuadé que seule une manoeuvre par les hauts peut mettre en défaut la défense allemande. Il rallie à cette conception le général américain Clark dont il dépend. Mais Alexander maintient sa direction. Tout au plus admet-il que l'armée française cherche d'abord à déborder Cassino par le sud. Cette concession sera à la base de la victoire : les Français rompent la ligne Gustav, le Corps de Montagne (dont j'étais chef d'état-major) exploita profondément et en souplesse en escaladant une montagne effroyable, le Pétrella. C'est Juin qui sera en flèche couvert à sa gauche par les Américains et ce seront les Britanniques qui à l'inverse du plan, avec 30 km de retard, couvriront le flanc droit de la poussée sur Rome. Le 4 juin, des éléments de la 3 D.I.A. entrent à Rome. La suite, jusqu'à Florence, sera du même style. La victoire était bien une victoire française.
J'ai écrit dans Vie et Mort des Français : « La campagne d'Italie restera un souvenir inoubliable pour ceux qui l'ont faite. L'Armée françaisse avait pu montrer ce dont elle était capable: la furia francese avait été incomparable, mais aussi le sens tactique de la troupe, le coup d'oeil et la science militaire des chefs. Nos alliés n'avaient pu que le reconnaître. Les Allemands eux-mêmes avouaient notre renaissance. Le but était donc atteint. L'avance française, à pied et en montagne, était de plus de 350 kilomètres. Le petit corps expéditionnaire avait perdu 8 000 tués et deux fois plus de blessés. Mais la victoire rachetait tout cela.
La phase suivante fut le débarquement en France et la libération qui suivit. Beaucoup de littérature a été écrite sur le sujet, dont la présente Histoire de la Seconde Guerre Mondiale de Liddell Hart. Aucune ne traduit à cette occasion le rôle exact — et important — qu'y a joué l'armée française rénovée. Le débarquement en Afrique du Nord, mal exécuté, eût pu être une catastrophe. Salerne, mal exploité, faillit en être une. Anzio, conduit avec un méthodisme paralytique, fut un échec. Le débarquement de Normandie, une fois de plus mal exploité, commença comme un échec : à J + 50, le front atteint était très en arrière de celui prévu à J + 20 par le plan initial. Ce plan par contre, aussi peu génial que possible, prévoyait à J -{- 120 (5 octobre) une tête de pont qui jouxtait Paris de la Somme àla Loire. Il avait fallu le sens stratégique de Bradley et la fougue tactique de Patton pour bouleverser ce plan et atteindre à J + i2o une ligne allant d'Anvers au Rhin, à Aix-la-Chapelle, Metz et Dijon. "L'événement" s'était produit tard.
En Provence, un autre plan paralytique, puissant, mais sans génie, avait été établi. Les Américains faisaient une action préliminaire avec en partie des commandos français pour neutraliser les batteries allemandes. Ils sautaient le matin avec une division parachutiste et débarquaient le VIe Corps d'Armée renforcé de chars français. L'armée française suivait sur les mêmes plages. Elle devait s'emparer d'abord de Toulon, puis de Marseille sous la couverture américaine, dans une bataille prolongée que l'on prévoyait comme en Normandie devoir durer un mois au moins. L'exploitation vers le nord pour faire la jonction avec les forces débarquées en Normandie aurait lieu sans doute au cours ou à la fin du mois d'octobre.
Bien sûr nous débarquions dans une situation très différente : le 15 août, la victoire était acquise en Normandie et l'exploitation allait y commencer. Cette situation conduisit Hitler à ordonner aussitôt un repli de ses forces dans le sud de la France à l'exception de Toulon et de Marseille occupées chacune par une division renforcée et des centaines de canons. En outre, la 19è armée allemande devait retarder la poussée alliée vers le nord. C'est là que le style propre à l'Armée française allait intervenir.
Débarqués le 16, les Français ne disposent pour les 8 ou 10 premiers jours que de leur premier échelon, fort — si l'on peut dire — de 16 000 hommes, trente chars et 80 canons, mais ils veulent gagner l'Allemand de vitesse. En deux jours, Toulon est investi. Alors, de Lattre décide avec ses faibles moyens d'attaquer à la fois Toulon et Marseille! La fortune sourit aux audacieux : onze jours après le débarquement, toute la côte est conquise jusqu'au Rhône, Marseille et Toulon sont libérées, aidées par les F.F.I. locaux, deux divisions allemandes ont été anéanties, 37 000 prisoniers ont été faits. Nous avons perdu au total 4 000 tués et blessés, un quart de ce premier échelon débarqué, mais victorieux.
Ce coup d'éclat, dû à d'innombrables actes d'héroïsme, transforme entièrement la situation du front sud, en l'alignant sur celle que Bradley-Patton viennent de réaliser, en Normandie. C'est le seul débarquement allié exploité dans la foulée. Mais maintenant, Marseille et Toulon sont ouverts, l'exploitation vers le nord va pouvoir se développer sans désemparer. L'armée, grisée de sa victoire, fait alors une chevauchée motorisée de 750 kilomètres. le 3 septembre, le Rhône est franchi à l'est de Lyon où le général Brosset entre à la tête de la 1ère D.F.L., le 6 on aborde la boucle du Doubs, le 8 on atteint Autun et Beaune, le 12 liaison est prise en cinq endroits avec l'armée Patton et notamment avec la 2e D.B. de Leclerc qui a eu la chance insigne de libérer Paris. Langres est enlevé le 13, un mois moins trois jours après le débarquement. Qui dit mieux? Or cette avance foudroyante, effectuée au milieu de difficultés logistiques incroyables et retardée par des destructions considérables (il n'y a plus un pont ni un train), ne s'est pas faite sans de nombreux combats, parfois durs. Au nord de Lyon, 2 000 prisonniers, à Autun le groupement Demetz et la colonne F.F.I. Schneider font 3 500 prisonniers. Plus nos lignes de communication s'allongent, plus la résistance allemande se renforce. Crise de ravitaillement, fatigue inouïe, je note dans mes Mémoires, résistance allemande accrue, il va falloir ralentir pour se refaire et repartir en force.
Ce sera alors une dure campagne d'hiver marquée par des offensives successives, toutes très coûteuses, toutes victorieuses. C'est la bataille des Vosges, un cauchemar dans la neige et la pluie, le forcement de la Trouée de Belfort, l'exploitation par la 1ère D.B. du général du Vigier jusqu'à Mulhouse et au Rhin et quelques jours plus tard, dans le cadre de l'armée américaine dont Leclerc constituait la droite, le forcement du Col de Saverne et l'exploitation par la 2è D.B. jusqu'à Strasbourg par une très belle opération symétrique. Puis après, un arrêt et l'offensive allemande des Ardennes qui déconcerte fort le commandement allié, jusqu'à lui faire prescrire l'évacuation de Strasbourg, que de Lattre occupera et défendra non sans risques, la très dure bataille de Colmar, sous la neige, qui chasse l'Allemand du Haut Rhin, puis la poussée au nord dans le Bas Rhin, le forcement de la ligne Siegfried, l'entrée dans le Palatinat. Le forcement de la Trouée de Belfort nous a coûté 3 500 tués et 4 500 blessés, 80 de nos blindés mis hors de combat, mais nous avons fait 17 000 prisonniers, tué 10 000 Allemands, pris 120 canons et 60 blindés. La bataille de Colmar nous rapporte 20 000 prisonniers, mais nous coûte 2 137 tués et 11 253 blessés... C'était la guerre, intense, dure et bien faite, par une armée d'élite qui a ainsi libéré près du tiers du territoire français avec 6 à 7 divisions, alors que les Armées alliées en comprenaient 52. Disons que sans nous vanter nous avions pris une bonne part de la victoire commune.
Mais le dernier épisode de la guerre, la campagne d'Allemagne et d'Autriche — Rhin et Danube — est encore plus révélateur — et encore plus méconnu des Français comme des Alliés.
Après Colmar, de Lattre a intégré dans ses divisions les 135 000 F.F.I. qui avaient rejoint l'armée. Il n'y a plus maintenant deux armées, une riche, une pauvre, une disciplinée, une autre plus fantaisiste, mais une seule armée. Celle de la France libérée.
Le plan allié est d'envahir l'Allemagne par deux grandes offensives une au nord avec Montgomery et les Britanniques poussant sur Hambourg, une au centre avec les Américains en direction de Francfort, Leipzig et se rabattant vers le sud sur Munich et Innsbruck. Les Français devaient rester sur le Rhin en occupant un front passif de 250 kilomètres, le tiers du front occidental. Ils ont 6 divisions * soit I/IO° des forces totales!... - C'est avec cette force dérisoire, étalée dans des espaces immenses que de Lattre réussira, d'abord à décider les Américains à modifier leur plan, puis à franchir le Rhin de vive force (sur 90 propulsistes du 101è régiment du génie qui conduisent les bateaux d'assaut, 54 sont tués ou blessés!), à refouler l'Allemand qui se bat désespérément jusqu'au bout, puis à le surprendre par une concentration soudaine de quatre divisions sur six à Freudenstadt, au-delà de la Forêt-Noire, et entre les 19e et 24e Armées allemandes, à les encercler à Stuttgart et dans la Forêt-Noire, puis à exploiter jusqu'au Vorarlberg en Autriche pour arriver au Tyrol avant les Américains. Ce tour de force stratégique qui apporte à l'armée française victorieuse un sentiment d'apothéose, a été réalisé dans un style et avec un rythme qui égalent largement ceux de nos Alliés, alors que nous n'avons que le dixième de leurs moyens sur un front double du nôtre...
*. La 2e D. B. et la 1ère D. F. L. ont été retirées de l'armée pour combattre la première à Royan, la seconde à Menton... La 2e D. B. reviendra in extremis en Allemagne, dans le cadre américain pour pousser jusqu'à Berstengaden.
Quand à Innsbruck je signe au nom de de Lattre la capitulation du groupe d'armées allemand, le général Brandenberger me confiera qu'il connaissait nos forces et ne s'attendait nullement à être ainsi réduit à merci. De Lattre à Berlin, au nom de de Gaulle, signe la reddition de l'ensemble de l'Armée allemande et il le méritait bien. Keitel qui le voit dit mezzo voce : "Il ne manquait plus que cela!" Mais quelques instants avant, un brigadier britannique, qui participait de la méconnaissance générale, avait osé dire en voyant la délégation française : "Pourquoi pas la Chine?"
Ce n'est pas ce qu'aurait dit mon ami sir Basil Liddell Hart, mais je pense qu'il n'était pas inutile que je rédige cette postface **.
Général Beaufre.
** J'ajoute que l'Armée française, pendant la campagne d'Allemagne avec ses 8 divisions (5 d'infanterie et 3 blindées), plus une ou deux divisions F. F. I. qui ont été engagées (la 10è D.I. et la 27e D.I. de Montagne sur les Alpes), deux autres divisions F.F.I. restées en réserve, la 1ère et la 13è, soit 12 divisions, était d'un volume égal à celui de la 2e Armée britannique, la seule qui ait participé à cette campagne. Ceci aussi est peu connu et devrait permettre de mieux rétablir le sens des proportions entre les deux armées.
Et nous revenions de loin...
Mis en ligne le 29/08/2009 par Pierre Ratcliffe. Contact:  Portail: http://pratclif.com
Portail: http://pratclif.com
