Paul Tapponnier sur le séisme du 5 décembre 2004 en Asie
Paul Tapponnier est directeur du Laboratoire de tectonique à l'Institut de physique du globe de Paris.
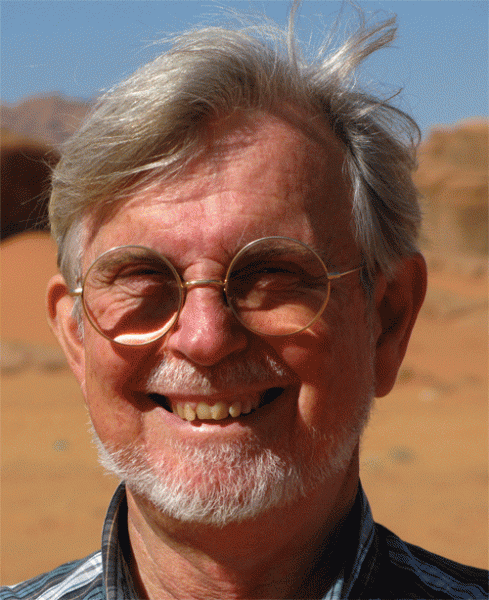
 Au sud et à l'ouest de la pointe nord de Sumatra, ce séisme a relâché soudainement des forces et déformations accumulées depuis des siècles. En 3-4 minutes, les ondes de choc ont ébranlé toute la province d'Aceh, provoquant une dévastation dont on commence à peine à appréhender l'ampleur.
Au sud et à l'ouest de la pointe nord de Sumatra, ce séisme a relâché soudainement des forces et déformations accumulées depuis des siècles. En 3-4 minutes, les ondes de choc ont ébranlé toute la province d'Aceh, provoquant une dévastation dont on commence à peine à appréhender l'ampleur.
Déjà hors du commun, ce désastre n'est pas resté circonscrit près de la zone de rupture, comme c'est le cas général des séismes continentaux. Soulevant le fond marin de plusieurs mètres sur une bande de 40 × 400 km2, le chevauchement brutal du bord de l'Asie sur la croûte océanique indienne a fait naître une autre onde, fluide celle-là. Une énorme vague qui, après avoir achevé d'anéantir la côte ouest de Sumatra, a transporté mort et désolation sur les rives du nord de l'océan Indien et de la mer d'Andaman, y compris dans des contrées tectoniquement paisibles où même les petits séismes sont rares.
A près de 700 km/h, le maximum d'amplitude de ce raz de marée, très directif mais presque imperceptible en haute mer, est d'abord allé frapper de plein fouet les îles Nicobar. Près de quarante minutes après le séisme, la côte sud de la Thaïlande était atteinte. Une heure trente plus tard, celle du Sri Lanka et de l'Inde du Sud. La vague a ensuite balayé les Maldives et les Seychelles pour finir, avec encore assez de puissance pour chavirer les barques de pêche, sur les rivages de la Somalie et du Kenya.
Alors que j'écris ces lignes, le nombre des victimes recensées atteint déjà 140 000. Mais les zones les plus sinistrées, hélas, n'ont encore guère été visitées. Comment s'y rendre ? Ponts, routes et ports sont détruits. Où accoster ? Où atterrir ? On entend dire que plus un signe de vie ne subsiste sur les 250 km du littoral au sud de Banda Aceh... Sur cette côte basse, le tsunami aurait pénétré 10 km à l'intérieur des terres. Aucune nouvelle de Meulaboh, grande ville la plus proche de l'épicentre.
On est donc en droit de craindre que cette immense catastrophe humaine ne rivalise avec les plus grandes connues, toutes d'origine sismique, et la plupart chinoises telle Tangshan en 1976 (255 000 morts), voire Xian en 1556 (830 000 morts). En vérité, le nombre exact des victimes ne sera sans doute jamais connu. Seuls les changements des lignes de côte et des contours des îles seront précisément cartographiés grâce aux satellites d'observation de la Terre, effets permanents d'un cataclysme qui n'est pas à la mesure humaine.
Pourquoi une telle démesure ? Par sa puissance, le séisme d'Aceh n'est après tout que le cinquième des grands séismes instrumentaux connus. Oui, mais il vient de frapper, lui, au coeur des régions les plus densément habitées de la planète, entre les rivages tropicaux de l'Inde et de l'Indonésie, distants de 2 000 km au plus. Tout se conjuguait donc pour donner à cette catastrophe naturelle le maximum de "portée" meurtrière.
Aurait-on pu limiter les pertes humaines ? Que faire dans des circonstances comparables ? La première réaction du géophysicien ne peut être que l'humilité. Qu'aurais-je pu faire, moi, qui suis sans doute aussi averti qu'on peut l'être du fonctionnement de la Terre dans cette région du monde, de l'enchaînement séisme-raz de marée et de l'histoire (connue) des grandes catastrophes telluriques depuis trois mille ans en Asie ?
Si j'avais été à Phuket, à quelque 800 km de l'épicentre, peut-être aurais-je été alerté par les oscillations du séisme lui-même. Elles ont dû être clairement perceptibles. Les séismes de magnitude 7 réveillent ordinairement les dormeurs à des centaines de kilomètres. Si je les avais ressenties, leur durée m'aurait sans doute inquiété. Ce sont les secousses qui durent, même si leur amplitude est faible, qui requièrent une réaction rapide et sérieuse. Elles sont l'apanage des très grands séismes qui seuls engendrent de longs et puissants trains d'ondes de surface.
Aurais-je alors eu la présence d'esprit d'alerter mon entourage et d'inciter le plus grand nombre à la fuite vers les hauteurs dans la perspective d'un tsunami potentiel ? Avec une petite demi-heure de préavis, cette attitude aurait été la meilleure. Mais elle requiert une prise de conscience rapide de la taille du séisme et de son origine probable, "au flair", ce qui n'est pas facile même pour l'homme de l'art.
Plus tard à Phuket, ou plus loin à Sri Lanka, où le séisme lui-même n'était plus perceptible, si j'avais été en position de contempler le rivage et de voir la mer se retirer vite et loin de la ligne de ressac habituelle, j'aurais sans doute immédiatement pensé: raz de marée. Aurais-je réagi avec la rapidité nécessaire ? Mais quelle rapidité ? Et, suivant l'endroit, comment réagir ? Rares sont ceux d'entre nous qui ont vécu ou observé un raz de marée.
Je dois confesser que je n'en avais qu'une idée très incomplète. Au-delà de l'horreur brute qu'ils documentent, les nombreux films qui nous parviennent aujourd'hui précisent, mieux que toute image d'archive, ce qu'est exactement un tsunami, cette onde sournoise qui ne se matérialise que près des côtes. Au moins autant que l'effrayant mascaret frontal des peintures japonaises, ou les grandes déferlantes qui lui succèdent, c'est le puissant courant qui s'ensuit qui constitue le danger et l'agent principal de dévastation.
La mer envahit la terre pendant plusieurs minutes, avant de se retirer en un temps plus long encore. Ce flux et ce reflux s'apparentent aux plus grandes crues de rivières. Le niveau de l'eau monte rapidement de plusieurs mètres et ces courants violents s'engouffrent partout, inondant tout ce qui est à leur portée. Le mot français, raz de marée (courant de marée) rend précisément compte du phénomène. On pourrait aussi dire "crue de mer". Ce sont ces courants de crue boueux, chargés des limons et vases côtières, qui déplacent bateaux, maisons, et même locomotives pesant plusieurs dizaines de tonnes.
Pendant d'interminables minutes, dans un sens puis dans l'autre, les débris massifs charriés par cette crue torrentielle s'entrechoquent, détruisent, blessent et tuent. Même le nageur le plus aguerri ne s'en sortira que par miracle. Ultimement, tout ce qui flotte est entraîné au large, tout ce qui sombre, enseveli dans la boue. Le recours principal ne peut donc être que la fuite, à temps, le plus vite possible.
A Phuket, les collines sont relativement proches. Monter rapidement de quelques dizaines de mètres est sans doute envisageable pour qui comprend instantanément ce qui se passe. Mais près des palmiers, sous un soleil radieux, face à une mer chaude et jusqu'ici calme, comment ne pas perdre de nombreuses secondes, toutes précieuses, dans la contemplation incrédule, voire inquisitive, d'un phénomène jamais vu. Curieux d'observer la nature, j'en aurais sans doute perdu beaucoup. Sur les côtes plates comme à Galle, plus encore Banda Aceh, peu ou pas de fuite possible sur des hauteurs naturelles. L'unique espoir est de grimper dans les étages ou de s'accrocher puis se hisser le plus haut possible sur des bâtiments en espérant qu'ils résisteront.
Lorsque le raz de marée surprend, les stratégies de survie sont donc bien minces. Il n'empêche. Comme dans toutes les situations d'urgence, connaissance et éducation sont vitales. C'est une telle éducation qu'ont intégrée les Japonais, qui vivent depuis des siècles avec les tsunamis les plus fréquents du monde. C'est cette éducation-là que mon collègue Kerry Sieh, professeur au California Institute of Technology, avait récemment commencé à inculquer aux habitants de la côte ouest de Sumatra, près de l'équateur et plus au sud, à force d'affiches et de conférences, au niveau local et régional.
Là, des recherches approfondies, continues depuis près de dix ans, lui avaient permis de préciser la taille et l'impact des deux séismes géants de 1833 (M = 9) et de 1861 (M = 8,5) sur l'île de Sumatra comme sur celles de Nias, Siberut et autres plus au large. Mieux, ces recherches ont permis de reculer dans le temps et de déterminer que la période de retour de ces catastrophes - la première comparable à celle du 26 décembre, hormis un raz de marée dirigé plutôt vers le sud de l'océan Indien - était de l'ordre de 250 ans. La cartographie, île après île, des anomalies de croissance de micro-atolls coralliens qui vivent à fleur d'eau permet de reconstituer la taille et l'histoire des séismes anciens, étape essentielle dans la compréhension des séismes futurs.
Au centre de Sumatra, la recherche fondamentale avait donc porté ses fruits. On savait à quoi s'attendre, et approximativement quand (vers la fin du siècle qui commence). Même imprécis, de tels résultats sont essentiels pour l'évaluation des risques sismiques et tsunamiques futurs au nord et au sud de Padang. On ne savait rien de tel, hélas, quelques centaines de kilomètres plus au nord, dans toute la province aujourd'hui sinistrée d'Aceh et sur l'île de Simeulue. Ni au Sri Lanka.
Dans ces deux régions, guerre civile et guérilla interdisaient toute recherche depuis vingt ans. D'où, en partie, l'étendue du désastre.
Est-il possible d'espérer que ce retard criminel de la connaissance puisse être comblé avant la prochaine catastrophe ? Il faut en effet d'abord et avant tout savoir. Dans cette optique, il n'est pas inutile que les médias maintenant mondialisés continuent à diffuser, malgré leur brutalité, les nombreuses vidéos sauvées du naufrage, et les témoignages vécus, pour que le plus grand nombre puisse en tirer connaissance, leçon et réflexe d'action futur. Ecoutez, regardez: voici ce qu'est un raz de marée ! A défaut de n'avoir pu faire, voilà ce qu'on pourrait peut-être faire. Voici les domaines du possible et de l'impossible.
Et l'alerte ? N'aurait-on pas pu prévenir à temps les riverains de la mer d'Andaman et de l'océan Indien ? On aurait dû, cela tombe sous le sens: trois quarts d'heure, deux heures, c'est long ! Presque en temps réel désormais, un séisme de magnitude 7 ou plus peut être identifié et localisé grâce aux réseaux mondiaux de stations sismiques tels qu'IRIS ou Géoscope. Mais la nouvelle n'est pas parvenue là où elle aurait dû parvenir en urgence: au bord de la mer. Vingt minutes après 7 heures du matin, tout était déjà consommé à Banda Aceh.
Il n'était pas tout à fait trop tard à Phuket, encore moins au Sri Lanka et dans le Tamil Nadu. Ne parlons pas des Maldives ! Sans nul doute, de nombreuses vies auraient pu être sauvées. Qui est responsable ? Personne, c'est le coeur du problème. La connaissance, une fois encore. Localement, personne ne savait, personne ne se doutait, personne n'imaginait. A l'exception, déjà trop tard, de quelques sismologues éparpillés loin de la zone frappée au coeur, sans doute stupéfiés par les enregistrements qui se déroulaient sous leurs yeux.
Cela n'était arrivé de mémoire récente que dans le Pacifique, pas dans l'océan Indien. Il eût fallu qu'existât un système d'alerte bien rodé, encore plus performant que celui du Pacifique vu les temps de parcours beaucoup plus courts de l'onde marine entre sa source et les côtes menacées. On l'a dit et répété, ce système n'existait pas. Il doit être mis sur pied d'urgence. Vu l'élan de solidarité mondial sans précédent des derniers jours, gageons que les moyens seront rapidement réunis.
Il serait bon de se soucier aussi de la Méditerranée... avant le prochain désastre. Il est vrai que les plaques s'y meuvent moins vite, surtout à l'ouest. Mais n'oublions pas les dizaines de milliers de victimes à Messine en 1908. Alexandrie et les côtes de l'Egypte dévastées en 365 et 1303 par des raz de marée sans doute venus de Crète ou de Chypre, là où l'Afrique s'enfonce sous l'Egée et la Turquie. Et Bérite (Beyrouth), fleur du Proche-Orient antique, qui, noyée en 551 après Jésus-Christ, mit plus de dix siècles à s'en relever.
En amont de l'alerte, que peut-on espérer faire ? Disons plutôt, que doit-on faire: c'est bien d'un devoir qu'il s'agit. La voie est claire. Tout système d'alerte doit être constamment nourri et amélioré par la recherche fondamentale. Il faut chercher à mieux connaître et mieux comprendre le fonctionnement des failles terrestres. Il est vital de continuer à développer l'observation de notre planète à la frontière des techniques existantes. Il n'est guère de domaine où l'investissement dans la recherche fondamentale doive être plus grand et plus soutenu sur le long terme.
Nous savons que, dans les deux ou trois décennies à venir, de grands tremblements de terre sont attendus en mer de Marmara, en Californie du Sud, dans les provinces du Qinghai et du Ganzu, en Chine, pour ne citer que quelques exemples. Comme la sismologie, la sismotectonique - l'étude des failles actives - a fait d'immenses progrès en seulement vingt ans. Chaque année, les failles vivantes de la planète sont cartographiées avec une précision accrue, grâce en partie aux images de satellites dont la résolution a augmenté d'un facteur 100 depuis 1975. La segmentation de ces failles, qui contrôle la taille des séismes, est de mieux en mieux comprise. De nouvelles failles actives sont découvertes. Nous savons donc de mieux en mieux où risquent de se produire les tremblements de terre et quelle peut être leur taille.
Un exemple récent: le séisme des Saintes, le 21 novembre 2004, entre Guadeloupe et Dominique, s'est produit sur une faille active sous-marine identifiée il y a quatre ans lors de la campagne Aguadomar (Institut de physique du globe de Paris et Ifremer). La longueur de cette faille (15-20 km) est en bon accord avec la magnitude (6,3) du séisme.
En Californie, en Turquie, au Liban et ailleurs, de nombreuses tranchées creusées dans le sol transversalement aux failles ont mis au jour des séquences de 10, 20, voire 30 tremblements de terre anciens, éclairant l'histoire du fonctionnement de ces failles (San Andreas en Californie, nord-anatolienne en Turquie, Yammouneh au Liban) pendant les derniers 5 000, 10 000, voire 20 000 ans. (En excavant les traces des grands séismes - il s'agit de véritables fouilles, au sens archéologique du terme -, on peut retrouver, décrypter et dater au carbone 14 les traces des séismes disparus.) Cette histoire est essentielle pour penser les scénarios sismiques du futur.
Les grands séismes sont-ils réguliers ou non ? Se reproduisent-ils environ tous les 150, 250, ou 1 000 ans ? Partout où elle existe, cette connaissance fait reculer les bornes de l'imprévu. Parallèlement à la sismologie, qui écoute les frémissements de la Terre avec de plus en plus d'acuité, la géodésie spatiale nous offre aujourd'hui des techniques d'une finesse telle (GPS, radar interférométrique) que les mouvements millimétriques de surface peuvent être surveillés en continu. Les vitesses moyennes de toutes les failles sismogéniques qui comptent sont désormais accessibles en temps réel. Encore faut-il pouvoir installer et maintenir des réseaux denses d'instruments fonctionnant en continu.
C'est une tâche qui doit être entreprise à l'échelle planétaire. Les ancrages de départ sont déjà en place. Il existe par exemple des réseaux GPS récents en Birmanie et en Indonésie orientale, que contribue à maintenir Christophe Vigny, à l'Ecole normale supérieure. D'autres, dans le centre et le sud de Sumatra, sous l'égide de Kerry Sieh, ou dans l'Himalaya, sous celle de Jean-Philippe Avouac, à Caltech, en collaboration avec le CEA, ou encore en Turquie et en Grèce. Mais la plupart sont encore trop modestes pour qu'on puisse résoudre mieux que le premier ordre: les mouvements des grands blocs.
Car ce qu'il faut mesurer et comprendre pour espérer "voir venir" les catastrophes du futur, ce sont les variations du deuxième ordre des mouvements et de la sismicité. On sait que certaines failles ne glissent pas toujours à la même vitesse. Grâce à une approche mise au point il y a dix ans par Geoffrey King (Institut de physique du globe de Paris) et Ross Stein (USGS), on sait désormais calculer la nouvelle donne des forces après un séisme. La modélisation des changements de contraintes dans les régions entourant une faille qui vient de glisser permet d'identifier les failles voisines qui sont les plus susceptibles de glisser.
Pour aller plus loin, tout repose sur l'observation et la mesure en temps réel. Il est aujourd'hui aussi urgent d'observer la Terre solide que ses climats ou les confins du système solaire. C'est une observation qui doit se concevoir à l'échelle des siècles. Ne nous méprenons pas. D'autres cataclysmes sismiques, sans doute encore plus graves - nous sommes de plus en plus nombreux - frapperont l'humanité avant la fin de ce siècle.
Combien de décennies ou de siècles nous séparent d'un séisme comparable à celui qui dévasta le nord des Antilles en 1843? Le raz de marée ne pourrait-il atteindre Miami? Là, pour l'instant, l'histoire se résume à un constat bien mince: aucun autre grand séisme n'a été bien décrit depuis l'arrivée de Christophe Colomb en 1492 ! Il nous faut savoir plus. Répétons-le sans relâche: c'est possible. C'est de la recherche fondamentale.
La tâche qui reste est immense, mais les chercheurs sont là, vibrants de motivation et d'idées nouvelles. Ce sont les moyens qui manquent. Comme les palais des rois d'antan ou les cathédrales, les réseaux d'observation de la Terre doivent être érigés pour durer. Ne mégotons pas. Il en va de millions de vies. Nos démocraties actuelles, et les grandes multinationales, cette fois bien éraflées, sauront-elles se montrer à la hauteur de cette tâche et venir en aide aux plus démunis, ceux qui paient souvent le plus lourd tribut?
Plus:
Mis à jour le 26/11/2016  pratclif.com
pratclif.com
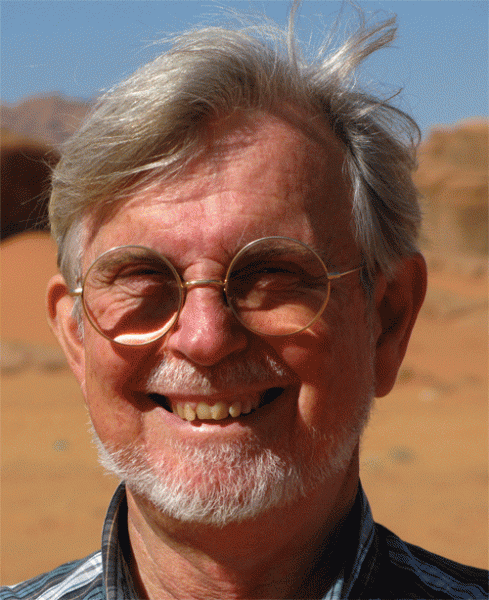
 Au sud et à l'ouest de la pointe nord de Sumatra, ce séisme a relâché soudainement des forces et déformations accumulées depuis des siècles. En 3-4 minutes, les ondes de choc ont ébranlé toute la province d'Aceh, provoquant une dévastation dont on commence à peine à appréhender l'ampleur.
Au sud et à l'ouest de la pointe nord de Sumatra, ce séisme a relâché soudainement des forces et déformations accumulées depuis des siècles. En 3-4 minutes, les ondes de choc ont ébranlé toute la province d'Aceh, provoquant une dévastation dont on commence à peine à appréhender l'ampleur.